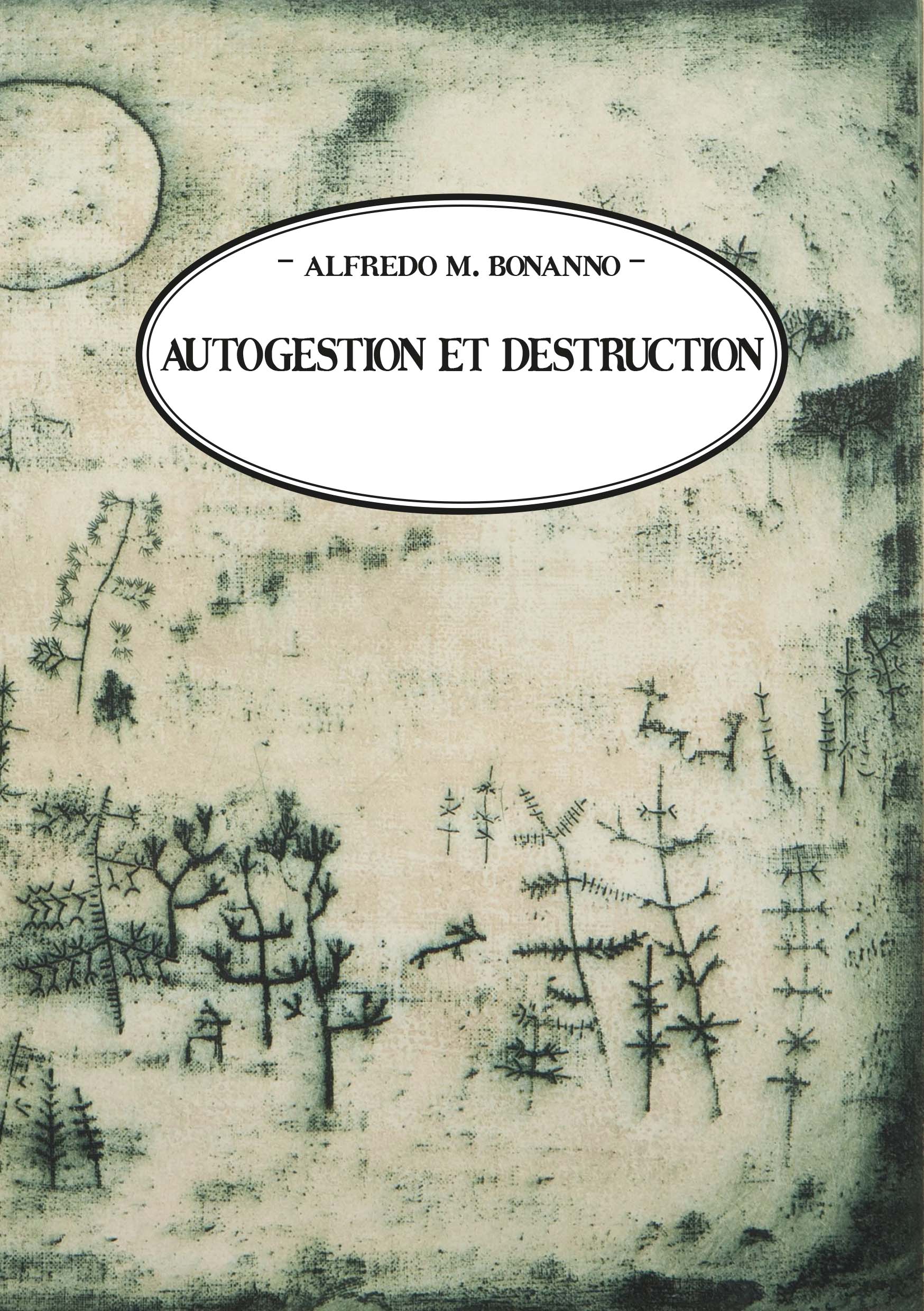 L’autogestion est cette aventure historique, ce jet monstrueux du nouveau dans le vieux,
L’autogestion est cette aventure historique, ce jet monstrueux du nouveau dans le vieux,
cette destruction sans résidus actifs, cette fécondation de la fantaisie qui crée et remplie
de matière de nouvelles formes de vie.[…]
Le bon sens peureux de ceux qui ont les pieds sur terre s’insurge soudain pour
réprimander ceux qui ont saisi le sens profond de ces mots : Destruction totale et
Autogestion. Personne aujourd’hui, pas même les révolutionnaires anarchistes, ne
croit à la destruction totale ni ne parle d’autogestion sans se sentir un peu ridicule. C’est
précisément cela que ces annotations, écrites dans un endroit où l’on ne connaît pas le
sens du ridicule, mais seulement celui de la terrible obscénité répressive, ne comptent
pas accepter. La cohabitation splendide du binôme : Destruction totale/Autogestion,
peut faire peur, c’est compréhensible. Non pas à cause de son invraisemblance – source
habituelle du ridicule –, plutôt à cause de son éloignement radical des deux concepts qui
le constituent, une fois séparés. Et c’est de cela que nous allons nous occuper maintenant.
[…]
La levée d’un processus de renversement global n’est ni identique ni aussi simple que la
main qui frappe ou anéantie ce qui nous opprime. Mille mains peuvent se lever dans ce
geste libérateur sans que rien n’arrive. Quel est alors le mystère qui opère à l’intérieur
d’un mouvement historique sans précédent comme l’autogestion généralisée ? Le fait
extraordinaire c’est que souffrances et jouissances sont remises à zéro de la même
manière. On n’hérite pas d’une condition confortable pour en profiter, on n’exproprie
personne – sinon l’insignifiante mais nécessaire partie des biens de consommation
immédiats – mais on porte à son achèvement, dans une toute autre direction, la
destruction que le capitalisme avait obstinément commencé pour garantir ses intérêts.
La vengeance est ainsi amenée au coeur même du capital, dans sa manie insensée de
considérer le monde entier comme sa possession. Le monde est au contraire déclaré
vieux et inutilisable, presque totalement, et est renversé dans le monde nouveau.
Pour télécharger la brochure: Autogestion et destruction – A. M. Bonanno A5 page-par-page
Ci-dessous, le texte de la brochure:
Autogestion et destruction
Il est temps que sortent du mot « autogestion », comme du vieux chapeau d’un jongleur, d’autres significations. Celles d’il y a 40 ans ne sont plus valides, le temps se félicite toujours d’être un mauvais conseiller pour ceux qui comptent enfermer leur curiosité dans le tiroir.
Avançons avec un ton rêche, n’attirons pas une fois de plus les intérêts de circonstance des lecteurs passionnés d’économie. Le fait est que cet art de charlatans n’a pas de points de repère, pas même pour le capital, et ses soi-disant lois ne sont pas autre chose qu’une justification rhétorique a posteriori de ce que le capital a déjà fait en termes de massacres et de destructions. Aucune théorie, prélevée de l’économie, ne peut être mise à disposition des révolutionnaires, et ceci est une affirmation précisément irréfutable. Tous ceux, anarchistes compris, qui sont partis de cette prétendue science pour construire « un monde meilleur », ont abouti à une abomination gênante. Bafouiller des théorèmes économiques, avec l’air de dire des vérités consolidées par la pratique, ne sera pas ce que le lecteur trouvera dans ce vieux livre, et moins que jamais dans ces jeunes annotations.
Mais puisqu’on y est, et puisqu’un lourd fardeau de théorie économique pèse sur nos dos, continuons encore un peu. S’occuper d’économie ne demande pas un grand talent, la lecture des exploits pratiques des capitalistes suffit. Si ces derniers doivent avoir du talent, pour les économistes ce n’est pas nécessaire. Ce sont les entrepreneurs qui ouvrent la voie, le couteau entre les dents, qui enfoncent leurs crocs et mordent, qui vainquent et perdent, les économistes eux s’assoient souvent sur le char du vainqueur, mais avec la tenue de l’esclave.
Une théorie économique se base sur la pratique productive, elle modifie cette dernière pour les nécessités du marché et de l’exploitation que le capital impose partout, la théorie chute puis est remplacée par une autre. Même l’autogestion (mais laquelle ?) a été emportée par le capital et amenée à se vider complètement. Bien sûr ce n’est pas de cette autogestion que nous parlons, et nous verrons pourquoi. Juste pour appeler les choses par leur nom, il s’est plus agi de cogestion que d’autogestion, mais, la confusion pouvant toujours servir, autant jouer sur l’équivoque. Les compagnons allemands et suédois d’il y a trente ans l’ont fait. Les expériences théoriques italiennes sont d’une misère unique, à l’exception de mon livre et de la modestie qui ne me plaît pas. Bannir les bavardages, voilà une bonne méthode. Faire passer des instruments répressifs ou de récupération, nouvellement forgés, pour des instruments révolutionnaires, ce sont des bavardages agaçants.
Celui qui subit l’exploitation est dans un état de servitude douloureux. Le travailleur est l’esclave moderne, en rien différent de l’esclave antique. Lui fournir une belle théorie économique en guise de réconfort et de viatique signifie lui cracher au visage.
Aucune indulgence pour les propagateurs de la misère d’autrui. Eux qui, pour gagner leur condition privilégiée optimale, aident celui qui garde en main la férule, pour faire avancer le travail des esclaves. Ce sont eux les vrais misérables, pire encore que les exploiteurs en prise directe, qui au moins mettent l’enseigne de l’usine devant l’abattoir.
Si l’économie était une science, elle devrait rendre conforme à elle-même le monde de la production, et devrait être contrainte de suivre le cheminement général de la science, avec tous ses changements d’avis et ses déséquilibres, ses approximations et ses pantins de paille. Au contraire elle pense encore mesurer le monde avec ses formules, lesquelles sont devenues entre-temps de ridicules exercices scolaires.
Ces dernières décennies, j’ai suivi méticuleusement les vicissitudes comiques de cette science aux jambes trop fragiles. Je n’ai pas trouvé de théorie qui vaille la peine qu’on l’appelle ainsi. Le théorème Modigliani-Tarantelli est un cas exemplaire. Donnez-vous un gouvernement durable, capable de faire les réformes, et vous pouvez refonder l’exploitation sur la flexibilité. Ne vous faites pas de soucis, le reste – en premier lieu la mondialisation – viendra d’elle-même. À condition que l’on ne fasse pas de mouvements trop brusques, autrement ceux qui sont sous le fouet pourraient ressentir le changement des coups qu’ils reçoivent.
La misère permanente de l’économie peut se résumer dans le concept de crise, même pas digne d’une véritable théorie. Les différents dysfonctionnements physiologiques du capital ont toujours été vus comme des « crises », et quand ce fut nécessaire on a suggéré des remèdes peut-être pires encore que le mal. Le plus beau dans tout ça c’est que certains révolutionnaires autoritaires, une espèce de matrice marxiste, soutiennent encore cette absurdité, et avec eux pas mal d’anarchistes, à jeun (grand bien leur fasse) d’études d’économie sérieuses. Non pas que ces études puissent faire la différence, mais elles permettent bien sur une réflexion qu’un rapide vol d’oiseau ne consent pas. Il y a comme un embarras à approcher la science souveraine du capital, et on ne s’en rend compte qu’en grattant le vernis – presque toujours mathématique –, le reste est nudité absolue.
Peut-être que dans le passé, j’ai fauté d’une excessive prudence en parlant d’économie, et il me semble, avec l’œil d’aujourd’hui, que le traitement des problèmes organisationnels de l’autogestion peut se réduire à cette prudence, mais désormais on peut dire les choses comme elles sont. Éloignons-nous de cette prudence.
L’autogestion ne doit pas être confondue avec l’autodétermination. Cette superposition a fait plus de dégâts que nécessaire. L’autodétermination est ce que la volonté impose continuellement à l’individu, sans arrêt, comme un marteau pneumatique inarrêtable. Tu dois vouloir, voilà l’ordre de la volonté, et tu es toi-même cette volonté. Un cercle fermé. Une cécité. Dans ce cercle se concentrent les valeurs, l’essence de la vie et la positivité de n’importe quel projet qui donne sens à la vie. Mais ce cercle reste toujours fermé. Sur quoi puis-je en effet fonder mon autodétermination ? Sur moi-même, évidemment, avec toutes mes limites. Ces dernières deviennent ainsi l’unité de mesure pour juger le monde qui m’entoure et je pense être le centre et la concentration de ce monde. En règle générale, ceux qui pensent ainsi ont – et veulent avoir – toujours raison. Triste destinée de tout cercle fermé. Cela atteint la perfection automatique chez l’imbécile qui, ne pouvant pas faire autrement, autodétermine sa propre imbécillité.
S’autodéterminer est donc presque une antithèse de s’autogérer, comme nous le verrons au cours de ces pages. Pour le moment, il faut souligner que le premier concept se clôt dans la volonté alors que le second s’ouvre à l’affinité. La volonté s’exalte elle-même et avance droit comme un train, elle veut vouloir jusqu’au bout. Lui donner libre accès à notre vie signifie construire en nous-même une machine du faire. L’affinité cherche l’autre et est disposée à l’accepter dans son cercle le plus intime, bien que cet aspect de l’autogestion n’ait pas été traité, si non en passant, notamment en relation à l’autogestion productive de la lutte.
L’autodétermination est une loupe vers l’intérieur. Elle creuse et coupe, mais elle ne creuse et coupe que ce qui est là, elle ne peut pas amener à l’intérieur ce qui est dehors. Cela produit une vision réduite du monde, parce que ponctuelle et centralisée, qui plus est basée sur la possession de la vérité. L’autre, et ses éventuels bavardages, me restent éloignés, pas proches donc, je n’ai même pas le plaisir de le considérer comme un imbécile. Me déterminant seul, je pose un autre point ferme duquel je ne peux me détacher. C’est moi qui règle le jeu, l’évidence et le bouillonnement des événements ne me perturbent pas. Mon cadre autodéterminé m’enserre et me console, il me fait me sentir en sécurité. Ceux qui s’autodéterminent vivent prisonniers d‘eux-mêmes, ils se meuvent dans un territoire semé et labouré par leur seule volonté. Rien d’autre.
L’affinité avec l’autre n’est pas la collectivité, donc le monde dominé par la politique du capital, mais est un point de référence que je suis disposé à prendre en considération. Je n’ai pas les pieds dans la politique et la tête dans l’autogestion, je fais avec autrui une expérience qui veut être différente.
Mais dans quoi est-ce que j’aimerais que consiste cette diversité ? Voilà la question. L’autogestion de la production n’est qu’un pâle reflet de l’autogestion généralisée. Quand la première a été réalisée il ne s’est agi que d’une expérience d’auto-exploitation, certainement pas de libération. L’autogestion de la lutte, de son côté, est construction d’instruments d’attaques, éloignement des collaborations fictives intéressées, projet révolutionnaire etc. Mais la diversité ?
Voilà, la diversité est encore au-delà, plus loin encore. La diversité c’est le chaos, le refus des règles, l’anarchie. Mais comment puis-je porter le chaos dans la production et dans la lutte si d’un côté j’ai besoin des moyens de production et des marchés, et de l’autre d’un projet d’attaque ? Je ne peux pas. Voilà pourquoi tout discours sur l’autogestion est voué à s’éloigner de la diversité, de transiger avec le chaos, d’organiser et de produire des modèles de comportement.
Mais l’aspect important du chaos, en ce qui nous concerne, c’est de tenir compte qu’au cours de l’autogestion tout ne peut pas être ramené aux modèles productifs auxquels nous a habitués le capital, ou aux formes traditionnelles de lutte syndicaliste. Dans l’autogestion, il y a un pullulement de nouveautés formelles et substantielles, de forces et de projets, de jonctions entre production et destruction, entre faire et agir, entre donner vie à de nouveaux produits et attaquer l’ennemi de classe en détruisant les vieux produits, les richesses accumulées et les irréductibles habitudes capitalistes. En somme, il faut ouvrir la porte au différent, même au différemment monstrueux, c’est-à-dire à ce que la normalité codifiée du capital nous faisait considérer comme monstrueux. Et cela peut arriver en produisant différemment des objets différents et en luttant différemment. Entre les vieux modèles et les nouveaux, les vieilles théories et les nouvelles, il doit y avoir une délimitation radicale, non pas une condescendance réciproque, bienveillante. Ceci est une nouvelle conception de l’affinité dans la lutte et de la collaboration autogérée dans la production, entièrement basée sur une différence entre la lutte qui se démarque de la production mais ne la contredit pas, alors que dans cette dernière se reflète et s’y trouve des éléments de développement, et vice versa. Il arrive alors que l’autogestion reflète une nouvelle et puissante transformation de la réalité naturelle, réalité qui désormais ne peut même plus être sérieusement distincte du productivisme aveugle du capital.
Maintenant, cette distinction est avant tout conscience de soi dans une méthode qui pénètre les fibres de l’individu et scande les rythmes alternatifs, parfois même opposés. Il ne s’agit pas de substituer un profil ornemental à un autre, mais de saper les fondements d’un monde vieux, qui a fait son temps et qui enveloppe l’homme comme un linceul. Incisant l’énorme bubon du monde, la lutte le fait exploser, et toute la boue qui couvre les choses de la politique sort en ébullition. La destruction ne peut pas découper quelque chose de pourri sur un corps sain, ceci est désormais une croyance du passé s’étant révélée infondée. Elle doit remettre à zéro l’informe circonstance de la vie collective basée sur la politique, elle ne peut pas, satisfaite de son œuvre, observer ce qu’elle a décroché comme un précieux camée.
Bien sûr, dans la perspective pratique de la lutte autogérée, l’affinité agit en produisant des occasions, parfois minimes, la capacité de libérer des forces résiduelles et des mécanismes mis au rebut. Mais il faut ensuite continuer, l’aspect productif prend absolument le dessus, et cela ne peut pas rester longtemps dans le domaine des occasions, il faut avoir un projet préventif le plus large possible, jusqu’à inclure la société dans son ensemble. Ou cet immense mouvement se déchaîne et évolue, ou bien tout retombe dans la phase de la lutte, encore préparatoire et occasionnelle, non pas décisive.
Il est sûrement possible d’appeler le monde autogéré « monde nouveau », même si cette définition des syndicalistes révolutionnaires du passé est désormais trop biaisée, mais il faut se mettre d’accord sur la « nouveauté ». Il ne s’agit pas tant de nouveaux rapports, parfois monstrueusement inimaginables – cela, c’est l’aspect le moins intéressant – que de nouvelles énergies destructrices qui s’ouvrent au cours même de l’action de lutte et de production.
Tout ce qui advient dans le cadre de ce double processus autogestionnaire – lutte/production – interagit réciproquement, s’hybride en floraisons improvisées et souvent incompréhensibles, jamais expérimentées, qui nécessitent courage et main ferme. Deux éléments que les esclaves d’aujourd’hui, les travailleurs, ont presque totalement perdus. Et pourtant ce seront eux, à l’intérieur du processus destructif, et leur monde dans son effondrement même, qui remettront en circulation courage et main ferme. Le « nouveau » sort du « vieux » de cette manière inattendue. Les formes des rapports sociaux changent, ce ne sont pas les contradictions qui explosent – celles-ci se sont assoupies dans le cimetière du conformisme participatif – mais les rapports totaux, socialement globaux, qui constituent la société dans son ensemble. Je ne parle pas des occasions de lutte, mais d’une lutte qui a réalisé son occasion révolutionnaire. Une lutte autogestionnaire qui ne contemple pas son aboutissement satisfaite ou désolée, mais qui va au-delà de toute occasion possible, et qui nie la médiation avec quelque chose de vieux qui veut survivre et cherche par tous les moyens à se montrer modifié et attrayant.
L’autogestion est cette aventure historique, ce jet monstrueux du nouveau dans le vieux, cette destruction sans résidus actifs, cette fécondation de la fantaisie qui crée et remplie de matière de nouvelles formes de vie.
Je sais bien que tout cela n’est pas dans mon livre, et que le lecteur restera surpris ou rassuré selon qu’il lira ces annotations avant ou après. Je ne peux rien y faire, ce sera à lui d’en tirer les conclusions, et s’il pense avoir perdu son temps en lisant le livre, cela voudra dire que j’aurais perdu le mien en l’écrivant.
Nous ne pouvons plus contenir l’autogestion dans le marécage de l’époque productive, celle où l’on pensait sérieusement que la révolution serait simplement l’expropriation des moyens de production, un passage de relais. Il y a quarante ans on avait l’habitude de dire ça, aujourd’hui je ne suis même pas en mesure de recommencer à imaginer les bases de cette situation et de cette cécité. Personnellement j’ai toujours jugé ce transfert impossible, simple corollaire d’une sorte de prise du Palais d’Hiver. Mon livre en est un témoignage. Dans tous les cas, le temps est écoulé et les jeux sont faits. Évoquer des conditions mortes depuis longtemps est une démangeaison historique ou bien un stupide intérêt de parti. La destruction aujourd’hui est la seule voie praticable pour la lutte et la production autogérée, constat douloureux mais inéluctable. Y a-t-il eu une perte, une perte irréparable ? Je ne sais pas. C’est un monde qui a été perdu, un monde entier qui ne nous avait jamais appartenu. Et puis, les mondes meurent vieux et renaissent enfants, la vie est cette alternance entre aboutissement et épanouissement. Des yeux bleus me l’ont expliqué en m’offrant une petite pierre que je serre maintenant dans ma main gauche.
Mais il faut comprendre celui que l’on perd et ainsi mieux concourir à sa perte, dans le cas contraire on ne comprendra pas celui nouveau qui arrive de nouveau, scandé par des rythmes inconnus, lancinants. Il faut se convaincre qu’il ne s’agit pas de lénifier une peine ou de remédier à une perte, mais de hisser les voiles vers l’avenir. Il faut être fier de cet affrontement et de cette collision de mondes en transformation, un processus jamais vu, auquel nous participons avec notre autogestion de la lutte et de la production. Et comment donner tort à une telle fierté ? Il s’agit d’un tournant historique, jamais advenu au cours de l’histoire, et cela doit être un fait unique, ou alors ce ne sera qu’une farce ultérieure pour spectateurs stupéfaits, proches mais incapables de comprendre.
Cette aventure bouleversante, sera-t-il possible de commencer à la préparer dès aujourd’hui ? Voilà une question que beaucoup se posent même si en réalité ils l’adressent à quelque chose de plus stable, imaginée comme société future, liberté réalisée, anarchie etc. En matière d’utopie je passe la main, cela n’est pas dans mes compétences. On se réfère ici à l’autogestion de la lutte et de la production comprise comme la destruction radicale du vieux monde, et à cela je veux répondre. On peut commencer dès maintenant uniquement si l’on a compris le pathos de ce dont nous discutons, le battement du cœur révolutionnaire à l’intérieur d’un projet de lutte qui pourrait présenter des enseignes publicitaires inappropriées. Et puisque nous ne débattons pas sur les mots ici, « autogestion » est un mot encore utile et prégnant dans sa correspondance avec le projet que l’on illustre, c’est-à-dire un mot en mesure de se faire comprendre.
Le pathos est la commotion humaine qui nous saisit tous quand le destin nous appelle à une tache destructrice. Dans une époque de projets, de méthodes et de rationalisme, l’autogestion court le risque de perdre son substrat destructif et d’apparaître comme un moyen intelligent et démocratique d’impliquer les travailleurs dans la production. Il n’en est pas ainsi, ce qu’elle nous demande n’est rien d’autre qu’un comportement épique, elle appelle à l’affrontement, à la lutte définitive. Dans cette perspective, les travailleurs ne sont pas conçus comme de viles bêtes qui passent d’une gestion à une autre. C’est une piètre perspective que de garder près de soi un minuscule simulacre du vieux monde productif pour mesurer les distances et les différences. Voilà d’où vient la méfiance, établie une fois pour toutes, vis-à-vis de la science économique.
La nouvelle vie à laquelle cette perspective autogestionnaire fait appel est une expérience non seulement immédiate, de lutte et d’inventions productives, mais aussi intime, impliquant la conscience de tous ceux qui la vivent. Il ne s’agit pas seulement d’une méthode, mais de quelque chose qui dépasse la procédure et s’impose en tant que cœur philosophique d’une société nouvelle, non pas adjacente à la vieille, mais à la place de cette dernière qui doit être anéantie. Dans ce noyau central se maintient l’impulsion à lutter, bouillonnant dans des formes toujours nouvelles. Et à l’intérieur de celle-ci, dans un cercle concentrique privé de limites, se maintient la force productive, l’ensemble des processus qui peuvent non seulement satisfaire les anciens besoins mais en inventer de nouveaux, sans limites, sans que tout soit nivelé par le dénominateur minimum de la misère. Ce cœur battant n’est pas une Acropole à défendre, mais une sorte d’eau limpide, de rêves, de monstruosité, de chaos vivant qui peut tous les jours recommencer depuis le début. En somme, ce que l’on peut imaginer de plus proche de l’anarchie, ici et maintenant, alors que nous nous essoufflons dans la boue politique qui régule et est régulée par la production.
Toutefois, les ruines du vieux monde ne font pas partie de ces choses qui peuvent se liquider avec un simple désir de propreté, d’air libre, d’une vie enthousiaste et différente. Il y a besoin de décisions difficiles à prendre, des décisions qui portent en elles une part du vieux monde, laquelle peut, de cette manière, se faufiler et gagner en espace et en signification. Autogérer la lutte peut être un projet méthodologique indispensable face à la production capitaliste, compacte et presque sans encombre. Dans ces conditions l’autogestion de la lutte se présente – et nous l’avons vu – comme une série d’occasions à mettre à profit, en revanche au moment de la fusion entre lutte et production, c’est-à-dire dans l’autogestion mûre, la lutte, devenant plus intense et généralisée, pourrait prendre le dessus et développer deux dangers. Le premier est une atrophie des méthodes de lutte et même un retour aux formes militaristes traditionnelles. Le second danger c’est que le soutien, cette défense visiblement indispensable apportée à la production, diminue. Cela condamnerait l’effort global à un retour en arrière, à une catastrophe. Se fier à l’accroissement de l’affrontement, et à lui seul, est toujours un pas en arrière. Si la lutte est un ensemble confus au début, et en cela incompréhensible pour l’ennemi, avec les nouvelles nécessités elle cesserait d’être un bric-à-brac pour s’enrégimenter.
Il faut faire croître la forêt, non pas la transformer en un jardin cultivé. C’est dans la forêt que la lutte se développe, en faisant interagir les hommes et les choses, problèmes et créativité, donnant vie à un labyrinthe d’efficacité involontaire, de chaos irrésoluble, d’initiatives – souvent minimes – inconnues et en cela difficiles à anéantir. Cette forêt doit croître en restant luxuriante et imprévisible face à l’ennemi déjà sur le pied de guerre aujourd’hui. Dans la guerre sociale, même dans l’expression de sa généralisation maximale, il n’existe pas un épicentre où diriger toutes ses forces, de même qu’il n’existe pas d’affrontement décisif.
La nostalgie d’un monde passé, où nous étions comme la moelle dans un os rongé par les chiens, est un des obstacles majeurs. On se bloque souvent au cours du processus destructif parce qu’on ne sait pas comment répondre aux sollicitations de la mémoire. Le souvenir des souffrances mêmes est parfois tentant. Après tout, elles ont aussi été une partie de notre vie, et les impliquer dans la remise à zéro produit en contrecoup l’annulation d’une partie de notre vie même. Nous voilà donc démolisseurs à moitié, on veut mais on le regrette. C’est difficile de trouver quelqu’un qui sache utiliser la hache fermement jusqu’au bout. Étant profondément matérialistes, nous avons une foi physique dans la matière, et la détruire nous blesse, même les prisons d’hier ou les chaînes de montages d’un hier plus récent. N’est-il pas mieux d’en faire des bibliothèques ? Et les églises ? Et les musées ? La liste est longue, et dans tous ces lieux les fantômes de ce que nous avons souffert habitent encore. Et ces fantômes nous les aimons et nous ne voulons pas les balayer, ils pleurent sous les coups de la destruction et leurs larmes sont celles de nos peines. Au fond, nous sommes convaincus de l’impérissable persistance de la matière et de la transformation perpétuelle de la vie.
Apprenons à faire nos adieux au passé, à notre passé, pas uniquement celui de notre ennemi – au fond il ne s’agit pas de deux choses différentes. Dans celui-ci ne se trouve pas les fantômes mais notre vie, et celle-ci n’a un sens révolutionnaire que si elle est projetée violemment vers le futur. Il s’agit d’un fardeau que nous devons mettre à terre pour nous regarder dedans avec attention, comme je le fais avec ce livre. Il ne s’agit pas de congé mais de tension. Je suis assez vieux pour pouvoir me le permettre, la vie – désormais brève pour moi – est uniquement dans le futur. Du passé provient l’histoire des atrocités humaines, des atrocités que la bête continue à perpétrer sans s’arrêter, avec les pieds bien plantés dans la boue de la politique.
Continuer à habiter dans le passé, dans les émotions du passé, c’est déjà un puissant frein à la destruction. Mais comment est-ce que je fais pour mettre tant de choses en jeux ? C’est là tout ce que j’ai, me tintent les cloches aux oreilles. Eh bien, renferme-toi dans ta carapace, mon ami, dans cette précieuse enveloppe les malheurs alterneront avec les joies et vice versa, mais tout aura le même poids, tout se compensera et s’égalisera dans une perspective proportionnée à la misère de ta vie. En refusant la destruction on reste prisonniers d’un monde qui finira par appauvrir les nouvelles pratiques – de lutte et de production – même si on est profondément convaincu de se savoir autodéterminer à l’autogestion.
J’ai écouté tellement de plaintes dans ma vie contre les méfaits de l’exploitation de la part de ceux qui auraient voulu la détruire en sauvant ses « meilleurs » réalisations, ou du moins les plus tolérables. Il y a ici un air de bon sens mélangé au sacrifice. Ceux qui assistent à ces prises de bec de poules se rendent compte qu’il y a autant d’esprit qu’on peut en tolérer chez un polémiste français, assez pour le rendre lisible et insignifiant.
Nous sommes face à la vraie folie, celle utilisée pour nous faire définir fous par ceux qui écoutent nos thèses inacceptables. Cette manière de procéder signifie se sauver la face. Puisque nous n’avons aucune face à sauver, nous en sommes là, à déposer par terre le fardeau de ce livre sur l’autogestion.
Entendons-nous bien. D’un côté nous sommes devant l’extrême misère du capital, et de l’autre devant la proposition autogestionnaire de la lutte et de la production. Il faut choisir. Si nous voulons laisser les choses comme elles sont, nos théories mises bien en évidences l’une derrière l’autre, alors il faut vivre avec la misère, celle du capital mais aussi celle de nos pauvres thèses, cooptées par la tornade capitaliste et traitées comme une brindille. Misère du capital, misère de nos thèses.
La misère initiale est infectieuse et conditionne tout ce que nous disons. Même l’esprit extrême des écrivains révolutionnaires (eux se croyaient comme tels) français, s’est évaporé au contact de cette misère. Puisque nous ne voulons pas ajouter de misère à la misère, ou bien nous rompons le cercle, ou bien nous jetons nos thèses à la poubelle.
Pourtant ces antagonismes se sont affrontés, je le confirme personnellement en ce qui concerne les derniers quarante ans. Oui, ils se sont affrontés comme des occasions à mettre à profit dans la misère où ils auraient pu éclore comme des fleurs du fumier. Il n’en a pas été ainsi. Quelques pâles tentatives, et jamais au sens propre de l’autogestion de la lutte et de la production. Cet incident manqué a-t-il eu un sens ? Je pense que oui.
Comprendre une thèse révolutionnaire demande certains éléments qui ne sont pas tous de nature intellectuelle. Il faut être révolutionnaires, c’est-à-dire avoir choisi une vie risquée, contradictoire, problématique, qui se propose en permanence des expériences et les renie pour continuer. Pour les personnes qui ont fait ce choix, cette thèse a des redondances qu’elle n’a pas pour d’autres, peut-être plus intelligents et plus cultivés. Il faut donc que des rencontres fulgurantes se réalisent entre les thèses et les personnes qui font entrer ces thèses dans leurs vies. Cette alliance, aléatoire, produit l’autogestion. La simple lecture de mon vieux livre ou de ces annotations non. La splendeur d’une telle rencontre ne peut pas être décrite, elle doit être vécue. Soudain tout devient plus clair et ce que l’on connaît recommence à vivre, en connaissant dans le même temps ce que l’on vit.
Mais dans le monde, ouvert aujourd’hui à l’obscénité du capital d’une manière qu’on ne peut plus cacher, une idée si splendide, une irradiation aussi puissante, capable de ne s’épanouir que dans la destruction définitive, a même quelque chose de ridicule. Le bon sens peureux de ceux qui ont les pieds sur terre s’insurge soudain pour réprimander ceux qui ont saisi le sens profond de ces mots : Destruction totale et Autogestion. Personne aujourd’hui, pas même les révolutionnaires anarchistes, ne croit à la destruction totale ni ne parle d’autogestion sans se sentir un peu ridicule. C’est précisément cela que ces annotations, écrites dans un endroit où l’on ne connaît pas le sens du ridicule, mais seulement celui de la terrible obscénité répressive, ne comptent pas accepter. La cohabitation splendide du binôme : Destruction totale/Autogestion, peut faire peur, c’est compréhensible. Non pas à cause de son invraisemblance – source habituelle du ridicule –, plutôt à cause de son éloignement radical des deux concepts qui le constituent, une fois séparés. Et c’est de cela que nous allons nous occuper maintenant.
La destruction – dont j’ai longuement parlé ailleurs – ne se résume pas à la lutte autogérée, et ne peut pas être présupposée dans l’autogestion de la production. Au départ, la destruction est un état d’esprit. Le monde s’assèche et nous rampons dans la boue à la recherche d’une source d’eau pure, nous marchons en rasant un mur dans le brouillard et nous ne savons plus où aller. La signification humaine de ces gestes a disparu et ne peut être récupérée. Notre capacité à vivre est étrangère à ce monde, elle a été envoyée en exil. Si on voulait revenir sur nos pas nous trouverions des réalités incompréhensibles, de la moisissure et de l’obscénité. Entre le monde et nous, on a creusé une tranchée impossible à combler où nous nous précipitons toujours plus. Rares sont ceux qui se rendent compte de cette étrangeté, ceux-là sont les hommes de l’autogestion, c’est à eux que revient la tâche de détruire ce qui avale tous les autres.
La disparition d’un monde n’est pas un fait facilement perceptible, elle a lieu, et quasiment personne ne se rend compte du deuil qui nous frappe, qui nous attriste, qui nous rend aveugles et orphelins. Et cette cécité est progressive et irréparable. Nous sommes tous impliqués dans cette chute, même ceux qui la soutiennent et la réalisent concrètement presque sans le savoir, à savoir les capitalistes. Ce n’est pas vrai qu’ils se sauvent dans les châteaux teutoniques du passé. Ce n’est pas la peste, c’est la mort sans couleurs, la mort d’un monde. Il y a quelques décennies, j’ai moi aussi pensé qu’un sauvetage dans ces châteaux perchés leur était possible, plus aujourd’hui. Les conditions de vie ont profondément changé. Je sais bien que quelqu’un pourrait trouver ces mots incompréhensibles, je ne suis pas interclassiste, les inclus détruisent le monde dans leur intérêt exclusif, nous nous le détruirons pour que naisse une nouvelle société autogérée, pour tous, pas uniquement pour les exclus. Dans un monde mourant, dans un monde détruit et privé de sens, cette distinction a un sens. Pour le moment nous piétinons les futures ruines que nous pouvons entrevoir en filigrane dans la stupide pompe du monde multicolore qui endort tous les jours notre fantaisie. Grattons le vernis qui recouvre ce monde et l’obscénité qui est en dessous, la boue politique, le gavage productif insensé et l’effronterie financière sans but verront soudain le jour. Tout ceci est irrémédiablement destiné à périr, cela peut s’éteindre tout seul dans le sacrifice de tous, se noyant ignominieusement dans sa boue, ou le projet autogestionnaire le détruira. Voilà le noyau du problème.
Quel que soit le moyen destructif que nous choisirons, le nôtre aura pour perspective de donner vie à un monde nouveau, alors que la destruction capitaliste a pour unique perspective la survie à court terme, nous sacrifiant tous à la myopie du 3 %. Cet endroit que nous appelons monde doit donc être détruit, il a été rendu malade et inutilisable par la cécité capitaliste, nous n’avons été que complices de ne pas avoir eu la capacité de réagir à temps. Il est trop tard désormais, c’est un autre lieu que nous portons dans nos cœurs, et c’est ce nouveau lieu que l’autogestion veut réaliser.
Le malheur inhérent à ce projet est immense, nous nous en rendons compte, mais il n’y a pas d’alternatives. Il ne s’agit pas d’allonger les chaînes des esclaves, ni de les vernir, il s’agit de les briser, et aucune destruction ne se fait sans sang ni larmes. Mais ce malheur futur, les peines que nous subirons et que nous causerons, ne peuvent pas se mesurer sur la base du malheur passé, ce sont deux mondes différents, incomparables. Demain nous ne pourrons que constater l’absence du malheur passé.
En écrivant ces considérations extrêmes sur l’autogestion je me rends compte que je tire trop sur la corde. Toutefois le temps presse et je veux dire exactement ce que je pense, et pas ce que je peux supposer agréable pour mes éventuels lecteurs. Je suis en train de devenir irrémédiablement étranger à mes hypothèses de travail, après tout j’ai peu d’années devant moi, et je ne voudrais pas que me trompe cette étrangeté plus ou moins proche, se profilant quotidiennement dans l’endroit où je me trouve sous les formes les plus violentes. Voilà donc que je me force à aller un peu plus loin, à être un peu plus efficace. L’autogestion sans destruction du vieux monde est un projet intermédiaire, valide, intéressant, mais condamné à son apparence occasionnelle ou d’expérience productive. Capitalisme et autogestion s’excluent mutuellement. Et pour éliminer le capitalisme il faut détruire le monde qu’il a désormais définitivement phagocyté.
En parlant d’autogestion, sa condition essentielle et effective, la destruction totale du vieux monde, vient subitement à l’esprit. C’est une sorte de règlement de compte où, aux dépens de tous, les souffrances millénaires de certains sont égalisées avec une magnanimité impartiale. Je ne veux pas dire que du vieux monde naîtra un monde parfait, simplement que naîtra un monde nouveau, avec peut-être de nouvelles souffrances et de nouveaux conflits, mais différents.
L’autogestion, produisant un monde différent, se produit aussi elle-même comme structure globale de ce monde venu au jour si dangereusement. Ce que nous appelions avant autogestion était une dichotomie constituée par la lutte et la production, maintenant c’est seulement la société autogérée. Bien sûr, les ombres des problèmes du passé se représenteront et évoqueront des solutions déjà expérimentées comme des échecs, mais cela fait partie de l’affrontement destructif initial. Puis il y aura d’autres conflits à propos desquels on ne peut rien prévoir, les anarchistes seront toujours porteurs de leur message de libération de toutes les contraintes, même dans une société produite par un monde nouveau.
Bien sûr, ces ombres et ces fantômes seront incarnés par des hommes avec lesquels il faudra faire les comptes physiquement, comme cela est toujours arrivé, et par des idées du passé ayant aventureusement survécu au cataclysme destructif, idées qu’il faudra critiquer. Mais cela aussi fait partie de l’élan destructeur. La révolution marche toujours sur les hommes et les idées qui ne comptent pas l’accepter. Au cours de la révolution tous perdent quelque chose qu’ils ne peuvent retrouver, ils y trouveront quelque chose d’autre, peut-être le monstrueusement autre, personne ne peut garantir des oreillers de plumes. Toutes les souffrances de ceux qui ont subi les coups de la férule sous l’esclavage se montrent denses dans la destruction, pas que leur idée qui redevient un épouvantail pour les vieux responsables, mais concrètement. Les esclaves n’avaient rien sinon la peau aplatie par le fouet. Les capitalistes d’hier, après la destruction procurée de manière généralisée par l’autogestion, n’auront plus rien, ne pouvant même pas, en l’absence de fouet, offrir leur peau. Les oubliés, les pauvres – quel triste mot –, les vaincus, en somme cette grande masse d’êtres humains que les capitalistes utilisaient comme de la chair à canon, entreront eux aussi dans la destruction, et c’est à l’intérieur de cette énorme catastrophe généralisée qu’ils perdront non pas les richesses qu’ils n’ont jamais eues, mais l’intériorisation de leur misère, leur statut de derniers, d’oubliés.
En somme, bien loin du tableau idyllique d’une autogestion résumable par de grands théorèmes d’autodétermination concernant la lutte et la structure productive, celle-ci apparaît désormais dans son habit révolutionnaire de l’implication générale de tous, sans exception, dans la destruction. Au cours de cet événement historique nous mourons tous, peut-être pas de la mort physique, qui, au fond, serait pour chacun de nous l’événement le plus étranger, mais d’une mort concernant ce que nous sommes, révolutionnaires partiels en premier lieu. Le comble de la tristesse se transforme en comble de la joie. Le projet, tout d’abord ridiculement inadapté à son but radical, s’étend et permet de faire voir les premières traces de ce qui il y aura après, la production autogérée, et bien davantage.
Je ne prétends pas être convaincant, je sais bien que parmi ceux qui m’ont harcelé toute ma vie, quelqu’un se demandera si ce n’est pas une utopie à l’envers, me réduisant au silence, moi qui déteste tout type d’utopie. Eh bien, ce n’est pas ainsi. Si l’on parle d’« autogestion », c’est de ce bouleversement du vieux monde que l’on est en train de parler, pas de quelque chose qui nous est familier et que nous pouvons, aujourd’hui même, presque toucher du doigt – luttes intermédiaires, voire insurrectionnelles, et production autodéterminée ou cogestion –, mais d’une réalité qui nous est étrangère, ici, dans le monde de la boue politique et capitaliste. Et puis, le fait de ne pas être des habitués des combats révolutionnaires – certains se limitent à les noter sur la carte en faisant des allers-retours historiques – ne nous retire pas le permis de détruire, pour la simple raison que personne ne nous l’a jamais donné.
Je comprends qu’il faille une certaine largeur de vues, sans incommoder une largeur de pensée, pour se rendre pleinement compte de ce que nous sommes en train de dire. Il faut aussi ce que je définirais comme un optimisme mélancolique, c’est-à-dire une sollicitation vers la catastrophe destructive totale, voulue par nous, selon le projet autogestionnaire, et non pas imposée cyniquement par le capital, à sa manière et avec ses temporalités.
Et pour accepter cette perspective, en plus d’une connaissance profonde du monde dans lequel nous vivons, de sa pauvreté, de son irrémédiable décadence, un monde qui de lui-même appelle à grands cris sa liquidation, il faut une grande confiance dans le projet insurrectionnel et autogestionnaire. Les sculpteurs et ceux qui relèvent les détails pouvant encore être sauvés sont légion, nous n’espérons pas les convaincre. Qu’ils abandonnent ici la lecture s’ils l’ont jamais commencé, et aillent employer leur temps ailleurs, l’assistance sociale est un grand fleuve qui accepte n’importe quel ruisseau.
Si nous réduisons à zéro la perspective autogestionnaire que nous traçons ici, nous réduisons nos tentatives même de lutte intermédiaire à de pâles reflets d’un projet plus grand, mis de côté par peur ou par complaisance envers la tradition syndicaliste révolutionnaire, du moins en ce qui concerne le thème qui nous occupe. Loin de la destruction comme programme total, la lutte s’assèche, et la production, qui pourrait tenter de s’autogérer, s’évanouit dans les bras de la cogestion. L’idée fondatrice de ce merveilleux projet jette ses bases dans le futur, et c’est là qu’elle deviendra pleinement compréhensible. Aujourd’hui, c’est comme si l’on parlait d’une merveille que personne n’a jamais vue, que l’on ne peut pas détailler si on ne veut pas tomber dans le ridicule. Cette merveille est aujourd’hui absente, nous parlons donc d’une absence, voilà pourquoi nos thèses sont dès le départ condamnées à être une version diminuée, hachée, qui se traîne péniblement et ne convainc que ceux qui se procurent d’eux-mêmes les moyens pour se convaincre. Ce dont nous parlons, qui apparaît comme le dernier morceau de la terre radicale où s’enracine la terrible plante de la destruction, est au contraire un pâle réflexe atténué, quelque chose qui transparaît dans les mots mais est privé de chaleur et de vivacité. Les éléments manquants sont inépuisables, nous qui nous les préfigurons, nous restons sidérés par leur extension et par leur enchevêtrement réciproque.
En pénétrant dans cette majestueuse intrigue, tous les éléments que je peux choisir – par exemple, la sélection des biens de subsistance immédiate à exproprier et pas à détruire – apparaissent paradoxalement appauvris par la faible lueur qui filtre dans le climat ouaté et fatigué qui nous héberge (pour une fois je ne fais pas référence au camp d’où j’écris ces lignes).
De l’exercice précédent, pas moins malheureux, disons, que les autres que nous aurions voulu choisir, il en ressort, comme le lapin du chapeau, le problème de la phase transitoire, centre obscure et marécage méphitique de tout projet révolutionnaire. Si j’imagine cette phase comme une grande fête, dans le sillage de l’expérience de Bakounine, je pourrais être contredit facilement. Si je l’imagine comme un abattoir à monter d’urgence, parce qu’on commence à couper des têtes à la hâte, je pourrais être accusé de laisser libre cours aux vengeances individuelles, avec les misérables bavardages qui s’ensuivent. Si je l’imagine comme une vaste étendue de décombres et de champs de cabanes, je pourrais être pointé du doigt comme un partisan du pire c’est mieux c’est.
Le problème, c’est que nous n’avons pas connue la destruction totale, elle appartient à l’autogestion réalisée, donc au futur. Ce que nous connaissons, c’est une série immense de destructions partielles, commises par le capital, donc un amas informe d’hommes vivants et morts, de choses démembrées gisant et abandonnées, d’animaux en putréfaction. Mais ce sont des réalités qui ne peuvent pas être comparées. Ce que le futur peut réaliser, c’est-à-dire la destruction totale autogérée, ce n’est pas un sérail de merveilles, les responsables de l’exploitation finalement châtiés, mais quelque chose d’inimaginable.
Que ceux qui veulent pleurer sur cette énorme quantité de lait que nous verserons le fassent, ils ne s’en rendent peut-être pas compte, mais ils sont indirectement les assistants de l’état de misère et d’exploitation actuel. Ils pleurent, croit-on, pour les souffrances endurées, pour la destruction réalisée par le capital, pour l’immonde nécropole politique qui nous étouffe, ils peuvent pleurer sur une grande série de choses. Ainsi, la masse des méfaits du capitalisme peut finalement se transformer en une perspective de libération, à condition que tout soit renversé, même si de cette façon tous pleureront une perte, certains leurs richesses et d’autres leurs chaînes.
Nous devons nous rendre compte de la puissance visionnaire qu’il faut pour parler d’autogestion, en contrepoint polémique avec le livre que j’ai insisté à présenter de nouveau. Et dans celui-ci cette puissance est sûrement manquante, même en faisant allusion à tout ce qu’il faut pour lier la production autogérée à la lutte. Ce que nous avons entre les mains, c’est notre patrimoine de luttes, mais bien que développées insurrectionnellement, elles sont trop nivelées par l’absence de la destruction totale, à laquelle cependant elles renvoient inévitablement. Nous luttons en serrant dans les mains, ici et maintenant, nos misérables possessions, alors que la production dépérit dans des camps séparés, où siffle la férule du capitaliste. Même si les douleurs sont innommables et que notre rage explose avec férocité, il n’y a pas de rapport avec la destruction totale, sinon à travers la vision de la monstruosité indicible. Cette chose dont il n’est pas possible de parler me pousse à l’action.
Décrire un panorama inconnu duquel nous n’avons ni les proportions ni les couleurs est désespérant. C’est grotesque d’insister dans un travail de Sisyphe. Je sais que même cette justification à continuer est branlante et a besoin de plus d’un soutien pour au moins réussir à boiter. C’est mon destin de me lancer dans d’impossibles aventures.
Il y a des conditions qu’il est possible d’imaginer même dans les détails, et des conditions qui se réfèrent à une atmosphère inimaginable. Ces dernières exigent une vision d’ensemble – pratique et théorique – qui ne trouve pas de pendants dans ce que l’on a sous les yeux, même si c’est de cela qu’elle provient comme conséquence monstrueusement différente d’un événement traumatique radical. Cela, c’est l’autogestion réalisée sur les décombres que la destruction totale a généralisée dans le vieux monde. Il faut donc s’installer dans une telle dimension, non pas avec la simple fantaisie – ce serait une véritable utopie – mais concrètement sur la base de ce que le vieux monde met à disposition, sélectionnant ce que l’on doit exproprier immédiatement pour rendre possible la mise en route de l’autogestion généralisée, et ce qui doit être détruit immédiatement, hommes et choses. Rien de cela, la boue politique et capitaliste en somme, ne peut être considéré comme un gage du projet destructif. Plus rien n’est à vendre, et rien ne se paie, il n’y a donc personne qui puisse se porter garant pour quelqu’un d’autre, chacun règle ses dettes et ses crédits, tout est remis à zéro et recommence du début, à partir de l’organisation autogérée de la production et de la consommation des biens préventivement expropriés.
Une logique perverse insiste sur la durée limitée de ces biens expropriés et sur la lenteur avec laquelle on peut organiser les nouveaux procédés productifs. Il y a ici autant de vérité qu’en trouvent d’habitude les bien-pensants face à tout exploit désespéré. Mais la raréfaction même des possibilités de réussite amène nécessairement avec elle une radicalisation des comportements, il ne peut pas y avoir de temps pour les hésitations ou pour les meilleurs choix esthétiques. Tout doit naître à nouveau, ce sera donc un monde qui émet des vagissements, non pas des mots ni des discours. Si l’on veut parler d’autogestion, c’est donc dans cette atmosphère nouvelle qu’il faut descendre. Il faut briser la balance des pour et des contre immédiats, sur laquelle nous pesons en permanence le quotidien avec la responsabilité que nous assumons depuis toujours, celle qui veut à tout prix réduire les dégâts. Eh bien, il faut finalement être irresponsables, le passage à la destruction totale est ce renversement, c’est seulement ainsi que les choix sont plus acerbes et déterminés.
La levée d’un processus de renversement global n’est ni identique ni aussi simple que la main qui frappe ou anéantie ce qui nous opprime. Mille mains peuvent se lever dans ce geste libérateur sans que rien n’arrive. Quel est alors le mystère qui opère à l’intérieur d’un mouvement historique sans précédent comme l’autogestion généralisée ? Le fait extraordinaire c’est que souffrances et jouissances sont remises à zéro de la même manière. On n’hérite pas d’une condition confortable pour en profiter, on n’exproprie personne – sinon l’insignifiante mais nécessaire partie des biens de consommation immédiats – mais on porte à son achèvement, dans une tout autre direction, la destruction que le capitalisme avait obstinément commencé pour garantir ses intérêts. La vengeance est ainsi amenée au cœur même du capital, dans sa manie insensée de considérer le monde entier comme sa possession. Le monde est au contraire déclaré vieux et inutilisable, presque totalement, et est renversé dans le monde nouveau.
Ne se limitant pas à substituer un bout de la machine obscène, l’obscénité même de la machine est portée à ses conséquences extrêmes, donc détruite, supprimée, anéantie. Il y a une rencontre secrète et monstrueuse entre la destruction en cours, menée par le capital, et la destruction totale future que mènera l’autogestion généralisée. Et cette circulation souterraine ne peut pas être saisie dans une exploitation spécifique ou dans une action particulière de lutte intermédiaire, celles-ci demeurant bien séparées l’une de l’autre.
Dans le monde nouveau, une incompréhensible cohésion de décombres voit ainsi le jour, celles de la boue et celles qui mettent fin à la boue. Nous n’aurions jamais pu aspirer à la destruction totale autogestionnaire si le capital n’avait pas déjà détruit une partie considérable du vieux monde, nous nous serions toujours limités à la perspective d’une expropriation des moyens de production et à un projet d’organisation productive différent. Dans cette rencontre monstrueuse on vient à mettre en évidence les grandes possibilités de la destruction comme un présage de la création de la société nouvelle.
Les souffrances de l’exploité soldent-elles ainsi les jouissances de l’exploiteur ? Pas exactement, parce que les deux termineront dans l’autogestion, où le pouvoir sur les hommes ne devrait pas être possible. Dans le cas contraire il faudrait recommencer du début, et cela, les anarchistes le savent bien. Chaque remise à zéro est toujours un échange complice de possibilité. En détruisant la forme et la substance de l’exploitation on rend la jouissance accessible même à ceux sur qui la férule sifflait avant, et en détruisant la jouissance des privilégiés on rend possible pour tous une production sans exploitation. Nous sommes entrés dans la zone obscure de la destruction, ici, il n’y a pas de séparations, sinon celles provisoires à la charge des imbéciles qui ne sauront pas saisir la transformation historique en cours. Au fond, le mètre avec lequel mesurer le monde nouveau ne sera pas la guillotine.
À ce stade mes quelques lecteurs peuvent se diviser en deux groupes. Le premier s’intéressera seulement aux processus destructifs – seulement avec la fantaisie pour le moment – le second seulement aux nouveaux procédés productifs – ceux-ci aussi avec la fantaisie. Je m’excuse, mais je ne me rallie ni à l’un ni à l’autre. Si cette séparation advient, c’est que l’on n’a pas compris le côté obscur de cette précipitation dans l’autogestion, à corps perdu et sans garantie. Bien sûr, je me rends compte qu’il est dangereux de penser cette condition inimaginable, mais c’est justement de cette hypothèse qui met mal à l’aise que nous parlons. L’intelligence moyenne, éduquée aux précautions et aux prudences, n’a pas accès à cette zone obscure, et si par hasard elle y sombre, elle se sent inadaptée. Les concepts qu’elle manie sont ceux du petit à petit, et le tout et tout de suite l’écœure.
Il est bien sûr possible de s’arrêter sur le seuil de cet événement historique, à une condition : collaborer avec l’exploitation, aujourd’hui, de manière à ce que ce principe ne s’ouvre pas et que tout se maintienne en équilibre entre être et avoir, en attente d’un autre genre de catastrophe, celle que le capitalisme met en scène sans pitié pour personne.
Le fait est que beaucoup préfèrent se noyer dans l’ennui, dans l’angoisse, dans la tristesse, et finalement chuter sous l’influence de l’exploiteur, plutôt que de déchaîner un conflit historique. Au fond, si l’on creuse, il y a dans la délégation du commandement productif le désir de ne pas penser. La pensée est trop lourde, mieux vaut la mendicité et la servitude. Bien au-delà de l’échange capitaliste, observable à la superficie par la médiation fictive de l’argent, il y a cet échange réel qui structure le monde, souffrance contre survie. C’est comme ça que la vie avance en foulant ses possibilités, s’estropiant pour ne pas courir, une sorte de rythme méta-historique qui n’est pas facile à comprendre en suivant les deux filières séparées, celle de la défense productive – de la part de ceux qui estiment avoir besoin de l’exploitation –, et celle de l’attaque productive – de ceux qui ont réellement besoin de l’exploitation pour dominer et garantir l’avenir du projet capitaliste.
Ce stupéfiant mécanisme trouve son origine dans le crime même que l’homme est capable de réaliser, que ce soit dans le rôle de perdant ou d’oppresseur. Cette boue, dont la putréfaction politique est un exemple éclatant, s’accumule infiniment, interagissant sans trêve avec d’un côté tous les projets de libération et de l’autre avec ceux productifs. Ce rapport peut être perpétuellement soumis à la maintenance pour mieux fonctionner, mais, structurellement, il reste toujours le même. Rien ne peut l’éliminer, l’effacer, parce que cet effacement effacerait le monde. C’est justement cet effacement que nous voulons, entendu différemment – c’est-à-dire en laissant ce monde sur pieds comme il est ou en continuant à le soumettre périodiquement à la maintenance – cela n’a aucun sens pour nous.
C’est cette connivence qui ouvre en moi une blessure large et profonde, sitôt que je me rends compte que je suis complice des crimes qui tissent l’histoire de l’homme avec une monotonie répugnante. Il n’y a pas moyen de soigner cette blessure qui, au contraire, pourrie toujours plus en l’ignorant ou en recourant aux distractions fournies par le capital entre deux coups de fouets. Dès que ma conscience s’en aperçoit, c’en est fini pour moi, mon rôle d’homme actif est terminé, il ne me reste plus qu’à mourir un peu chaque jour en faisant semblant de vivre. Dans cette funèbre perspective, l’autogestion, pensée correctement, élimine l’antidote du doute. Les valeurs sacro-saintes du capital et de la boue politique sont finalement dénoncées au grand jour, il n’y a plus de connivence volontaire, mais seulement des complicités volontaires. Et de celles-ci on ne s’échappe pas, on chute avec elles.
La majorité des esclaves alimente contre l’exploitation une acrimonie mensongère, qui croît toute la vie, jusqu’à l’âge de la retraite. En règle générale, cette amertume accélère l’existence sans que l’on ne s’en rende compte, elle l’appauvrit, la froisse et la réduit à une épave, alors que la famille recouvre ses hontes avec un enduit de respectabilité, même dans la répartition différente mais équitable des responsabilités sexuelles, à chacun sa part. Privés d’une issue destructive concrète et totale, les sursauts rebelles qui étincellent ici et là dans les luttes intermédiaires vrillent sur eux-mêmes et macèrent dans la recherche du projet le plus pur et cohérent. La récupération de cette immense potentialité de révolte est une des industries les plus florissantes.
Par le passé, nous avons vu de quelle manière on peut classer les responsabilités de cette récupération et de l’inaction substantielle. Et cela a été un travail utile, mais pourtant, comme les luttes intermédiaires, il ne peut suffire. Le vrai responsable, au-delà du syndicat ou du parti, c’est l’exploité lui-même, au minimum coupable de ne pas s’insurger et de mourir. L’attitude triomphante des capitalistes est là pour démontrer cette remarque critique amère. Ils ont remporté leur bataille en réussissant petit à petit à détruire le monde. La triste advenue de ce crépuscule du vieux monde, qui commence à se vider de l’intérieur comme une pomme pourrie, maintient en vie une incroyable aura de bienfaiteur autour de la figure du capitaliste. Et ceci est la dernière farce, le toucher final comique de la tragédie qui nous entoure.
Mais une telle perspective de renversement radicale, de destruction totale, peut-elle qualifier dans un sens positif la société autogérée qui en sortirait ? Il n’est pas possible de répondre à cette question, à laquelle nous ne voulons cependant pas fuir pour deux raisons. La première c’est que nul ne possède la raison absolue, aucune réalité ne naît bonne dans toutes ces parties, pas même l’autogestion généralisée. La seconde c’est que dans l’autogestion tout doit être réinventé depuis le début – sur de nouvelles bases évidemment –, lutte et production, et il n’est pas dit que ces bases naissent invétérées à la bonté des hypothèses autogestionnaires. Aucune flatterie, nous retournerons lutter même dans des conditions différentes, contre toute nouvelle idolâtrie. L’homme de la condition à venir est inondé par l’autogestion – au même titre que les choses qui l’entourent comme disiecta membra –, il est saturé par ce qu’il faut réaliser de nouveau, à savoir presque le monde entier. Mais c’est toujours une bête méchante, et étant donné qu’il est impossible que les expériences passées disparaissent dans le néant, même dans un monde complètement transformé, il pourrait trouver entre les plis, même sans le savoir, la possibilité de reconstruire le mécanisme avec lequel couvrir de boue la réalité, le mécanisme politique. La vie même de cet être méchant peut lui suggérer les voies souterraines de la prévarication. S’opposer à ces nouveaux projets sera le but du front interne à ouvrir immédiatement alors que l’on réalisera les processus autogestionnaires généralisés.
Le monde nouveau n’est pas régi par une harmonie cosmique établie une fois pour toutes, c’est toujours un monde de l’homme et il hérite des caractéristiques de cet animal extraordinaire, capable d’actions sublimes et d’atrocités sans limites. Mais c’est toujours un monde nouveau, où chaque faiblesse peut se retourner en son contraire, dans un processus au cours duquel ces renversements ne sont jamais bilatéraux mais multiples, interagissant entre eux dans un réseau pratiquement infini. Ce n’est pas un modèle déjà connu que nous traçons, nous sommes dans la zone obscure de la vie sociale, et ici la mauvaise volonté n’est, a priori, qu’un jeu stupide et absurde. Il faut pénétrer dans les moments singuliers de ces projets, dans les liens qu’il produit, et admettre que son extrémisation radicale est plus que raisonnable, celle-ci étant désormais l’unique voie à parcourir si l’on ne veut pas aller à la rencontre de l’autre destruction, celle privé aveuglement d’issues, voulue par les mécanismes capitalistes.
Ne pas emporter de bagages avec soi, ne plus rien posséder qui tienne compagnie, qui réconforte et nous identifie pour ce que nous sommes, voilà ce que signifie s’immerger dans ce nouveau territoire. Les décombres sont l’unique propriété commune imaginable, mis à part quelques restes de survie immédiate. Ce que l’on possède désormais c’est exclusivement ce que l’on est, mais l’on est ce que l’on produit de manière autogérée. C’est ainsi que naît une nouvelle intimité avec les choses qui finissent par prendre le dessus sur les ruines, une intimité non pas d’usage mais de collaboration fraternelle. Ce sont des choses qui deviennent familières à l’homme, pas ses ennemies incompréhensibles, et qui ne lui parlent plus dans la solitude mais dans la nouvelle affinité collective réalisée. Ce qui commence à se profiler n’est plus un fantasme de l’esprit, mais des productions concrètes et autant de destructions concrètes. Le nouvel homme producteur né, l’homme vieux meurt, et s’il ne veut pas mourir, on l’oblige à chuter avec le vieux monde qui cherche à tout prix à se maintenir en vie.
Ce renversement radical n’est ni un prétexte ni un artifice pour éliminer le capitalisme, ce n’est pas une radicalisation têtue des luttes intermédiaires, avec une meilleure utilisation de la dynamite, la guillotine en plus. C’est un passage obligé, avec des pauses plus ou moins longues, où l’intervention directe pour mettre préventivement hors d’usage les éléments les plus inflexibles de la répression capitaliste est secondaire, bien qu’elle ne soit pas superflue. Je me réfère ici aux actions insurrectionnelles réalisées avant l’autogestion généralisée, qui tendent à cette exclusion, même si souvent, au niveau analytique, il semblerait qu’elles n’en soient pas conscientes. Ce qui court le risque de rester vague et indistinct – parce que la réalité de l’affrontement a milles contrepoints inconscients qui la rendent telle – rentre d’un coup dans le grand index révolutionnaire de l’autogestion et n’est plus une petite source d’eau isolée dans le désert, mais un grand fleuve qui emporte et débarrasse toutes les machinations et toutes les incertitudes. Il n’y a pas de doctrine révolutionnaire capable de distiller ce renversement, il n’y a pas un ton juste avec lequel l’hurler aux quatre vents. Dans tous les cas ces possibilités éventuelles arriveraient toujours trop tard. D’ailleurs, il est stupide de parcourir toute la vie avec les yeux fixés sur ce nœud essentiel, paralysés par l’attente, c’est un moyen royal pour disséquer toutes possibilités de réalisation du monde nouveau.
La destruction est une forme de consommation, violente et immédiate. Je parle de la destruction totale autogestionnaire. Au contraire, celle que le capital réalise est lente, mais avance vers un abysse privé de futur, vers la suppression pure et simple du monde, et non pas vers la création d’un monde nouveau. En restant dans les termes économiques du capital, la consommation est l’antécédent logique de la production, loi qui est valide justement parce qu’elle appartient aux choses en général, et qu’avant d’être formulée par l’économie, elle est la loi de la vie. Pour autant, l’autogestion productive suit le type particulier de destruction que nous avons présagé, elle ne peut pas se greffer sur le tronc pourri de la destruction capitaliste.
J’ai du mal à m’imaginer être compris, cela ne m’arrive pas souvent et je ne vois pas pourquoi cela doit arriver maintenant, face à un fait d’une telle portée. Mais puisque je me suis habitué à cette condition de travail tragique, je continue. Je pourrais lancer un appel lancinant : s’il vous plaît, arrêtez-vous un moment pour réfléchir. Étant donné la situation objective dans laquelle je me trouve, ce pourrait être les dernières lignes que je vous adresse. Mais ce ne serait qu’un subterfuge pour réclamer de l’attention par la pitié. Loin de moi les sépulcres blanchis.
L’existence pure de la nécessité ne suffit pas pour produire à partir des décombres généralisés, parce que cette production vient au jour sous forme autogestionnaire. Bien sûr, vu le panorama global, il y a tous les présupposés, mais il n’y a pas de rapports de cause à effet obligés. La hantise, pour se limiter à celle-ci, est un élément de retard ou de confusion programmatique, un mauvais conseiller pour celui qui travaille sur les décombres. Il y a en celui-ci un élan pour établir une échelle de graduation qui pourrait être fausse. Les bénéfices de consommation que l’on attend de la nouvelle production doivent provenir de loin, non pas du passé mais du futur. Je veux dire que c’est aux relations de soutenir les choix qui vont s’entremêler de la part des différentes expériences autogérées, non pas les cadres stéréotypés des besoins du passé. Le gain béat du capitaliste n’existe plus, ce n’est pas lui qui régit les expérimentations, mais c’est la libre coopération entre unités productives non concurrentes. Unités qui sont en même temps les destinatrices de la production, c’est-à-dire des unités de consommation.
Dans ces conditions, sans oublier les décombres sur lesquels on est contraint de travailler, l’expérimentation productive est différente de ce que l’on connaît sous ce nom. Il y a dans celle-ci une image rêvée différente, extravagante, peut-être inutile du point de vue strictement lié à la satisfaction de certains besoins, et cela parce que même ces besoins sont soumis à de profondes transformations créatives. De cette manière, production et consommation pourrait se rencontrer sur un territoire incognito, et ne pas se reconnaître directement, alors que l’élargissement du réseau productif et de consommation pourrait développer d’autres rencontres, a priori impensables, porteuses elles aussi d’autres transformations antérieures. Le rêve se transforme en produit consommé, et ce mécanisme de la vie, indignement appauvri sous le capitalisme, pourrait donner naissance à d’autres rêves et à d’autres consommations. Une fois que l’on a commencé à construire sur les ruines, la croyance dans la correspondance a priori entre consommation et production, pourrait être mise de côté.
Vu que l’on part des ruines, il n’y a aucune raison pour accepter un brouillon productif archaïque. Au fond, la culpabilité originaire de l’aliénation de la valeur de la matière brute au moyen de l’esclave n’existe plus, nous sommes désormais dans des conditions différentes. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas courir le risque de punir en ayant recours à des modèles du passé, désormais nécessairement contradictoires. La grande soif de nouveauté et l’inévitable désillusion qui découle d’erreurs et de résultats ne répondant pas aux attentes, peuvent générer cette volonté de se punir.
Il faut ici éclaircir l’équivoque naturelle, l’autogestion ne peut pas se fier à la spontanéité et affirmer ainsi suivre la nature. De quelle nature ont-ils parlé, et continuent-ils à parler, tous ces faiseurs de bavardages ? La nature humaine n’est certainement pas un bon terrain pour nourrir de grands espoirs. La nature, dans le sens du monde nouveau, doit être reconstruite quasi intégralement, à partir de zéro. La boue est toujours au virage, et l’œuvre d’autogestion éducative est encore à inventer, ne pouvant compter que de manière négligeable sur la pédagogie libertaire.
En effet, la possibilité d’une réémergence de la boue politique telle que nous la connaissons est lointaine, mais il existe des catégories boueuses qui sont encore peu connues et qui pourraient proliférer. L’homme est un animal trop dangereux pour compter sur sa capacité spontanée à s’orienter vers le bien. L’anarchie connaît profondément les plaies de l’âme humaine, parce qu’elle part du refus de tout principe archétypique, ce qui ne veut pas dire qu’elle est incapable de programmer et de réaliser des processus de transformation autogérés, et visant à rendre accessibles des zones de sensibilité que l’homme ne réussirait pas à atteindre spontanément.
Vivre dans une société autogérée de manière généralisée constitue déjà un programme de ce type pleinement en acte. Plus la conscience participative de l’autogestion croît, et plus la tendance vers le mal inhérente dans l’homme s’atténue. Réaliser le mal signifierait se frapper soi-même en frappant son semblable, lié comme on est par le processus autogestionnaire dans son ensemble. Cette croissance éducative autogérée ne constitue pas spontanément la profonde diversité qui pourrait se produire à l’intérieur de la créature humaine, mais le parcours est long, et on ne peut le mesurer avec les temps historiques.
De la même manière, une nature réhabilitée sur les ruines de celle du passé, ne signifie pas création d’innocence, une arcadie où insérer le nouveau monde autogéré. Ce sont des hypothèses ridicules qui ne méritent pas d’être discutées. L’autogestion généralisée est une condition hautement artificielle, techniquement avancée, mais capable de créer cette toile interrelationnelle qui rêve et invente l’imprévisible, qui ne copie pas et ne veut pas seulement modifier le vieux monde, en l’améliorant. Chaque hypothèse d’innocence humilie le projet autogestionnaire et le réduit à une utopie bucolique.
Il y a une sorte d’insolence de la part de ceux qui prétendent domestiquer l’homme et la nature, les réduisant à leurs diktats d’allègre insouciance. Et l’énorme abysse des méfaits passés ? Disparu dans la destruction totale, pourrait-on me répondre, et à raison. Pourtant, ce qui réapparaît dans chaque chose détruite, subsiste dans l’âme humaine, et s’y tapit comme une bête avec laquelle il faut faire les comptes. De même pour la nature. Longtemps violentée, elle ne pourra pas se représenter dans le monde nouveau exempte de coups, les conséquences de l’ancien usage aveugle des ressources ont laissé leurs traces partout, et les ruines ne peuvent les couvrir que jusqu’à un certain point. Le mal de l’homme serpente sous la forme finalement libérée du monde nouveau, et le mal de la nature s’oppose à lui. Personne n’est innocent, pas même ceux qui décideront de commencer à sauter d’une liane à une autre.
L’autogestion permettra la croissance d’une conscience énorme qui aura beaucoup de chemin à parcourir jusqu’à sa complétude, elle devra même – et parallèlement au résultat positif – donner jour à la mélancolie de ce qui a été perdu. Le vieux monde, avec tous ses problèmes et sa boue, avait de hautes expressions d’humanité et de culture qui aujourd’hui – après la destruction totale – ne pourront plus être intelligibles, sinon par fragments. Une splendeur mélancolique, un coucher de soleil qui rappelle quelque chose dont il ne sera plus possible de parler. Et cette splendeur émane de cette destruction même, des ruines, mais pour les producteurs autogestionnaires ce ne sera que des ruines, toute intention archéologique ayant disparue à tout jamais. Le fait est que, dans le monde nouveau, il faudra réinventer la joie, et cela ne sera pas possible suite à n’importe quel projet autogéré. Comment naît la joie dans un monde qui l’a supprimé en même temps que le monde précédent, qui ne la conservait et ne l’utilisait presque que pour apaiser la douleur de l’exploitation, ou pour donner un sens au résultat obtenu par l’exploitation elle-même ? Dans cette direction, non seulement on avance avec peine, mais on encourage aussi les contre-tendances. Pour un contresens plus que compréhensible, un monde productif nouveau cherche à tout miser sur les choses et sur la vaste toile de corrélations qui permet la créativité nécessaire à la progression et à l’extension de la production autogérée. Il en dérive une faible propension pour l’équilibre indispensable entre choses et âme humaine, et cette dernière, rompant les hésitations, pourrait fuir dans une recherche abstraite du spirituel, un refuge comme un autre contre le danger d’aplatissement sur les choses. Une vie angélique est déjà connue aujourd’hui dans les petites communautés, encerclées par le capitalisme. Les États-Unis sont l’endroit où ces sectes, ayant fui dans le spirituel, prolifèrent plus qu’ailleurs. Ce pourrait être une impasse et un obstacle, un parmi tant d’autres.
Tout inventer du début est difficile, écouter le bruit assourdissant de la chute des vieux dieux et se savoir assignataires d’un but énorme ne l’est pas moins. On pourrait répondre à cette difficulté par un travail de routine, machinal et répétitif, utilisant le modèle autogestionnaire classique et ne s’efforçant pas de donner vie à la partie essentielle : l’innovation. Le danger de l’activisme pur et simple, froid, visant à mener à terme son but, est peut-être pire qu’une peu probable contre-mesure capitaliste. Le rythme d’autrefois, imposé et obligatoire, banalement autodéterminé aujourd’hui, pourrait revenir par la fenêtre après avoir été mis dehors par la porte. Ainsi personne ne nierait le monde nouveau, au contraire, il en ferait partie à plein titre, mais contribuerait à l’étouffer avec son apathie, avec son enthousiasme d’employé au cadastre. Comme un pantin fou, ce producteur se recroqueville sur ses rêves, un sourire hébété aux lèvres.
Courrons-nous le risque de construire un monde nouveau de pantins fous ? Ce qui est sûr, c’est que c’est un objectif extrêmement difficile de jouer deux rôles, l’inventeur créatif et le producteur de choses qui aujourd’hui reçoivent une prégnance différente de l’échange capitaliste classique. On peut être disponibles, bienveillants, condescendants vis-à-vis du projet, mais on reste malgré tout des hommes, avec toutes leurs limites et leurs atrocités. Reconstruire sur des bases inconnues peut déchaîner des mécontentements horriblement catastrophiques. C’est un autre problème.
Parfois, dans les battements d’ailes des utopistes, il a été dit que la spontanéité ressort de la simple autodétermination associée à un changement des conditions sociales, où l’exploitation n’existe justement plus. Ce pourrait être une banalité titanesque. Il n’y a rien de rituellement obligatoire dans la liberté, pas même la liberté elle-même, qui est une conquête, et non pas de l’air qu’on respire involontairement. Il ne suffit pas d’affirmer que l’adoption d’un processus autogéré produit automatiquement des créations nouvelles et des formes productives jamais vues auparavant. Tout cela est possible, mais demande beaucoup plus que la simple volonté de le vouloir. Et ce beaucoup plus sort avec difficulté et avec souffrance de la réalité qui imprègne le monde nouveau, il n’est pas irrésistiblement mis au monde par le changement des conditions productives. Dans les utopies qui ont recours à des affirmations comme celles proposées ici, la puérilité et l’insistance sur des détails non essentiels sont désarmantes, et montrent la tentative de remplir le rien avec des fantaisies désolantes.
Dans la condition généralisée de l’autogestion, l’affrontement devrait à mon avis continuer. Affrontement de mentalités et de consciences différentes, affrontement de persistances pas assez démolies, affrontements de projets et non plus d’ambitions, affrontement de turbulences d’humeur mais aussi de théories productives, de systèmes et de procédés, de retrouvailles et de transformations. La lutte c’est vie, et la considérer définitivement achevée c’est la mort, la mort de la créativité. De toutes celles que l’homme parvient parfois à exprimer, cette dernière est la forme qui se prête le mieux à la vie. Ce n’est pas du bonheur d’une ataraxie ennuyeuse et insupportable qui peut sortir de l’autogestion dont nous discutons, mais de l’étouffant processus humain de construction du monde nouveau sur des bases différentes, ni facile ni même en soi satisfaisant de la même manière pour tous. Il n’y a pas besoin d’une grande clairvoyance pour se rendre compte de ces difficultés, et il est aisé de comprendre que c’est justement dans celle-ci que réside la richesse créative pour laquelle on lutte, et la possibilité même de donner vie à des procédés productifs jamais vus auparavant.
En général, les hommes fuient l’ennui ou la peur, dans le bouleversement du quotidien la majeure partie d’entre eux épuise leurs forces et il en émerge parfois une flamme imprévisible. Bien sûr, le fardeau persiste, mais c’est toujours une perte négligeable. Et puis, ceux qui persisteront, pas prêts à reculer face aux difficultés, seront ceux qui se laisseraient soudain épuiser par une précipitation dans les obligations de la routine. Ce ne sont pas les nœuds difficiles à démêler qui bloqueront l’autogestion généralisée mais au contraire, son institutionnalisation, c’est-à-dire sa modification en un processus fermé, autoréférentiel, qui déclarera une fois pour toutes être dans le juste. L’affrontement vivifie les solutions trouvées et en fait entrevoir de nouvelles, l’usure quotidienne les réduit à rien.
On ne doit pas penser qu’un projet autogéré et général, est quelque chose d’achevé, sans ennemis externes contre qui lutter, sans tempêtes internes, sans inadéquations ou autant d’excès pernicieux. Ce sont ces incertitudes qui alimentent la passion et empêchent que le feu créatif ne s’éteigne.
Une fois les convenances et les séparations disparues – ou ayant essentiellement diminuées —, chacun peut-il être libre de s’exprimer au mieux, sans peur d’être sanctionné ? En règle générale oui, mais dans la pratique, ici aussi surgiront des conflits, et même des actions inévitablement destructives face à ceux qui voudront ressusciter le vieux monde. Même le monstrueux est productif dans l’autogestion généralisée, et il contribue à créer de nouveaux processus constituant pleinement le monde nouveau. Toutefois, le monstrueux ou le chaotique n’est pas le jeu voulu et prédéterminé visant à bouleverser chaque projet en une banale négation de l’ordre productif, réduisant ce projet à un simple et vague chaos. Un des nœuds les plus terribles pour le futur autogéré se cache ici. C’est là que se tapit sa possibilité de se développer et de croître.
Au fond, il y a une étrange ambivalence dans l’autogestion au sens où nous la décrivons. D’un côté, il y a en elle une composante intrinsèque irréfrénable, qui découle du précédent logique de la destruction totale, de l’autre, on a un réseau imprévisible et infini de corrélations qu’elle-même déclenche. Ces deux mouvements ne peuvent pas procéder à l’unisson, il y a entre eux des différences structurelles et physiologiques, elles jaillissent irrésistibles mais chacune pour son propre compte, et se jettent tête baissée dans les bras l’une de l’autre. Les ruines précipitent dans le réseau global et témoignent ici d’une inadéquation passée. Elles sont les cartes héréditaires d’un monde mort mais pas pour autant sans conséquences. Ce n’est pas tant la nostalgie des chaînes ou du fouet, ou le souvenir des jouissances passées, mais c’est la fascination même du passé qui entre dans le processus autogéré et généralisé.
En effet aucune chose ne vit exclusivement nouvelle, même le moment a une histoire, ne serait-ce que son histoire génétique, qui à un moment donné se fait sentir impérieusement. Les nouvelles structures productives seront radicalement différentes, mais auront comme fondement et comme but la production, et cela rappelle quelque chose qui s’est délabré, quelque chose de différent, oui, mais pas totalement différent. Ces composantes ne sont pas des souvenirs individuels, des blagues, des sentiments assistés pas la mémoire, ce sont des conditions objectives des moyens de production, ce sont des choses et des rapports entre les choses. La sensation physique d’un produit, le chatouillement d’une fourrure, provient des ruines. La chose a été détruite, mais pas le souvenir de la sensation. C’est une hérédité qui finira par tomber dans le réseau productif, causant des sollicitations vers des projets qui pourraient contredire la direction globale des corrélations en cours de développement. De même pour l’éclat d’un bijou et la stimulation olfactive causée par un parfum. Tout cela, en revenant à l’esprit avec d’autres souvenirs des ruines, pourra être subverti et éclaté par de nouvelles sensations, monstrueusement différentes, qui seront produites par les possibilités infinies de l’autogestion généralisée. Et c’est d’un affrontement complètement ouvert que nous sommes en train de parler.
Il faut garder en tête ce jeu des sensations, des souvenirs, des superpositions, des effacements, des nouvelles intuitions, et il faut aussi le considérer comme un monde parallèle au monde productif avec lequel il interagit aussi bien dans les interventions projectuelles que dans les choix de consommation. L’autogestion n’est pas qu’une réorganisation productive âpre et complexe (de ce point de vue il reste la limite de l’accomplissement), un projet en évolution ouvert à de nouvelles expériences, mais c’est aussi l’autogestion de l’homme nouveau, ou au moins l’autogestion tend à cela, pas sur des hypothèses velléitaires de pédagogie libertaire, mais à travers la transformation des rapports productifs. Les deux objectifs ne cherchent pas à se conditionner réciproquement, mais se développent en parallèle, même avec toutes les contradictions qui peuvent émerger, dont certaines que nous avons vues avant.
C’est l’autogestion qui, pour la première fois, relance la discussion concernant le primat de la production. Les théorèmes de l’économie résonnent encore sur les ruines. Primat secoué verbalement par une grande partie de l’anarchisme, sans comprendre que c’est justement ici que se situe la distance de sécurité d’avec le marxisme. Des critiques il y en a eu, les nôtres aussi, mais leur confirmation ne peut avoir lieu que dans l’autogestion généralisée. C’est une des raisons qui rend incomparable cette réorganisation du monde sur les ruines du passé.
Reconfirmer ici ce grand exploit pourrait avoir l’air ornemental d’un pléonasme ou d’une allégorie. Il n’en est rien, il n’y a rien en moi du constructeur de monument, bien au contraire, étant donné mon expérience en matière de dynamite. Les réaffirmations ronflantes s’érigent comme des montagnes inatteignables et sont un peu gelées dans leur solitude. Dans la petite dimension ce sont des monuments funèbres en hommage aux bonnes volontés utilisées par de dignes porteurs d’eau. Ces analyses sont imprécises et ouvertes à toutes les critiques, même celles de mauvaise foi. En cela, elles prennent l’eau de toutes parts. Peut-être que si je les avais écrites avec mes instruments à portée de main, elles auraient été plus exhaustives et cimétériales.
Chaque sujet doit avoir son expression, il ne peut ni se surcharger ni se faire dominer par des mots. Ce sont ces derniers qui doivent servir les choses, et non pas le contraire. Souvent, quand les mots prennent le dessus, ils construisent des postures, des mannequins d’exposition rigides, des monuments funéraires, mais ils n’amènent pas à la compréhension des choses. Dans tous les cas, le lieu dans lequel je me trouve, une fosse, m’aide à être sobre et à ne pas me faire prendre la main par les aspects techniques du sujet, qui en possède beaucoup.
La glorification de l’objectivité, comme idéal absolu de vérité, trouve de nombreux obstacles dans le monde de l’autogestion généralisée. De nombreux processus productifs sont dépourvus de clarté immédiate, manquant le contrôle du marché. L’aventure productive singulière n’a rien de managériale, elle pourrait se présenter malléable et donc non reproductible dans sa réalisation, question de détails, parfois, question de fond d’autres fois, on ne peut pas savoir. L’effort créatif peut être absorbé dans une forme précise, durable dans le temps, mais ne peut pas être imposé avec la force des moyens employés dans le vieux monde, par exemple la publicité. Il faudrait connaître le rythme des correspondances, ce qui se répercute dans le réseau global, ne pas saisir seulement ce qui s’écrase sur les obstacles surgissant soudainement face à une unité productive singulière. Cette contradiction éminente est un signe de maturité du système productif autogestionnaire dans sa globalité. Voilà justement les points de force qui ne sclérosent pas le processus et qui, en même temps, ne le rendent pas trop fluide qu’il en devient inintelligible. La production a besoin de modèles, mais ces deniers ne peuvent pas être des statuts tourelées, immobiles, à reproduire mécaniquement. L’autogestion en serait bloquée, ce modèle doit se présenter et disparaître, avec un rythme correspondant à celui des nouvelles formes productives qui se déversent dans la consommation. Aucun de ces modèles n’est parfait en soi, ni comme produit ni comme objet de production, partout on enregistre uniquement des approximations, des incertitudes, des bosses, des résultats incongrus, des velléités frustrées, néanmoins, on enregistre des résultats, des choses sont produites.
Poursuivre la production autogérée forme une conscience différente, où la valeur du produit n’est plus établie par l’extérieur, grâce au marché, mais elle croît à l’intérieur même de la conscience, avec un mélange de complaisance et de tristesse. On est content de ce qui est produit et, en même temps, on est triste du fait que dans cette chose produite est réellement entrée, se mélangeant avec la matière dont cette chose est faite, une petite partie de notre vie. Le produit fabriqué avant les ruines avait la valeur du marché, son prix. Celui qui sort de l’autogestion a la valeur d’une partie de ma vie, c’est ma vie que j’offre au système autogéré de consommation. Il n’y a plus ni châteaux forts ni coffres, il n’y a plus de billets ni bijoux à accumuler et à garder. Les ruines de la pure apparence sont encore là – si nous ne les avons pas fait disparaître – pour rappeler ce profond changement, nous sommes désormais dans la terre qui a oublié tout contenu commercialement vérifiable.
La conscience différente fuit la cristallisation des rapports et les corrélations d’affinité autogérée, elle veut que tout reste fluide, vide des lourdeurs précurseurs de la boue dont les ruines étaient pleines, et d’une telle fluidité elle en fait une forme essentielle de vie, évaluation et considération de la réalité. Affermir tout ce monde aux formes nouvelles, inouïes, dans le moule classique du réfléchissement – la vérité de ce qui correspond à ce qui est – nous entraîne vers le calme des catacombes. La nouvelle production généralisée périrait ainsi dans un climat d’exactitude et de compensation parfaite, à l’inverse, elle rejette tout livre de référence réchappé des ruines et flottant encore sur la boue.
Effectivement, on reste écrasé face à un objectif du genre, mais seulement si on pense encore le vieux monde intact, si on laisse filtrer des souvenirs d’un passé indigne et mal vécu, alors les erreurs replongent aussi dans le monde nouveau, et c’est un malheur assuré. Mais la destruction totale a fait son travail. Aujourd’hui il n’y a plus les choses qui nagent dans la boue politique et capitaliste, se cachant l’une l’autre dans son profond trou noir. On ne peut pas s’attendrir devant la suppression d’un opprobre d’esclavage et de souffrance, et faire cela n’a pas de sens même pour ceux qui n’ont que des souvenirs de jouissance. Tout cela, le blanc et le noir, a été annulé, derrière il n’y a que l’obscurité des ruines où il est inutile de fouiller, où on ne trouve que des cadavres.
<span style="font-
