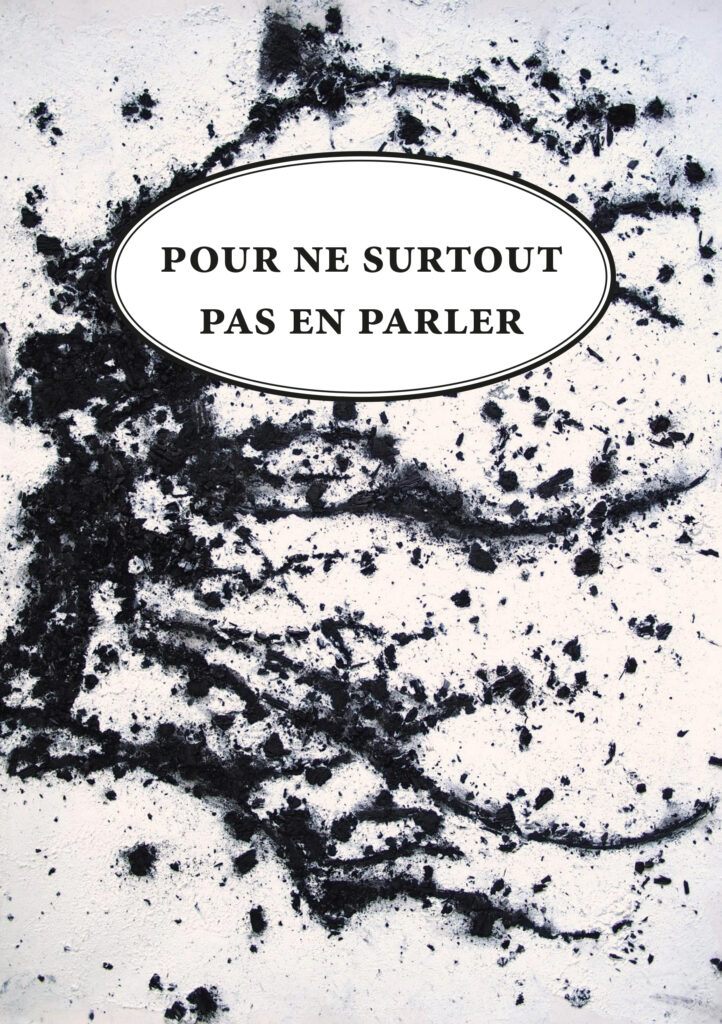 Dans la mesure où elle augmente notre capacité et notre volonté d’autocritique, elle élève également le niveau de notre critique », disait quelqu’un. Le contraire est tout aussi vrai : le niveau de notre autocritique s’abaisse dans la mesure où s’abaissent notre capacité et notre volonté de critique. Un regard critique est un regard qui veut améliorer et s’améliorer. Pour cela il ne cherche pas les qualités dont se féliciter, mais les défauts sur lesquels s’interroger. N’importe où, partout, chez quiconque. Un regard vaniteux et apologétique déteste les défauts. Il n’a d’yeux que pour les qualités. Il ne veut rien améliorer, il veut se complaire, se contempler, se faire reconnaître et aduler. Ne cherchant pas les défauts, il tend à ne développer aucune faculté critique. Ni vers les autres, ni vers lui-même.
Dans la mesure où elle augmente notre capacité et notre volonté d’autocritique, elle élève également le niveau de notre critique », disait quelqu’un. Le contraire est tout aussi vrai : le niveau de notre autocritique s’abaisse dans la mesure où s’abaissent notre capacité et notre volonté de critique. Un regard critique est un regard qui veut améliorer et s’améliorer. Pour cela il ne cherche pas les qualités dont se féliciter, mais les défauts sur lesquels s’interroger. N’importe où, partout, chez quiconque. Un regard vaniteux et apologétique déteste les défauts. Il n’a d’yeux que pour les qualités. Il ne veut rien améliorer, il veut se complaire, se contempler, se faire reconnaître et aduler. Ne cherchant pas les défauts, il tend à ne développer aucune faculté critique. Ni vers les autres, ni vers lui-même.
Pour télécharger la brochure: Pour ne surtout pas en parler – A5 page-par-page
Ci-dessous, le texte de la brochure:
Pour ne surtout pas en parler
Il s’agit d’une des grandes hypocrisies humaine : la liberté de critique. Personne n’osera jamais affirmer explicitement son hostilité vis-à-vis de la critique, toutefois tous en reconnaîtront la valeur et l’importance. En effet, dans les systèmes politiques sa mise au ban est un synonyme notoire de totalitarisme. Pourtant, sa manifestation n’est sollicitée, appréciée, ou seulement tolérée quasi exclusivement quand elle n’est pas dirigée vers soi-même. Critiquer c’est bien, c’est très bien… tant qu’on critique les autres.
Soyons sincères : au fond est-ce que les dictateurs ont déjà pensé autrement ? Quelqu’un comme le Duce n’avait aucune raison de faire taire ceux qui s’en prenaient au communisme. Et aucun régime stalinien n’a jamais empêché la critique du nazisme. Mais si jamais les critiques avaient retourné leur attention vers l’intérieur et non plus vers l’extérieur (de son pays, parti, mouvement, ou groupe…), on peut facilement prévoir qu’ils auraient eu immédiatement à faire face à la censure. Parce que critiquer peut bien être considéré comme une activité louable, être critiqué ne plaît cependant à personne. C’est pourtant la que réside une des différences fondamentales entre autoritarisme et liberté – dans la possibilité de critiquer n’importe qui.
D’après Kant, à qui on attribue le mérite d’avoir introduit ce concept, la critique est le processus à travers lequel la raison entreprend la connaissance de soi-même, « le tribunal qui, en assurant ses légitimes prétentions, repousse toutes celles qui sont sans fondement ». Une interrogation ouverte de ce qui nous entoure comme de nous-mêmes, afin de comprendre, de déterminer, de décider et – on suppose – d’agir en conséquence. Considérée ainsi, la critique apparaissait comme une des tâches de l’ère moderne, et ce n’est pas un hasard si elle constituait l’aspiration fondamentale des Lumières, qui passait au crible toute chose dans le but de découvrir les limites et les perspectives de l’être humain.
Dans le domaine subversif, une fois rejeté le déterminisme qui considère la révolution comme la fatalité inéluctable du destin humain, la possibilité d’un renversement de l’ordre social a toujours été liée à la diffusion de la prétendue conscience (de classe ou individuelle, possédée par tous ou octroyée uniquement aux intellectuels, tout ça c’est une autre question). Or, cette conscience est-ce autre chose que la conscience de soi ? C’est la conscience qui alimente la critique, et c’est la critique qui développe la conscience, dans un processus qui amène directement à l’affrontement avec l’existant. Voilà pourquoi la formation de la conscience est quotidiennement empêchée par les techniques modernes de persuasion, de propagande et de manipulation mises en œuvre par la domination, celles qui réduisent l’infini à la minuscule mesure institutionnelle. Il ne faut pas permettre à l’être humain, bombardé par milles suggestions, ordres, chantages et habitudes, de se découvrir soi-même et de s’autodéterminer. On pourrait donc penser que les ennemis de ce monde devraient avoir tout intérêt à considérer la critique comme d’importance vitale…
Par définition, critiquer signifie « examiner quelque chose principalement pour mettre en relief ses défauts ». Quelle est l’intention d’un tel regard ? Bien évidemment celui d’en avoir conscience afin de pouvoir y remédier. On met en évidence les défauts pour éviter de les répéter, pour les corriger, pour les déjouer. Cela explique pourquoi la critique devrait toujours être sollicitée, et jamais découragée. Mais, comme on l’a dit, personne n’ose nier les vertus de la critique. Il suffit… qu’elle se dirige sur les autres. Le problème émerge en effet quand le regard critique se pose sur ceux qui sont proches de nous, sur nous-mêmes, sur ce que l’on partage et que l’on est en train de faire. Alors toute l’appréciation publique pour la critique, toute la noble disponibilité à y prêter attention se transforme immédiatement en agacement et en rancœur. Comment osez-vous nous critiquer ? Critiquez les autres, et nous saluerons vos brillantes observations ; critiquez-nous, et nous liquiderons vos plates banalités.
La raison de ce comportement est simple. La critique est perçue comme une attaque, donc elle n’est justifiable que quand elle vise l’extérieur. Dans le cas contraire, elle ne peut pas être acceptée. Parce qu’elle divise, au lieu d’unir. C’est là tout le souci : ce ne devrait pas être l’acceptation passive de règles, de coutumes, de slogans et d’idéologies qui unissent, mais plutôt le partage d’idées, de méthodes et de perspectives. Un ensemble de choses qui ne requièrent pas la suspension de l’esprit critique, mais son affinement, son renforcement. « J’aime être critiqué – écrivait un compagnon de l’autre côté de l’océan – parce que la critique m’indique les points faibles de ma pensée, me permettant ainsi de les renforcer ». Voilà comment devrait être considérée la critique : comme une occasion de s’améliorer. Naturellement une critique peut aussi être considérée comme hors sujet, ou injustifiée. Que reste-t-il à faire alors ? Ou bien ouvrir un débat qui – loin de faire perdre du temps et de l’énergie – ne peut qu’enrichir tout le monde, en donnant à chacun une plus grande conscience (dans un sens ou dans un autre, peu importe). Mais cela implique d’écouter les critiques, d’y réfléchir, de les analyser pour éventuellement les contredire. C’est ce qui est arrivé un nombre inconsidérable de fois dans le passé, quand le mouvement était un creuset de discussions et de polémiques, parfois même féroces. Ou alors, triste alternative, éviter tout débat en accumulant de la rancœur envers ceux qui osent critiquer (« On ne jette pas de la merde sur les compagnons ! »), ce qui arrive régulièrement dans le présent. Avec quelles argumentations, c’est que nous allons voir.
Pinailleurs réactionnaires
Commençons par un cheval de bataille des ennemis de la critique. La critique est réactionnaire, c’est la tentative d’empêcher le libre développement des faits. Ceux qui critiquent sont des casse-couilles, des rabat-joie à mettre à la porte sans égards et sans perdre une minute. Il ne faut pas déranger le conducteur, détourner son attention signifie vouloir provoquer un accident. Dans son œuvre la plus connue, le philosophe autrichien Günther Anders nous fournit une description précise de la logique qui sous-tend cette accusation : « À peine l’auteur avait-il achevé ce raisonnement – une simple démonstration qui ne prétendait, bien entendu, proposer aucun remède – qu’il s’entendit traiter de « réactionnaire romantique », et ce par un partisan du juste milieu. Peu habitué à s’entendre qualifier de réactionnaire, il en resta un instant interdit. Un instant seulement, car son contradicteur se trahit immédiatement dans la discussion qui suivit. « Celui qui met expressément en lumière de tels phénomènes et leurs conséquences, expliqua-t-il, cet homme-là critique. Or celui qui critique perturbe à la fois le développement de l’industrie et la vente de ses produits. Il a au moins la naïve intention d’essayer de les perturber. Mais puisque l’industrie et le commerce doivent de toute façon aller de l’avant (nous sommes bien d’accord ?), la critique constitue pour cette raison même un sabotage du progrès. C’est pourquoi elle est réactionnaire. » Je ne pouvais pas me plaindre du manque de clarté de cette explication ».
Transporté à l’intérieur de notre fragment de monde toujours plus irrespirable, comment ce raisonnement se manifeste-t-il ? Ceux qui critiquent dérangent le cours évolutif du mouvement, ainsi que la diffusion des initiatives, ou du moins ils ont la naïve intention de tenter une telle action de dérangement. Mais puisque le cours du mouvement et la diffusion des initiatives doivent progresser dans tous les cas ( n’est-ce pas ainsi ?), la critique est eo ipso un sabotage de la révolution, elle est donc précisément réactionnaire. Effectivement, c’est clair. Ceux qui osent mettre en discussion l’aliénation provoquée par la politique du collaborationnisme para-institutionnel et du front uni (celui qu’une rhétorique mouvementiste puérile appelle « refus des identités ») ressemblent à ceux qui osent mettre en discussion l’aliénation produite par la technologie (ce qu’une propagande démocratique puérile appelle « progrès »).
D’après Anders, « on sait bien que l’identification de la « critique » à la « réaction », le fait de dénoncer les critiques comme des saboteurs réactionnaires, faisait partie de la tactique idéologique du national-socialisme. Le terme populaire de Norgler [pinailleur] avait bien ce double sens ». Mais puisque Hitler a vaincu, comme le constatait amèrement Jacques Ellul en 1945 immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont plus seulement les nazis qui s’en prennent aux « pinailleurs », mais aussi leurs ennemis actuels. Il suffit d’autre part de penser à la similitude que l’on retrouve dans un concept qui a toujours fait fureur dans les sacristies des différents partis subversifs, celui de « défaitisme contre révolutionnaire ». N’est-ce pas l’accusation jetée sur ces compagnons qui en 1936 levèrent la voix contre l’entrée de certains anarchistes espagnols au gouvernement ? En Espagne la révolution avait lieu, la FAI et la CNT combattaient pour l’anarchie, la tactique l’exigeait pour être en phase avec la situation, il fallait en faire partie pour le comprendre, et donc seuls des défaitistes contre-révolutionnaires pouvaient critiquer des compagnons courageux et valeureux (comme Juan Garcia Oliver, par exemple) qui sur la vague des circonstances décidèrent de devenir ministres. Les anarchistes italiens qui publiaient L’Adunata dei Refrattari aux États-Unis s’en sortirent bien, en fin de compte ils furent seulement accusés d’être des contre-révolutionnaires qui à un océan de distance dissertaient sur ce qu’il était juste et ce qu’il était erroné de faire. Ce qui est arrivé à certains membres de los Amigos de Durruti est bien pire, eux qui exprimèrent cette critique sur le champ de bataille, et qui pour cette raison trouvèrent la mort. Et pas de la main des fascistes, mais après avoir été accusés d’être des « provocateurs » au service de l’ennemi, une accusation qui à l’intérieur du mouvement a souvent été lancée sur ceux qui osent déranger le trafic du discours idéologique officiel. En plus des Amis de Durruti (au fond liés à une conception anarchosyndicaliste), souvenons-nous de Vittorio Pini, de nombreux individualistes anarchistes, d’ « anti-organisateurs » comme Renato Souvarine, ou même des comontisti.
Les personnalismes ça suffit !
Mais accuser la critique d’être réactionnaire c’est encore lui concéder une raison supérieure, une motivation « politique » (au fond, un anarchiste qui devient ministre de la Justice c’est vraiment une contradiction dure à accepter). Ce qui n’est pas toujours réalisable, ni souhaitable. En effet, c’est plus rusé de trouver d’autres buts à attribuer à ce regard critique qui nous vise, des buts cachés, bas, doubles. Si quelqu’un met nos défauts en évidences, il ne le fait que par animosité. Ce n’est pas une critique, c’est une attaque personnelle ! La première est permise, encore heureux, mais la seconde elle est intolérable. Alors, pour comprendre la vétusté d’un tel expédient, mais aussi pour en réfuter les fondements, laissons la parole à quelqu’un qui connaissait fort bien le sujet en question. Voilà ce qu’écrivait Paolo Schicchi dans le lointain 1891, dans un article intitulé Personalità : « À chaque fois que certaines idoles et certains compères de sa petite coterie sont touchés, et que leurs masques et leurs intérêts sont compromis ; en somme dès que le fouet s’abat sur certaines crapules, certains imbéciles ou certains lâches, et que se font alors entendre des vérités qui ne plaisent pas, on se plaint : « Ne faisons pas de personnalité ». Mais, de grâce, qu’entendez-vous par personnalité ? Moi, personnellement, je comprends ceci : Toute attaque qui répond à de simples colères et intérêts personnels, sans aucun rapport avec les idées. Cela étant tout ce qui concerne de près ou de loin la lutte que l’on mène, tout rapport de l’individu avec les principes qu’il professe, échappe au terrain des personnalités, et entre dans celui des idées. Dites, moralistes à deux balles, en attaquant tel ou tel monarchiste, tel ou tel syndicaliste, ou ministre, ou député, ou fonctionnaire, ou bourgeois quelconque, ne faites-vous pas des personnalités » ?
La critique prend pour cible les faits et les idées, abstraction faite de la personne qui agit et pense. L’attaque personnelle prend justement pour cible la personne en tant que telle, abstraction faite de ce qu’elle fait et dit. Les personnalismes sont ceux qui se basent sur des motivations qui n’ont aucun rapport avec les idées : prendre à partie quelqu’un parce qu’il a courtisé la personne que l’on aime, parce qu’il a détruit une automobile empruntée, parce qu’il supporte l’équipe adverse… ou pour toute autre raison strictement personnelle. Il est bien sûr assez aisé de faire passer une diatribe privée pour une critique, de tenter de refourguer la rancœur futile pour une série de divergences d’idées. Mais c’est aussi une combine simple à démasquer : il suffit d’observer si la critique formulée est adressée à tous ceux qui partagent ce qui est contesté ou bien seulement à une personne ou une poignée d’entre elles. Si je fulmine contre Pierre parce qu’il a participé à je ne sais quelle initiative ou qu’il a exprimé je ne sais quel avis, par la suite je ne peux pas louer Paul qui était présent à la même initiative ou qui a réaffirmé le même avis. Autrement mes foudres sont des feux d’artifice pour cacher mes venins personnels. Un exemple tristement célèbre, dans ce sens, c’est celui de Johann Most, depuis toujours fervent défenseur des actes de révoltes individuels, qui se jeta sur Alexandre Berkman en le blâmant pour avoir tiré contre l’industriel Henry Frick. Une contradiction si évidente que nombreux furent ceux qui comprirent alors qu’en réalité la faute de Berkman était toute autre, à savoir d’avoir conquis le cœur de la jeune Emma Goldman, alors élève du vieil anarchiste allemand.
Paradoxalement, comme le faisait d’ailleurs déjà remarquer Schicchi il y a plus d’un siècle, ceux qui font des personnalismes sont précisément ceux qui s’en plaignent. Ceux qui sont prêts à invectiver et à attaquer quand une certaine conduite est mise en acte par ceux qui sont lointains, mais qui sont prêts à la justifier et à la défendre quand ceux qui en sont responsables sont proches. Démontrant ainsi que leurs avis sont modifiables ad personam. Tout peut se faire, tout peut se dire, cela dépend seulement de qui le fait et le dit : s’agit-il d’un des nôtres, ou d’un des leurs ? Si un désobéissant fricote avec les réformistes, il n’y a alors aucuns doutes : c’est un politicien opportuniste. À l’inverse, un anarchiste qui fricote avec les réformistes… c’est un habile stratège ? Et en quoi consisterait la différence entre les deux, sachant que le comportement est le même ? Dans les intentions maléfiques du premier (qui nous est totalement inconnu) à ne pas confondre avec les bonnes intentions du second (dont nous sommes si liés amicalement) ? Eh bien, faire du personnalisme c’est précisément cela. Utiliser des critères de jugement opposés en fonction de la personne en question. Voilà pourquoi, afin d’éteindre la critique, le prétexte des personnalismes à éviter est un moyen de prédilection de ceux qui ne possèdent pas d’idées à défendre, mais seulement des rapports d’amitiés à préserver.
Le style du doigt
Ensuite il y a le prétexte du style. Critiquer d’accord, mais il faut que cela soit fait avec les bonnes manières. Avec les ennemis déclarés qui se tiennent à distance, on peut hurler. Mais quand on s’adresse à quelqu’un de proche, la critique doit être précédée d’une révérence comme marque de reconnaissance. Elle doit être courtoise, suave, délicate et susurrée pour ne pas froisser la sensibilité du prochain. Autrement, que l’on ne s’étonne pas si ensuite le regard de tous ne finira pas sur la lune mais sur le doigt sale qui la montre. Comme si le style n’était pas une question strictement individuelle, variée et variable en fonction des personnes et des circonstances. Comme si le choix entre une prose pédagogique et une « prose française à la guillotine » ne dépendait pas uniquement d’un goût personnel, absolument sans appel. Mais qui donc a dit que dans les discussions entre compagnons on devrait forcément adopter la forme « permets-moi de te faire remarquer que je ne partage pas du tout ton avis par ailleurs respectable… », plutôt que le style sincère et direct « tu dis des conneries » ? Le style peut aussi agacer, par ailleurs dans les deux sens, mais cela ne constitue pas en soi un argument pour repousser le contenu de la critique. Parce que ce qui compte c’est ceci, et rien que ceci : qu’est-ce qu’on peut bien en avoir à caler que le doigt soit propre ou sale, quand c’est la lune qu’il faut regarder ? Le ton imprécatoire s’avère véritablement irritant seulement quand il sert à cacher l’absence totale de contenus, et pas quand il les accompagne.
Luigi Fabbri avait déjà essayé, dans sa polémique avec les individualistes, de dégainer cette arme niaise comme pas deux, à savoir pleurnicher contre le langage violent d’un certain anarchisme. En partant du présupposé que « dans la polémique et dans la propagande – où il s’agit de convaincre et non pas de cogner – ceux qui utilisent le plus la violence du langage ce sont ceux qui sont dépourvus d’arguments », il en arrivait à la conclusion qu’« on ne persuade et on ne convainc pas avec la violence du langage, avec l’invective et l’insulte, mais plutôt avec la courtoisie et des manières éduquées ». Évidemment ce maître d’école élémentaire pensait que tous ses lecteurs et auditeurs étaient des enfants à éduquer, et qu’il suffisait d’expliquer avec soin et avec calme les différentes questions pour les illuminer et les mettre sur la bonne voie. Il n’en est pas ainsi, il n’en a jamais été ainsi. Il y en a qui étouffent face à l’éducationnisme et qui ne sont disposés ni à pontifier du haut d’une chaire ni à recevoir des leçons. Et puis il y en a qui n’ont aucune intention de convaincre ni de persuader les autres, se contentant d’exprimer leur pensée. Pour ne rien dire de ceux qui alternent – à tort ou à raison – entre le calme et la colère. Mais surtout, qui a dit qu’une argumentation ne peut pas et ne doit pas être exprimé aussi grâce aux coups de fouets ? Qu’un ton de prêcheur est le seul qui soit digne de respect ? Que les caresses sont plus aptes à réveiller les consciences et les esprits que les pincements ? Il n’existe pas de ligne de conduite univoque à suivre scrupuleusement, mais il existe une infinité de manières que l’on suppose aussi variées que le sont les individualités. À chacun son style, quel qu’il soit.
Le même Schicchi, une des cibles de la critique de Fabbri, abordait la discussion en observant que « si ce que Fabbri affirme était vrai, à savoir que la violence verbale, les invectives, les injures etc. etc. sont des indices de vacuité, d’absence d’arguments et d’une manière assez stupide de raisonner, il faudrait reléguer… parmi les déclamations des impuissants les plus grands chefs-d’œuvre du génie humain, les plus prodigieuses polémiques et les plus formidables satires », parmi lesquelles il citait les œuvres d’Orace, de Dante Alighieri, de Vittorio Alfieri, de Giacomo Leopardi, de Francesco Redi, de Giordano Bruno, de Démosthène. À l’inverse, « on devrait au contraire considérer parmi les œuvres les plus belles, les plus profondes et les plus éducatives les bêlements d’Arcadie et les grognements de sacristie, les divagations de l’artériosclérose et les rabâchages des saints, les sérénades à la lune et les psaumes rythmiques des crapauds ». En rappelant à tous les œcuméniques que celui qui est colérique est amoureux, Schicchi n’avait aucun doute : « N’importe quel partisan d’une idée en lutte contre les traficoteurs, contre un persécuteur, contre un traître, ne peut que trouver des accents de dédain et des manifestations de colère. Le contraire ne proviendrait pas d’êtres faits de sang, de muscles et de nerfs, mais d’ascètes, de castrats ou de jésuites ».
Un regard vers le passé ?
De toute manière, pour démontrer comment ces reproches de personnalismes et de style n’ont toujours été que de la fumée aux yeux soulevés par ceux qui ne savent pas comment ni quoi riposter, il suffit de rappeler une polémique du passé moins connue. Il n’y a pas que les anarchistes les plus sanguins et virulents qui ont été épinglés, c’est-à-dire invités à modérer leurs critiques. Cela est même arrivé au plus insoupçonnable de tous, rien de moins qu’à Errico Malatesta. Oui, précisément à lui, dont en plus la majorité des articles sont des articles de critique ou de polémique (polie, bien que pédante). Quand en 1897 Amilcare Cipriani partit pour la Grèce afin de combattre la guerre de libération contre la domination turque, Malatesta haussa la voix. L’ex-communard pouvait bien espérer allumer l’étincelle révolutionnaire abstraction faite de la situation dans laquelle il intervenait, mais l’anarchiste napolitain ne pouvait pas accepter que le mouvement soit entraîné dans une guerre nationaliste (subventionnée principalement par des forces autoritaires). Voilà pourquoi il se déchaîna dans les pages de son journal contre ce qu’il a alors défini comme une « garibaldisterie ». Le pauvre Cipriani, pas vraiment fin théoricien, resta époustouflé par ces paroles. Que fit-il alors ? Il répondit en se lamentant contre « l’attaque personnelle » que lui avait lancé Malatesta, pleurnichant sur l’amitié trahie. Malatesta, soupirant face à de telles sornettes, revint plusieurs fois sur le sujet. Comme on le voit, quand on n’a pas d’arguments, ce n’est pas le style gentil et bien élevé qui peut garantir un accueil bienveillant de la critique. Comme on le voit, quand on n’a pas d’arguments, ce sont toujours les mêmes prétextes que l’on utilise pour éviter le débat.
En termes de servitude volontaire, nous avons atteint les six milliards. En termes de critique, nous sommes à zéro. Il est presque incroyable d’entendre des soupirs de nostalgie vis-à-vis du mouvement anarchiste du passé lointain être accompagnés des foudres contre ceux qui continuent aujourd’hui à « faire des polémiques ». Quiconque se donnerait la peine de feuilleter la presse subversive du passé, ce glorieux passé tant regretté, découvrirait que la très grande majorité de l’espace était dédiée à des polémiques d’une violence presque brutale, (par rapport auxquelles celles d’aujourd’hui sont rares et d’inoffensifs passe-temps). Cela ne donne-t-il pas à réfléchir aux œcuménistes actuels ? Ce n’est pas le débat fervent qui est la cause de la misérable situation dans laquelle verse aujourd’hui le mouvement, mais plutôt le débat éteint, déserté, absent. La furie qui déborde des vieux journaux anarchistes est l’expression de la vitalité de ce mouvement, composé d’êtres humains en chair et en os, prêts à se battre pour leurs idées jusqu’à la mort. Le calme qui trône (et qui est exigé) aujourd’hui est l’expression de l’absence d’idées omniprésente dans le mouvement.
« Dans la mesure où elle augmente notre capacité et notre volonté d’autocritique, elle élève également le niveau de notre critique », disait quelqu’un. Le contraire est tout aussi vrai : le niveau de notre autocritique s’abaisse dans la mesure où s’abaissent notre capacité et notre volonté de critique. Un regard critique est un regard qui veut améliorer et s’améliorer. Pour cela il ne cherche pas les qualités dont se féliciter, mais les défauts sur lesquels s’interroger. N’importe où, partout, chez quiconque. Un regard vaniteux et apologétique déteste les défauts. Il n’a d’yeux que pour les qualités. Il ne veut rien améliorer, il veut se complaire, se contempler, se faire reconnaître et aduler. Ne cherchant pas les défauts, il tend à ne développer aucune faculté critique. Ni vers les autres, ni vers lui-même.
Dans une photo prise pendant la révolution espagnole, on voit certaines personnes devant un étal de livres. Des enfants, des jeunes, des vieux. Des générations entières, les yeux brillants devant ces objets magiques, ayant accouru vers l’idée qui donnait un sens à la vie. Aujourd’hui, au cours des initiatives les étals de livres sont ignorés par les compagnons, utilisés pour y poser les bouteilles de bière. Avec le dépérissement de la conscience, dépérit aussi la conscience. Quand on ne possède plus la capacité de critiquer (et donc d’auto-critiquer), il est évident que diminue également la volonté – et vice versa. Quand elle n’est pas alimentée, la pensée critique s’atrophie et disparaît.
À sa place surgit la rhétorique, cette déclamation pompeuse, vide et mobilisatrice qui est en train de se diffuser un peu partout. La rhétorique ne bouscule pas avec des observations acérées, elle caresse avec des expressions envoûtantes. Voilà pourquoi elle est bien accueillie par tous, parce qu’elle ne met rien en discussion. Elle incite à aller de l’avant sans se poser d’interrogations, c’est-à-dire sans penser. Qu’y a-t-il de plus gratifiant, s’entendre dire « tu as fait une erreur » ou bien « tu es beau comme le soleil » ? Il n’y a aucun doute. Voilà pourquoi le succès de la rhétorique est assuré, tout comme l’hostilité pour la critique. Pourtant il n’y a que la critique qui fasse grandir, dans le meilleur des cas la rhétorique fait gonfler, elle fait planer tant qu’on a le vent en poupe.
Mais à la première bourrasque défavorable…
