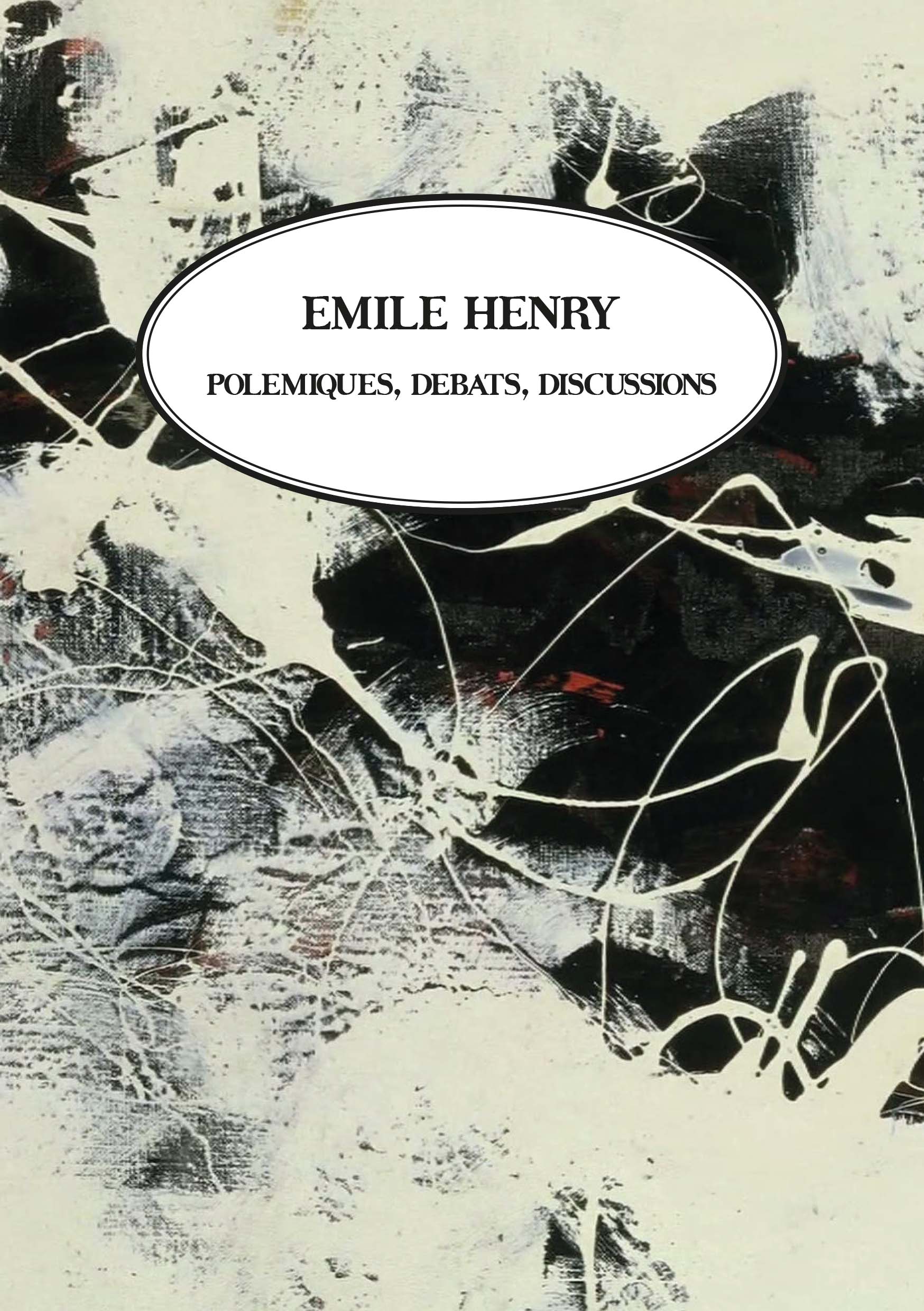
SOMMAIRE:
-Du terrorisme, de certains imbéciles et d’autres choses
-Pour le vers de la vie
-Émile Henry et la propagande par le fait
-Sur la responsabilité individuelle
Pour télécharger la brochure: Émile Henry. Polémiques, débats, discussionsEmile Henry polémiques débats discussions A5 page-par-page
Ci-dessous, le texte de la brochure:
Du terrorisme, de certains imbéciles et d’autres choses
Note à la première édition
L’exigence de ce livre est née de la publication de deux articles : Émile Henry et le sens de la mesure de Amadeo Bertolo [chieur d’encre], paru dans « A-rivista anarchica » n.2 (1979), et Violentisme et éthique de Paolo Finzi [prêtre déguisé], paru dans le n.3 (1979) de la même revue. Ces deux articles attaquent ma recension du livre : Emile Henry, Coup pour coup (Éditions Vulcano, 1978), publiée dans « Anarchismo » n.23-24.
[En Appendice nous publions ma recension du livre d’Henry, l’article de Bertolo et de Finzi et deux articles de Gianfranco Bertoli titrés : Le prix à payer, publié dans « A-rivista anarchica » n.4 (1 979), et Actes individuels et « terrorisme », publié dans le même numéro].
Cette polémique nous donne l’occasion d’approfondir les énormes problèmes de la lutte armée, et plus particulièrement ceux relatifs au soi-disant « frapper dans le tas », c’est-à-dire l’attaque contre les exploiteurs de manières plus large que celles réalisées jusqu’à maintenant par le mouvement révolutionnaire.
Du terrorisme, de certains imbéciles et d’autres choses
De ceux qui sont sourds
« La « raison » dans le langage : ah ! Quelle vieille femme trompeuse ! Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons encore à la grammaire… »
Friedrich Nietzsche
Les vieilles Lumières croyaient, en toute bonne foi, qu’une fois les choses bien expliquées, une fois la domination de la « raison » imposée dans le monde, tous auraient cessé de garder la tête sous le sable, rendant difficile – voire impossible – le mensonge, la mauvaise foi, l’ignorance et l’exploitation.
Les pauvres vieilles n’avaient pas pris en compte une grave maladie affligeant le genre humain : la surdité.
On qualifie de sourd celui qui a perdu le sens de l’audition, celui qui n’entend pas distinctement les sons et les bruits, mais aussi celui qui ne prête pas attention.
Si on y réfléchit, c’est bien ce dernier le véritable sourd. Aucune voix, aussi puissante soit-elle, ne pourra se faire entendre par celui qui a décidé de ne pas entendre. Aucun raisonnement, aussi clair ou limpide soit-il, ne pourra convaincre celui qui a décidé de ne pas se faire convaincre. Aucune évidence ne sera suffisamment évidente pour celui qui a décidé de nier l’évidence.
Voilà pourquoi j’écris ces pages avec la mort au cœur. Une fois encore – j’en suis sûr –, malgré les efforts que je pourrais faire pour donner aux mots le sens qu’ils devraient avoir, les incompréhensions et la surdité ne manqueront pas.
Tous les chieurs d’encre de ce monde savent que la société dans laquelle nous vivons est le produit historique de l’exploitation d’une grande majorité du genre humain par une petite partie. Malgré tous les efforts qui ont été faits, cette petite partie n’a jamais été identifiée avec clarté, il y a toujours eu des disputes, soit concernant son importance quantitative, soit sa place à l’intérieur de la société même. Sans parler de ses responsabilités : on ne compte plus les avocats défenseurs et les procureurs du roi qui se sont donné pour objectif de justifier ces responsabilités.
Cela étant, puisque la différence de classe – clair comme le soleil – subsiste, et avec elle l’exploitation, et avec elle le génocide systématique des travailleurs, et avec lui tout ce qui en découle, du coté des soit-disant progressistes chieurs d’encre, personne ne s’est jamais hasardé à affirmer que l’on pouvait – en définitive – fermer les yeux et, avec un peu de bonne volonté, arranger les choses.
Parmi ces messieurs on compte non seulement les vaniteux et les stupides pans du stalinisme organisé, mais aussi les fantômes morbides d’une sorte d’anarchisme bavard et respectable. Ils sont nombreux les chieurs d’encre qui, comptant sur la terreur sacrée qu’inspire la grammaire, palabrent sur tout type de sujet, rédigeant des catéchismes, rêvant de se transformer en âme intellectuelle du mouvement, de construire les bases culturelles desquelles les exploités partiront pour terminer leur révolution. Passe-temps stupides de ceux qui n’ont rien d’autre à faire – pourrait répondre quelqu’un. Tout comme ceux qui au bistrot, entre deux verres, aiment discuter de sport, de femmes ou de politique, entre deux numéros de leur journal, ils aiment discuter de révolution. Mais certaines fois le discours se fait plus dangereux. Ne pouvant parler éternellement des problèmes de l’école, des syndicats qui ne sont pas comme ils devraient être, de l’histoire de la révolution espagnole ou de l’histoire de la révolution en Ukraine, ils tombent parfois dans des sujets plus triviaux : ils parlent de la situation dans les prisons, sont obligés d’accueillir les lettres de compagnons anarchistes incarcérés, ils parlent des problèmes que la lutte armée en Italie a entraînés aujourd’hui, et sont contraints de prendre position.
Là, notre ami chieur d’encre est pris d’hystérie. Ne se rapproche-t-on pas trop, ainsi, de ces thématiques qui pourraient attirer l’attention de la police ? Ne court-on pas le risque de donner une « mauvaise impression » à ceux qui sont chargés du contrôle des publications anarchistes ? Ne vaut-il pas mieux, surtout en ces temps de chasse aux sorcières, prendre position, évitant tout amalgame possible avec des gens qui – comme celui qui signe ce texte – continuent à affirmer non seulement que la lutte armée (même en Italie, même aujourd’hui) est possible, mais aussi qu’elle doit être défendue avec tous les moyens et tous les efforts ?
Certes, il faut faire les choses bien, ne pas donner l’impression de travailler gratis pour la police, en criminalisant les compagnons les plus exposés, il faut saisir ce que l’on considère être un point faible, frapper, en évitant absolument de parler des problèmes en question, mais en énumérant des accusations de type personnel, de manière à ce que personne ne puisse dire qu’il a fait une erreur sur ce point ou qu’il n’a pas compris cet autre point : tellement, que l’on a parlé de rien, on ne s’est limité qu’à de vagues affirmations d’« indignations » et de « préoccupations ».
Reste à se demander s’il peut être productif de polémiquer avec de telles personnes qui, derrière des prétextes, préfèrent proférer une série considérable d’insultes en lieu et place de l’approfondissement du problème. Afin de faire apprécier ces insultes à ceux qui les reçoivent, ceux qui utilisent encore la grammaire devraient au moins intercaler leurs insultes avec une analyse – ou, au moins, une tentative d’analyse – du sujet qui en est à l’origine. Cela permettrait au lecteur de bonne volonté de mettre de côté ces dernières et de vérifier les analyses.
Mais, évidemment, n’étant pas encore débarrassés de la grammaire, nous sommes tous attachés à des bagatelles de ce type. Le vrai révolutionnaire est peut-être notre chieur d’encre, qui dit clairement et simplement : «… notre intention n’est pas… tellement de discuter et donc d’argumenter point par point, ni de répliquer et documenter, [mais] plutôt de témoigner de notre indignation et de notre préoccupation ».
À quel point devrait-on crier pour se faire entendre par des gens de la sorte ?
Et puis, cela en vaudrait-il la peine ? Certainement pas. Bien entendu, ce ne sont pas les accusations personnelles qui m’ont poussé à écrire ces pages, au contraire, dans un certain sens, ces accusations m’ont fait plaisir parce que – pour la première fois – elles sortent dans un journal anarchiste avec de nombreuses signatures, alors qu’avant elles ne servaient qu’à alimenter les discussions de couloir que les rats morts d’un certain anarchisme de cinémathèque continuent à alimenter.
Je m’occuperais donc de l’analyse de ce qui – tel que j’ai cherché à le suggérer – se révèle implicite dans le geste d’Henry. Il faut ajouter que cette analyse, et le fait que j’en ai souligné les contenus d’actualité pour le mouvement révolutionnaire aujourd’hui, a scandalisé non seulement les professeurs universitaires comme le rédacteur du « pro-memoria » pour les carabiniers dont je parlais ci-dessus, mais aussi des compagnons sérieux qui, ignorant les insultes, ont cherché, en m’écrivant, à approfondir le problème du « si » et du « comment » frapper « la bourgeoisie dans le tas ».
De l’analyse
« […]Paul Poirier avait été nommé professeur d’anatomie à la Faculté de médecine, quand une autre mésaventure, d’ordre criminel, apporta quelque trouble dans le laboratoire du maître […]. C’était en 1894. L’on avait transporté à la Faculté de médecine le corps d’un anarchiste, Émile Henry, émule du célèbre Ravachol, exécuté le matin même sur la place de la Roquette. Le professeur Poirier le réclama pour son laboratoire, comme il s’était réservé le cadavre de Pranzini, quelques années auparavant. Sur-le-champ, je fus, ainsi que mes trois camarades, chargé de prélever sur le macchabée des fragments anatomiques de toutes sortes, destinés à des dissections et à des préparations qui devaient enrichir le musée de la Faculté. Depuis deux bonnes heures, nous étions occupés à ce travail d’un genre assez particulier, quand un coup de téléphone vint déranger le « patron « . La Préfecture de Police informait que la famille du supplicié avait réclamé son corps et qu’il convenait de le renvoyer immédiatement à la Morgue…
Poirier s’était précipité dans le laboratoire où nous étions en train de travailler : « Halte, mes enfants !« dit-il de sa voix de commandement, « il faut rendre Henry à sa famille !« et il nous donne l’ordre de réparer tous les dégâts que nous avions commis, en nous procurant sur d’autres cadavres ce qui manquait déjà au corps de l’anarchiste. Pendant deux heures, nous dûmes nous livrer à un véritable travail de stoppage, afin de faire disparaître les ravages que nous avions commis avec nos scalpels. C’est ainsi que nous rendîmes à sa famille, le corps de Henry, ravalé de façon si brillante que personne ne put se douter des outrages qu’il avait subis. Sie itur ad astra ! [c’est ainsi que l’on arrive aux cieux].»
André Pascal
Drôle d’espèce que celle d’Henry. Comme le document cité ci-dessus le démontre, son cadavre fut rongé par les savants de l’Université de Paris, de la même manière que l’on cherche à ronger quelque chose de son action aujourd’hui, et de ce qu’il voulait manifester au mouvement révolutionnaire avec cette action.
Certes, on parle d’Henry avec respect, on chante son nom dans les chansons anarchistes, les vieilles, pleines de sang et de dynamite, mais quand on cherche à comprendre la signification de son attaque de la bourgeoisie, on est immédiatement pris de doute. On cherche à isoler cette action, la reléguant, avec l’attentat au Diana, dans le « passé anarchiste moins exemplaire ». À ce sujet, il faut dire quelque chose tout de suite. Mettre ensemble l’action d’Henry et l’attentat au Diana est une tentative, maladroite, de confondre les compagnons, car il y a de nombreuses différences entre les deux actions. Dans le geste d’Henry, il n’y a rien de tout ce qui s’est révélé obscur et jamais bien éclairci à l’égard du fait au Diana. Pour rendre les choses plus confuses encore, on aurait pu le comparer à l’attentat de la Piazza Fontana.
Henry se rend avec une bombe dans un café du Paris « fin-de-siècle », un café fréquenté par la meilleure bourgeoisie de la capitale, y jette son engin, essaye de s’échapper, n’y parvient pas, est arrêté, emprisonné, jugé et exécuté.
Voilà tout. Pourquoi est-ce que j’ai cherché, dans la recension incriminée, à expliquer que – selon moi – son action contient une contribution théorique, une analyse de classe qui doit être méditée, aujourd’hui encore, sans faux moralismes ? C’est simple. Parce que je suis pleinement convaincu de la vérité de ce que j’affirme. Et le débat que le mouvement développera à ce sujet ne pourra que confirmer mon idée. L’accusation qui m’est renvoyée, à savoir qu’avec ce texte j’ai cherché à « impressionner le bourgeois » ou « mieux, à impressionner l’anarchiste » (sic !) ne me touche absolument pas, tout comme ne me touche absolument pas la désignation que ce faisant – depuis des années – j’emploie « la modestie d’un ministère publique, la courtoisie d’un bagarreur, et l’ingénuité d’un publicitaire ». Ce sont des mots. Venons-en aux faits.
Selon moi Henry a fait une analyse de classe. Il nous a dit que, l’existence de la bourgeoisie identifiée – et ses lieux physiques aussi –, il a voulu la frapper : pas individu par individu, soupesant les responsabilités individuelles, mais en tant que classe, de manière indiscriminée, en tant que classe qui gère la domination et l’exploitation. Il a identifié l’ennemi et a procédé à un acte de guerre de classe. Rien de plus, rien de moins.
Le point le plus important, à mon avis, – si on veut avoir la complaisance d’arrêter pour un instant le fleuve de contumélies qui a été dirigé contre moi – est celui de se décider par rapport à la possibilité d’identifier l’ennemi : qu’ensuite on appelle cet ennemi bourgeoisie, qu’on l’appelle pouvoir, qu’on l’appelle techno-bureaucratie, qu’on l’appelle État, il s’agit de différents mots que l’on utilise pour s’aider dans la recherche, dans l’analyse, non pas d’obstacles que nous construisons pour empêcher notre action.
En bref : si nous nous dédions à mieux préciser la cause de l’exploitation, l’ensemble des personnes et des choses qui la rendent possible, ce n’est pas pour que, de cette manière, nous puissions mettre notre âme en paix en nous disant : voilà, finalement nous savons quelles sont les causes de nos ennuis, tournons-nous de l’autre côté et dormons dessus. Quand bien même quelqu’un d’entre nous, affligé par la maladie du chieur d’encre, puisse se leurrer à faire cela, la même chose ne sera pas possible pour ceux qui subissent vraiment l’exploitation (qui sont en général des personnes différentes de celles qui dissertent sur l’exploitation). Voilà, quand ces derniers entrent en possession de ces éclaircissements, quand ils lisent les analyses et se rendent compte de certaines actions, que doivent-ils faire ? Se retourner eux aussi de l’autre côté ? Non ! Ils ne peuvent pas faire cela, parce que peu importe de quel côté ils se tournent, ils subissent toujours la pression de l’exploitation. Alors ils cherchent à frapper ces objectifs, que les analyses et les actions avaient contribué à clarifier.
Pour quel autre motif, au juste, ces analyses auraient dû être faites ? Quel sens a une analyse qui ne sert pas pour l’action ? De quelle manière puis-je apprécier une personne qui écrit – comme notre chieur d’encre – « C’est vrai qu’à un niveau d’abstraction sociologique c’est encore possible d’identifier – comme nous l’avons nous-même fait – une classe dominante (un hybride capitaliste et techno-bureaucratique) qui occupe le sommet de la pyramide sociale, mais c’est une chose d’identifier les obstacles de classes à un niveau analytique, c’en est un autre de les identifier opérativement », de quelle manière puis-je l’apprécier, sinon comme une crapule « sociologique », digne de poser son cul à côté de celui du tant vanté Luciano Pellicani, stupide serviteur et érudit de la social-démocratie des super-prisons et de la décimation sur les postes de travail ?
Maintenant, je me demande, quand un compagnon, un prolétaire, un chômeur, ou un groupe de compagnons ou de prolétaires, qui après des années ont accumulé toute la charge de haine que l’exploitation produit, qui pendant des années se sont mangé le foie, ne sachant que faire contre ceux qu’ils avaient en face, parce qu’il était trop difficile de les identifier, parce qu’il était trop difficile de les frapper au moment précis des responsabilités de classe, quand ceux-ci prennent entre les mains un livre comme Les nouveaux patrons [Edizioni Antistato, Milano 1978] et commencent à le lire, voilà, je me demande, pour quel fichu motif devraient-ils sortir de leurs poches 6 000 lires pour lire « quelque chose » sur les patrons ? Qu’en ont-ils à faire eux, des « patrons » « vieux et nouveaux », si ce n’est pas une contribution qui puisse les aider à mieux les identifier et, une fois identifiés, à mieux les frapper ?
Ici la chose est claire. Ou bien les réalisateurs du livre sur les « nouveaux patrons » ont fait ce riche travail d’effort analytique pour la faire circuler dans la sphère restreinte des professeurs d’universités, qui ont chacun intérêt à mieux connaître les patrons pour mieux les servir, ou bien ils l’ont fait pour fournir une contribution au mouvement révolutionnaire des exploités. Si, comme nous le pensons, leurs intentions se trouvent dans la seconde hypothèse, je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir d’étrange si ces derniers, lisant le livre, le considèrent comme un instrument de clarification pour frapper leur ennemi. Et quelle meilleure récompense pour les auteurs du livre, au moins pour ceux d’entre eux qui se disent anarchistes et – en tant que tels – passent pour révolutionnaires ?
Maintenant, en laissant de côté les contributions dans ce livre qui sont dues à la plume des serviteurs des patrons universellement connus comme Pellicani et compagnie (auquel, je l’ai dit et je le répète ici pour éviter les malentendus, il faudrait mettre une balle et ne pas accepter qu’ils parlent dans les rencontres anarchistes), ils restent les contributions comme celles de notre chieur d’encre, dans laquelle on lit clairement :
« Ce sont précisément eux, selon nous, les nouveaux patrons : technocrates et bureaucrates, ou mieux, techno-bureaucrates, pas seulement et pas tant parce que technocrates et bureaucrates présentent, à notre avis, suffisamment de caractères d’affinités de classe pour requérir une définition unique même terminologique, mais plutôt parce que technocratie et bureaucratie peuvent être vues comme deux manières d’être de la même domination de classe, deux manières de gérer le pouvoir, deux manières d’ordonner les critères décisionnels… ».
Pas seulement, mais notre chieur d’encre assidu trouve aussi la perspicacité « taxinomique » de nous faire une énumération ou une « typologie » des nouveaux patrons ; fonctionnaires étatiques (« lesquels détiennent une part non négligeable du pouvoir décisionnel, du pouvoir politiques par-dessus tout et, à des degrés différents et en fonction de leurs compétences respectives, de pouvoir économique ») techno-bureaucrates qui se situent à l’échelon hiérarchique supérieur aux forces armées, dirigeants d’entreprises publiques qui se confondent – à un certain point – avec les dirigeants des grandes entreprises capitalistes, dirigeants politiques et syndicaux (« gestionnaires de la conflictualité sociale »). Et en conclusion de cette belle énumération il écrit : « Comme hier il est nécessaire que les prolétaires identifient dans la bourgeoisie un ennemi de classe et dans le système capitaliste une machine de domination et d’exploitation qui doit être démolie, ainsi, la lutte de classe ne deviendra pas une lutte consciemment révolutionnaire si l’identification d’un nouvel ennemi de classe dans la techno-bureaucratie ne devient pas tout aussi clair ».
Quelle étrange conclusion ! A-t-il pété les plombs ? Ces dernières affirmations ressemblent à des indications opératives. Mais, mystères de la grammaire.
Pourtant, ceux qui n’ont pas l’habitude de la grammaire pourraient les lire comme telles et les voir comme des éclaircissements pour la lutte. Tous ne sont pas habitués aux subtilités de la philosophie.
Maintenant, prenons, par exemple, un pauvre prolétaire malheureux, avec les couilles gonflées et les épaules courbées, lequel, attiré par le titre Les nouveaux patrons et sentant son esprit se soulever se dit : « Enfin ! Voilà des indications claires sur où je dois diriger la haine que j’ai accumulée toutes ces années ». Faisons attention, nous donnons un exemple, par amour pour la discussion, nous ne voudrions pas que quelqu’un nous accuse de dire, ici, que si demain on tue un général la faute revient au chieur d’encre qui l’avait inclus dans la liste des « nouveaux patrons ». Mais revenons à notre hypothèse. Donc, si un prolétaire voit cette énumération, et que, très remonté il se met à l’œuvre, si un groupe d’exploités s’organisent et prend cette liste – qui, notons-le, était publiée par notre chieur d’encre sous forme de catéchisme dans un autre cadre, plus large et sous le signe d’un mouvement politique entier – et qu’avec cette liste il se met à l’œuvre, disons dans les ministères, dans les casernes, dans les grandes industries, frappant justement cette classe qui – avec plus ou moins de perspicacité sociologique, là n’est pas le problème – a été identifiée et portée à l’attention des exploités, si cela arrive, que faisons-nous ?
Nous ne faisons rien. Si, comme l’écrit le même chieur d’encre (mais ça doit être une erreur de sa part), cette analyse sert à ce que la lutte révolutionnaire devienne plus consciente, nous ne nous arracherons pas les cheveux pour cela. Sinon, notre éminent professeur, repensera à ce qui est ci-dessus et, au moment de l’affrontement, ira-t-il s’enfermer à la bibliothèque récitant son mea culpa pour « avoir provoqué un scandale » ?
Et s’il trouve naturel d’écrire des choses de ce genre, des « taxinomies » non pas des végétaux mais de la classe des exploiteurs, pourquoi trouve-t-il aussi peu naturel que d’autres en fassent de même avec l’action ?
Comment se fait-il que sa perspicacité sociologique s’affaiblisse tout à coup et qu’avec une ineptie éhontée il en arrive à inclure dans la « bourgeoisie » les « ménagères qui votent DC [Démocratie Chrétienne] et croient les prêtres et Gustavo Selva, et les ouvriers qui se font État avec le PCI et les syndicats ? Ou pourquoi lui vient-il à l’esprit que l’on puisse comparer la proposition analytique qui nous vient de l’action d’Henry, avec une bombe dans un bar quelconque de la piazza di Duomo à Milan ou – mieux encore – en pleine via Etna à Catane ? Comment se fait-il que ces yeux si habitués à scruter dans la taxinomie de classe, se ferment désormais dans la plus complète cécité ?
Même mon souvenir de l’action de Bertoli et de la critique qu’à ce moment j’ai écrit sur cette action est un signe que la proposition analytique que j’avance dans ma recension [du livre d’Henry] n’a pas été comprise – ou mieux, que l’on n’a pas voulu la comprendre –. L’action de Bertoli ne fut pas une attaque de la bourgeoisie « dans le tas » comme veut la faire passer notre chieur d’encre, une attaque qui a mal tourné à cause d’une erreur de calcul, mais une attaque qui a mal tourné à cause d’une erreur d’évaluation analytique de l’objectif. Et l’erreur ne fut pas dans la plus ou moins grande longueur du lancer de la bombe, mais dans le choix de l’objectif. Et, comme j’ai eu l’occasion de le préciser à d’autres moments, cette erreur que même Bertoli ne peut pas nier, ne peut que s’attribuer à une carence analytique – incompréhensible pour moi – chez une personne qui se définit comme anarchiste individualiste. Voilà tout. Rien d’autre à dire sur la question Bertoli. En ce qui me concerne, qu’il mène maintenant ses batailles en prison ne peut que jouer en son honneur, mais ne change rien à l’évaluation négative de son action passée.
De plus, justement parce que je considère les actions contre les exploiteurs intéressantes, même celles que l’on indique par la phrase « frapper dans le tas », et justement parce que je retiens que dans l’action de Bertoli il y eut une carence de type analytique, c’est-à-dire une carence dans l’identification de l’objectif à frapper, je pense qu’il est d’une grande utilité d’approfondir le problème. En me jetant à la figure la critique que j’ai faite de l’action de Bertoli, on a voulu me mettre face à un obstacle qui n’existe pas. Si cette action avait été satisfaisante au niveau de l’objectif à frapper, j’aurais été parmi les premiers, en son temps, à la saluer comme bienvenue.
En conclusion, il y en a qui n’ignorent pas que dans toute cette affaire ils se sont comportés comme de vrais sourds. En premier lieu notre ami chieur d’encre, suivi de l’entière rédaction du journal qui a jugé opportun de se reconnaître « pleinement » dans son écrit. Mais personne n’a parlé de la proposition analytique, comme si la contrepartie s’était évaporée dans le néant, comme si, d’un moment à l’autre, l’affrontement de classe n’existait plus et, tous frères, nous pourrions embrasser nos exploiteurs.
Maintenant, je me demande très simplement. S’il existe une manière d’attaquer nos ennemis, si ces ennemis sont bien identifiés, si nous avons les moyens pour les attaquer, s’il y a quelqu’un parmi nous qui veut les attaquer, je me demande, comment doit être considéré celui qui cherche à retarder cette attaque avec des arguties philosophiques ? N’est-ce pas le moment de demander à ce type de quel côté de la barricade il se tient ?
Je comprends la critique sérieuse, même radicale, celle qui est souvent appelée critique critique, et qui risque de tomber, parfois, dans le règne abstrait de l’hyper-critique, mais le dénigrement, la fermeture déclarée à tout approfondissement, le refus d’admettre l’évidence, l’emploi des insultes pour couvrir les tentatives désespérées de récupération, comment doit-on les juger ?
De l’un et des multiples
Le concept de classe est parmi les plus difficiles à saisir, et ce n’est certainement pas le moment adapté pour l’approfondir. Il suffit de donner quelques affirmations très simples.
Un individu exploiteur s’identifie assez facilement. On peut dire que chaque exploité a à portée de mains un ou plusieurs exploiteurs, en commençant par l’affreuse catégorie des petits chefs, pour arriver à celle des cadres supérieurs et à celle constituée par les gros responsables.
Il est plus difficile de se rendre compte des mécanismes qui lient les responsables de l’exploitation entre eux.
Que les analystes hypercritiques fassent attention, parce qu’à vouloir aller jusqu’au bout, en partant de l’hypothèse des exclusions progressives, tellement que la responsabilité se transfère en arrière à l’infini, on se retrouve avec les mains vides : le conflit de classe s’éteint dans la neige de l’interclassisme.
Que le prêtre déguisé fasse attention quand, avec une tête à claque et la componction du meilleur jésuitisme au monde, il écrit : « Et que l’on ne vienne pas dire que tuer un flic est cohérent avec nos fins parce que ça élimine un instrument du pouvoir. Cela, c’est confondre les hommes avec les rôles, ce qui est éthiquement inique, logiquement idiot et stratégiquement fou. Comme de penser éliminer l’exploitation de l’agriculture en tuant les marchands de fruits et légumes, ou éliminer la religion en assassinant les curés de campagne. » Que cette digne personne fasse attention à ne pas répéter des idioties du genre quand elle se trouve aux côtés de quelques sous-prolétaires, de quelques ex-détenus qui ont subi des dizaines de jours de lit de contention, de quelques exploités vraiment enragés, parce que, dans le cas où ces personnes réussissent à temps à se remettre de la stupéfaction causée par la suprême idiotie de ces affirmations, elles lui casseraient la gueule sans se perdre en bavardages.
Mais, à part les risques physiques – dont je me fiche – que ce prêtre déguisé pourrait courir, reste le fait que cette phrase dénonce un état démentiel de putréfaction social-démocratique que nous n’avons jamais rencontré à l’intérieur du mouvement anarchiste. Et s’il reste un brin d’honnêteté au chieur d’encre, son digne compère, il lui sera impossible de ne pas admettre que mes vieilles critiques d’une certaine composante du mouvement anarchiste devaient avoir un certain fondement si de tels imbéciles font carrément partie de la rédaction qui s’est montrée « solidaire » avec lui.
La vérité, c’est que quand on affronte le problème du rapport entre l’un et les multiples, le vieil esprit chrétien de la faute et de la condamnation prend le dessus. L’individu exploiteur est pesé par l’intellectuel hyper-critique, ses responsabilités sont évaluées et, sur le plan éthique, on prononce une condamnation à son égard. Quand on a la classe face à soi, la classe des exploiteurs, sans la possibilité de quantifier immédiatement les différents degrés de responsabilité, on est pris de panique, soudain bondissent sous nos yeux les fantômes de l’indiscriminé, du tas, de l’innocent qui meurt à côté du coupable, du risque éthique que l’on court.
Je ne sais pas pourquoi, mais quand on parle des possibilités de considérer de manière plus large l’affrontement de classe, passant, de la phase des attaques individuelles, à des attaques plus larges, des attaques capables de frapper des objectifs plus vastes, des attaques directes contre les choses et les hommes du capital, on pense tout de suite au nazisme, on a en face de nous les hélicoptères du chah qui mitraillent les manifestants, les avions américains qui larguent les bombes atomiques sur le Japon, les bombardements à répétition, les génocides au Vietnam.
Qu’est-ce que tout cela a à voir avec le problème d’attaquer la classe des exploiteurs, cette classe que nous avons coutume d’appeler improprement la bourgeoisie, et la frapper – dans les limites du possible – dans ses hommes et dans ses propriétés ?
Pourquoi faire de tels parallèles ? Si on est de bonne foi, comme les quelques compagnons qui m’ont critiqué dans ce sens, mais avec honnêteté et clarté, il s’agit d’une simple erreur dans l’utilisation de l’instrument analytique : quelque chose n’a pas fonctionné dans l’identification de la classe adverse. Il faut faire tous les efforts pour éclaircir cette partie analytique, ne pas se retrancher sur les caractéristiques « a priori » concernant l’instrument qui est utilisé. Nous ne pouvons pas dire : c’est légitime d’attaquer la marchandise-capital, ça ne l’est pas d’attaquer l’homme qui mène l’exploitation. Comme nous ne pouvons pas dire : attaquer un individu exploiteur est légitime, ce n’est pas légitime d’en attaquer dix. Quel sens tout cela aurait-il ?
Maintenant, les multiples se différencient de l’un par conséquent du fait, très élémentaire, qu’ils se retrouvent ensemble, sont voisins, se dédient aux mêmes objectifs (c’est pour ça que la proximité physique n’est pas un accident marginal), ils parcourent la même rue. Et les exploiteurs se retrouvent ensemble, unis par l’instinct de classe, que la classe met instinctivement en marche, par les choix et les préférences de classe.
Une analyse de ces compositions et décompositions ne peut pas se limiter à une classification statique, même « actualisée » de temps en temps, elle doit être en mesure de saisir ces éléments dynamiques qui visent à caractériser la classe des exploiteurs de la même manière, sinon plus, que les éléments de plus longue durée.
L’appartenance aux grades élevés de l’armée – comme nous l’a montré l’éclairante analyse de notre chieur d’encre –, avec l’appartenance aux sommets dirigeants de l’administration de l’État, de la magistrature, des banques et des industries (privées ou publiques), constitue ce que nous pourrions appeler l’élément de persistance, ce que la classe comporte « dans le temps » avec une certaine constance. En effet, les officiers de l’armée, les magistrats, les députés, les hommes qui dirigent l’administration de l’État, des banques et des industries privées et publiques ne modifient pas leur « statut social » d’un jour à l’autre, ce genre de modifications est extrêmement long. Ce sont les relations dynamiques, qui contiennent une grande composante personnelle qui se modifient plus rapidement, et c’est sur cela qu’il faut réfléchir si l’on veut parvenir à une analyse de classe qui ne soit pas une doctrine vide laissée à la poussière des bibliothèques.
Il n’y a pas de doute que les exploités savent quasiment tous que les grades supérieurs de l’armée, de la magistrature, de l’administration de l’État, des banques, des entreprises industrielles privées et publiques ne sont pas seulement des « rôles », mais correspondent à des personnes physiques. Les exploités savent pertinemment – contrairement à notre prêtre déguisé ci-dessus – que si derrière chaque rôle il y a un homme, les responsabilités du rôle n’acquittent pas l’homme, sinon on aurait très bien pu donner une retraite et un diplôme aux criminels nazis, au lieu de les pendre à Nuremberg. Par conséquent, puisque la majeure partie des exploités, malheureusement, n’est pas habituée aux subtilités grammaticales, elle sait parfaitement que ces rôles correspondent à des personnes physiques bien précises. Ce qu’elle ne sait pas, c’est « où » ces personnes exécutent leur « travail », « de quelle manière »les contacts ont lieu entre elles, quelles sont leurs « préférences », leurs « goûts », leurs petites et communes « faiblesses » personnelles. C’est là qu’est le problème de la différence entre l’un et les multiples. Ce que beaucoup d’ « analystes » politiciens ont fait jusqu’à maintenant, c’est donner un grand nombre d’indications concernant les aspects statiques de l’ennemi, contribuant à développer dans l’âme des exploités la sensation que ces aspects constitueraient tout ce que l’on pouvait « savoir » sur ce sujet, et par là que « le reste » serait semblable à celui de tous les autres êtres humains, semblable à celui de tous les mortels. Les différences de classe, selon ces chercheursdu mystère révolutionnaire, étaient toutes dans le « rôle ». Aucune différence n’existait en dehors du rôle. Quand le général sortait du ministère de la défense, avec sa voiture de fonction, escorté par ses braves gardes-du-corps, c’était encore un général, mais dès qu’il arrivait à son domicile, mettait son uniforme dans l’armoire et s’asseyait à table il cessait d’être un général et devenait un homme comme tous les autres. Voilà ce que l’on a dit jusqu’à maintenant. Personne n’a cherché à aller au-delà et à expliquer que, même sans l’uniforme, le général reste un général, et que son repas tout juste terminé il retrouvera d’autres généraux, des magistrats, des hommes d’affaires, des gens de « son rang », de sa « classe » et que durant ces rencontres son esprit sera constamment occupé à perfectionner le mécanisme de l’exploitation, parce que c’est l’unique but que son appartenance de classe lui assigne. Personne n’a dit que ce sont justement ces relations dynamiques et « personnelles » qui habillent de chair et de sang le squelette muet du « rôle », personne n’a cherché à approfondir le contenu réactionnaire de ces relations.
Et c’est vraiment stupéfiant de voir que quand un sujet du genre est affronté, de manière approximative et occasionnelle – comme peut justement l’être la rubrique de la recension d’un livre – non seulement on ne cherche pas à l’approfondir, mais on saute comme des chiens enragés sur celui qui a osé toucheràla limite « sacrée ».
En revenant aux relations de type « dynamique », le grand intérêt que celles-ci recouvrent du point de vue révolutionnaire nous frappe immédiatement. En effet, il ne s’agit nullement de cette « indiscrimination » que les critiques malveillantes ont relevé, comme si seul le « rôle » était clair et distinguable et pas la relation au-delà du rôle. C’est cette relation qui enrichit le rôle, qui l’élargit, qui le situe à l’intérieur de la classe. Un magistrat, tout le temps enveloppé dans sa toge et dans l’exercice de ses fonctions n’est rien d’autre qu’une machine pour appliquer les lois. Puis, dans ses relations dynamiques, il devient un homme responsable de l’oppression et de l’exploitation, il devient un exploiteur, et dans cette phase dynamique de son être responsable, il s’approche des autres exploiteurs, il dépasse les limites de la caste, de l’association, et s’ouvre aux horizons plus vastes de sa classe. Mille indications nous sont utiles pour saisir les moments de cette ouverture, et ces moments correspondent aux attachements, aux goûts, aux choix, aux préférences, aux tabous et aux fréquentations que cet homme met en œuvre, aux lieux qu’il fréquente, aux entourages qu’il choisit, aux moyens de communication qu’il utilise, aux instruments culturels et idéologiques qu’il manipule et par lesquels il est manipulé. Tout ce gros trousseaud’interventions dynamiques dans la réalité constitue cette autre partie de l’analyse de classe qui dépasse l’étroite limite du rôle, qui respecte la domination de la structure mais qui – en adéquation avec l’analyse sur laquelle les anarchistes ont insisté depuis longtemps – n’en indique pas les frontières comme quelque chose d’infranchissable.
Si frapper un magistrat, ou dix magistrats, peut être discutable au niveau stratégique, en raison des conséquences inévitables que le fait comporte, soit vis-à-vis des perspectives révolutionnaires du mouvement, soit – plus largement – vis-à-vis des perspectives de libération des exploités – et sur ce sujet on a longuement discuté, des thèses opposées ont été développées mais dans l’optique de la clarification des problèmes – il n’y a aucun doute que ce n’est pas pour cela que le magistrat cesse d’être un exploiteur et que dix magistrats mis ensemble cessent d’être dix exploiteurs mis ensemble. On peut discuter autant qu’on veut, cette vérité ne pourra jamais être contredite, parce que sinon on devrait affirmer que l’on ne doit pas attaquer les exploiteurs mais qu’au contraire on doit les aider dans leur travail d’exploitation, parce que cela est utile à quelque chose. Donc, vu qu’aucun révolutionnaire ne pourra jamais en arriver à dire cela (et encore moins un anarchiste) l’affirmation selon laquelle un magistrat ou dix magistrats sont des exploiteurs reste valide, et la discussion – si discussion il doit y avoir – doit se limiter aux problèmes stratégiques et non pas éthiques.
Maintenant, une nouvelle fois, je me demande : pourquoi l’action qui a comme but de frapper dix magistrats en une fois, plutôt qu’un seul, devrait être considérée comme une action « indiscriminée » a priori, et pas, comme on l’a dit avant, soumise au contraire à une critique de nature stratégique, comme toute autre action révolutionnaire que l’on suppose théoriquement réalisable ?
D’où vient la légitimité logique que le nombre comporte automatiquement le concept d’ « indiscrimination », alors que la discrimination est basée essentiellement sur l’affrontement de classe ?
Ce n’est pas parce que dix exploiteurs se rassemblent qu’ils cessent d’être des exploiteurs. Chercher à les attaquer doit donc, – à mon avis – être soumis à une évaluation critique de nature stratégique, et ne peut autoriser personne à affirmer qu’il s’agit d’une frappe dans le tas « indiscriminée », sachant que le « tas » des exploiteurs dont on discute est tout autre qu’indiscriminé, mais est parfaitement mis en lumière par la position de classe.
C’est donc une déformation dégueulasse de la réalité quand notre chieur d’encre affirme : « Pour le moment, dans cette recension, on pose encore une limite à l’indiscrimination de la violence : dans le tas de la bourgeoisie ». Ce n’est pas vrai du tout que cette limite est posée « pour le moment », c’est une limite qui existe depuis toujours pour tous les révolutionnaires, et qui existera pour toujours, étant donné que l’attaque que ces derniers mènent est contre les exploiteurs, et qu’il ne peut pas exister de confusion, comme cherche à l’introduire sournoisement le concept d’« indiscrimination ».
Par conséquent, s’il faut parler de quelque chose, c’est d’évaluation stratégique, et qu’on ne crie pas comme des poules qu’on déplume, invoquant bêtementla sauvegarde des « valeurs humaines », que personne n’a jamais songé à mettre en doute. Ce sont justement les exploiteurs qui nient la valeur de la vie de ceux qui, chaque jour, sont tués sur les lieux de travail et de cent autres manières, sans que la chose ne suscite autant d’indignation et de préoccupation chez notre chieur d’encre et chez son digne compère, le prêtre déguisé.
Des marchandises et des hommes
« Marchandises et hommes…Mais tant vont les noms aux choses que les êtres les perdent. »
Raoul Vaneigem
Mais pourquoi insister sur l’attaque des êtres, et ne pas approfondir le discours sur comment et pourquoi frapper les marchandises, les technologies, les mécanismes ?
Parfaitement d’accord.
Encore une fois, nous nous trouvons face à une équivoque. Ceux qui, dans mon affirmation à considérer l’action plus large, contre l’ennemi de classe, ont vu comme une « préférence » naturelle pour l’attaque contre les hommes et une évaluation négative de l’attaque contre les marchandises, n’ont pas tenu compte des indications précises qui proviennent de la même analyse de classe que l’élargissement de l’attaque rend possible, c’est-à-dire ce passage de la vision « statique » des rôles, à la vision « dynamique » des relations.
Le caractère statique du rôle fixe l’homme dans l’image que le capital apprécie, celle de la division du travail, dont dérivent les différents comportements auxquels il est logique de s’attendre, et dans lesquels les « états » des individus trouvent leur fondement. Dans le projet de transformation de l’homme en marchandise, le capital a besoin du rôle, de la même manière qu’il a besoin de la division du travail. La production de l’homme-marchandise est l’une des conditions spécifiques, pour que se mette en marche cette production plus large qui garantit la persistance du capital : la production de la paix sociale. C’est l’instinct de révolte qui est tué dans l’homme transformé en marchandise, tout comme, dans la chose transformée, sont tuées l’originalité de son usage et sa signification artistique.
L’équation homme-marchandise a été réalisée par le capital, et correspond à sa vision du monde, une vision productiviste. Il ne faut pas se faire d’illusion, il n’y a pas que les producteurs qui sont transformés en marchandises, pauvres malheureux qui s’amassent devant les grilles des industries, mais aussi les personnages importants, les grands responsables de l’exploitation. Dès que quelque chose va maldans le fonctionnement de la répartition des rôles, on se rend compte que cette loi du capital vaut aussi pour ces derniers. Il suffit de penser à Aldo Moro, pour se rendre compte comment d’un jour à l’autre, cet homme qui semblait dominer la scène du commandement politique, s’est vu transformé en marchandise, et combien il a été stupéfait par cette découverte, contribuant à accroître la stupéfactiongénérale.
Le capital a besoin de ces processus de nivellement pour construire le passage des productions particulières, donc des processus d’accumulation particuliers, à la production en général, ce processus complexe – qui se profile avec toujours plus de clarté – qui unifie toutes les accumulations séparées dans la production de la paix sociale. Il serait faux, selon moi, de dire que le capital « anéantit » l’homme, le transformant en marchandise, et que le capital est donc la véritable et unique force « nihiliste », sachant que cette affirmation rend confuse l’action concrète que le capital réalise et, par ailleurs, attribue au terme « nihiliste » un sens que celui-ci ne possède pas.
En transformant l’homme en marchandise, le capital ne veut pas « détruire » l’humanité de l’homme, il veut seulement employer, de la manière la plus rationnelle possible, un instrument de la production. Sa capacité à détruire l’humanité de l’homme est totalement involontaire, une conséquence du processus de production. De ce fait, l’action du capital n’est jamais totalement destructive, mais est « constructive » d’après ses règles, règles qui, traduites dans le sens des valeurs prolétaires, deviennent capables d’anéantir les valeurs humaines et de transformer, justement, l’homme en marchandise.
Au contraire, la capacité destructive organisée des exploités est implicitement une capacité constructive dans le sens de la libération parce qu’elle est destruction du travail, de l’accumulation, de la production de paix sociale, du projet du capital de changer l’homme en marchandise. Ce projet destructif, celui des exploités, ne peut être considéré comme égal à celui du capital, ils ne peuvent pas être comparés, même si bien souvent nous sommes obligés, par abus de langage, de recourir à l’usage de mots qui sonnent de manières identiques. De ces limitations linguistiques dérivent les confusions idéologiques qui sont alimentées – en bonne et mauvaise foi – par ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas approfondir le problème.
Pour cela, même avec la meilleure foi au monde, dire que le capital est « la force la plus nihiliste de notre temps » est, en même temps, juste et faux, au regard du sens du terme « nihiliste ». La destruction que le capital réalise n’a rien à voir avec celle que les exploités ont réalisée et réaliseront jusqu’au moment de leur libération définitive. Et cela n’a qu’une importance marginale si, selon les goûts, on donne au terme « nihiliste » une signification positive ou négative.
Personnellement je pense qu’il faudrait éviter d’avoir recours à des mots à l’usage douteux pour se cacher derrière.
La destruction de l’humanité de l’homme est inconsciemment réalisée par le capital, au cours de la transformation de l’homme en marchandise : le projet conscient du capital c’est la coordination des productions afin de mettre en œuvre cette production intégrée qui réalise la paix sociale.
La destruction du projet du capital est réalisée par les exploités, au cours de l’affrontement de classe, de manière consciente : le projet révolutionnaire dépend justement – pour son développement – du niveau de cette conscience.
Il ne s’agit donc pas d’être plus ou moins destructifs que le capital, ou, si on préfère, plus ou moins « nihilistes ». Aucune logique « concurrentielle ».
Frapper les exploiteurs (dans le « tas ») n’est pas une proposition visant à mener le mouvement révolutionnaire à des niveaux d’affrontements « concurrentiels » avec le pouvoir. Aucune proposition ne peut faire cela, aucun écrit – aussi « incendiaire » soit-il – ne peut traduire en réalité ce que seule la consistance réelle de l’affrontement de classe peut réaliser. Donc, que les hystériques qui sont « préoccupés » restent calmes, et que les compagnons qui ne sont pas préoccupés mais qui n’ont pas approfondi le problème comme il se doit (du moins à ce qu’il semble) réfléchissent mieux. Discuter du geste d’Henry, en dehors d’une concrète confrontation de classe en cours, n’est pas plus dangereux que de discuter du sexe des anges. C’est seulement quand la confrontation existe et agit sur la conscience des exploités, que la discussion même du geste d’Henry peut avoir son importance, ses conséquences, sa signification. Et, jusqu’à aujourd’hui, personne n’a donné d’indications critiques suffisamment convaincantes qui puissent se conclure par une condamnation, a priori, d’une quelconque tentative directe de frapper les exploiteurs « dans le tas ».
Il faut faire ces critiques, mais de telle manière qu’elles nous donnent des informations ultérieures concernant la possibilité d’identifier ce « tas » (qu’elles soient donc des instruments pour une analyse de la classe des exploiteurs), qu’elles développent des considérations de nature stratégique concernant les perspectives du mouvement révolutionnaire dans son ensemble, qu’elles traitent des conséquences qui pourront être déterminées dans les rapports entre minorité révolutionnaire et mouvement des exploités.
Il faut aussi faire les critiques sérieuses qui traitent du rapport entre les moyens et les fins, mais il faut qu’elles soient approfondies. Qu’elles nous fassent voir comment les fins ne sont pas figées de manière stable et pour toujours, mais que la lutte de classe les modifie, qu’il devient illusoire d’affirmer, de manière vague et générique, que ces fins sont la libération de l’homme, si ensuite on n’est pas en mesure de donner des indications concrètes sur l’action idéologique que le pouvoir exerce sur la masse, la poussant à refuser elle-même sa propre libération. Il faut que ces critiques nous donnent ledit rapport entre moyens et fins non pas comme quelque chose de « sacré », instrument pour émettre des excommunications dans les affrontements de ceux qui s’entêtent à étudier les moyens, mais comme un problème ouvert que l’on approfondit, pas tant pour faire prévaloir notre « théorie » mais pour indiquer aux exploités les dangers des « solutions » avancées par les forces contre-révolutionnaires qui se déguisent en révolutionnaires.
Enfin, il faut préciser que quand nous parlons d’élargir le front de l’attaque, nous ne voyons pas pour quel motif on ne devrait pas faire entrer dans le concept tant discuté de « tas » l’attaque des marchandises, des technologies, des cycles de production, des mécanismes. Justement, le dépassement du caractère statique du rôle doit rendre plus facile, nous semble-t-il, le passage à l’interprétation dynamique du concept de classe, interprétation qui comprend les interactions entre l’ensemble des hommes et des choses qui constituent le capital et qui organisent et rendent possible l’exploitation.
Du terrorisme
« En Italie les terroristes ce ne sont que les fascistes »
(Banderole exposéeau cours d’une rencontre anarchiste)
Un célèbre exemple de comment notre chieur d’encre sait manipuler la réalité des choses, en ayant aussi recours au mensonge – avec une technique à faire envie à ses collègues journalistes comme Pellicani – nous est donné par son affirmation : « Et ici nous vient irrésistiblement à l’esprit l’image photographique d’Alfredo Maria Bonanno (publiée dans un opuscule édité par « La Fiaccola » il y a quelques années) qui tient unmeeting du haut d’une estrade sur laquelle on remarque une grande inscription : Les bombes ce sont les fascistes qui les mettent ».
Au contraire, sur cette « image photographique », publiée par « La Fiaccola », dans un de ses opuscules (le n. 20 de la « Colonne La Révolte »), publié alors que je me trouvais en prison, apparaît clairement l’écrit : « En Italie les terroristes ce ne sont que les fascistes ».
Qu’en est-il ?
Évidemment c’était commode pour notre ami de me faire indirectement affirmer que seuls les fascistes utilisent les bombes, de la même manière qu’il cherche à me faire affirmer que si le discriminant entre compagnons et non compagnons est le P38, alors les fascistes du NAR sont aussi des compagnons. Non mon cher, laisse cette technique diffamatoire et policière à tes dignes compères, ceux qui écrivent sur « L’Europeo », elle n’est absolument pas digne d’un anarchiste. Et comment expliquez-vous, vous qui êtes si attentif au moment éthique – et je parle au pluriel, vu que toute la rédaction de la revue a souscrit sa responsabilité à l’article –, comment expliquez-vous que vous ayez recours au mensonge pour vous donner raison ? En effet, l’affirmation que le terrorisme est seulement celui fasciste était extrêmement commode, en particulier après avoir insisté pour parler de « terrorisme » anarchiste.
Qu’on le dise une fois pour toutes, avec clarté, le terrorisme est seulement celui de l’État, des fascistes et des patrons. Chaque fois que les compagnons, pour une nécessité malvenue de distinction, utilisent le terme « terrorisme » pour désigner les actions de lutte armée menées à leur terme par des compagnons – peu importent les organisations dont ils font partie –, ils ne font rien d’autre que creuser la tombe sous les pieds du mouvement révolutionnaire.
Ce n’est pas une simple question linguistique, mais un problème objectif. Pour exercer une pression sur les masses, le pouvoir fait un usage très large du mot terrorisme. L’objectif des idéologues du pouvoir est de convaincre les gens que les terroristes nous menacent tous indistinctement, aussi bien les grands responsables de l’exploitation que les ouvriers et les pauvres gens. Le pouvoir veut faire apparaître le « terrorisme » comme quelque chose d’indiscriminé, une pression occultequi frappe tout le monde aveuglément. Le pouvoir cherche ainsi à convaincre le travailleur exploité que, le matin, en allant au travail, il pourrait se retrouver devant un terroriste qui lui tire dessus, que quelqu’un pourrait séquestrer son fils, ou pourrait faire sauter sa maison. Il est évident que ce projet du pouvoir ne réussit pas du tout à infiltrer ni ébranlerles strates prolétaires et sous-prolétaires, les travailleurs savent pertinemment vers qui est destinée la violence de ceux que l’État appelle « terroristes », mais à lui tout seul le mot fait son effet, et l’absence de clarification fait le reste.
Maintenant, ces compagnons qui cherchent à augmenter cette absence de clarté, avec leurs distinctions qui finissent par ne plus rien distinguer du tout mais au contraire par confondre encore plus les choses, ils sont responsables eux aussi de la même mystification que celle que le pouvoir met en œuvre, ils sont eux aussi – involontairement – collaborateurs de la répression.
Les terroristes ne sont pas ceux qui s’opposent au pouvoir avec violence pour le détruire, mais ceux qui emploient des moyens violents et impitoyablespour garantir la perpétuation de l’exploitation. Donc, puisque seule une étroite minorité est intéressée par la perpétuation de l’exploitation (patrons, fascistes, politiciens de tout acabitet de toutes couleurs, syndicalistes etc.), c’est logique d’en déduire que les « vrais » terroristes sont justement ces derniers, puisqu’ils adoptent des moyens violents pour perpétuer l’exploitation. Et la violence de ces gens se réalise dans la force de la prétendue loi, dans les prisons, dans l’obligation de travailler, dans le mécanisme automatique de l’exploitation.
La rébellion des exploités n’est jamais du terrorisme.
Bien sûr, on peut réfuter ces affirmations très facilement : si la masse des exploités se rebellait, alors il ne s’agirait absolument pas d’actions terroristes mais de la révolution, un point c’est tout.
Et si nous ne voulons pas attendre que la masse des exploités se rebelle ? Si nous ne voulons pas attendre le « grand jour », et commencer maintenant, tout de suite, à faire quelque chose, à cesser de se défendre et passer à l’attaque du pouvoir ? Si, en harmonie avec les principes anarchistes, nous voulions pousser les exploités à la révolte en nous rebellant en premier ? Que serions-nous, pour avoir fait cela ? Serions-nous des terroristes ? Et à qui incomberaitla tâche de nous juger comme tel ? Au pouvoir qui a tout intérêt à le faire, aux exploités souvent courbés sous l’oppression physique et idéologique du pouvoir, ou aux compagnons ? Qui seraient nos juges ?
Mais, quelqu’un pourrait nous dire : une fois que ces minorités qui se rebellent et attaquent l’État, se déclarent « parti armé », ne sommes-nous peut-être pas face à un nouvel ennemi, tout aussidangereux que celui que l’on veut abattre ? Juste, pourrions-nous répondre, mais la critique que nous faisons à ces « partis armés » ne nous autorise pas à être de mesquins laquais du pouvoir, elle ne nous autorise pas à jeter ces compagnons en proie aux bourreauxde la réaction. Cette critique doit être honnête, et pour l’être elle doit aussi parler clairement du problème du terrorisme.
Pour nous attarder un moment sur le problème, notons que le terroriste doit être celui qui veut terroriser les autres, qui veut obtenir quelque chose en imposant son point de vue avec des actions qui défendent la terreur.
Maintenant, il est clair que les exploités sont terrorisés par le pouvoir de cent manières. En effet ces derniers ont peur de ne pas pouvoir travailler, ont peur de la misère, ont peur des lois, des policiers, de l’opinion publique, ils subissent un terrorisme psychologique considérable qui les réduit à une situation de soumission quasi totale vis-à-vis du pouvoir. C’est ça le terrorisme.
Quand ils sont tués sur leurs postes de travail, dans la rue, dans des actions de rébellion sporadiques au cours desquelles ils cherchent maladroitement à reprendre tout ce qui leur a été pris, personne ne dépense un seul mot pour eux, mais tous hurlent en chœurpour les risques que la paix sociale et la propriété ont couru.
Cette situation ne peut pas être renversée par une minorité armée. C’est-à-dire qu’il n’est pas possible que ces exploiteurs, qui ont fait de la terreur l’instrument de leur propre pouvoir et de leur raison d’exister, se soumettent au régime de la terreur. Ce n’est pas possible parce que la terreur n’est pas seulement provoquée par une réaction physique immédiate à une menace que nous subissons mais, bien plus profondément, elle est la conséquence d’une situation générale dans laquelle nous vivons.C’est pour cela que l’on pourrait soumettre les exploiteurs à des menaces physiques pendant longtemps sans les terroriser et sans les faire renoncer à leur rôle, auquel ils sont contraintspar la répartition du processus productif et du pouvoir. Concrètement, aujourd’hui, nous voyons que de nombreux grands et moyens responsables de l’exploitation vivent en bunker, entourés de gardes du corps, constamment sous l’impression d’être menacés, mais est-ce que cela nous permet de dire qu’ils « sont terrorisés », et, plus encore, que cela leur remettrait justement les idées en placeet qu’ils deviendraientplus « bons » ? Absolument pas. Ils ne peuvent que continuer dans leur activité d’exploitation, de la même manière que les prolétaires qui continuent à mourir sur les lieux de travail ne peuvent que continuer à aller au travail.
Ce n’est certainement pas avec la « terreur » que l’on modifie les rapports de force et les rapports de production.
Et alors, quel sens a la lutte armée ? Que peut signifier attaquer les exploiteurs et leur propriété ?
Une des explications est celle qui se réfère à la soi-disant « désarticulation » de l’État, c’est-à-dire à cette tentative qui entend attaquer, à ses différents niveaux, les coordinations internes sur lesquels repose le mécanisme du pouvoir. Sur ce point, les Brigades Rouges ont avancé leurs analyses, parlant même de la possibilité d’identifier le « cœur » de l’État. Le sujet a été approfondi et éclairci, en voyant comment il serait pour le moins problématique d’identifier ces points névralgiques et comment ne peuvent pas se désarticuler, de cette manière, les relations structurelles du pouvoir. Au mieux on pourrait créer des difficultés, contraignant le pouvoir à une rationalisation des processus productifs. Mais même ce sujet il faudrait mieux l’approfondir, et il ne me semble pas que cela ait été fait.
Il existe aussi une explication plus plausible : celle de l’attaque de longue durée contre l’ennemi de classe, attaque qui n’offre pas de résultats immédiats, mais qui s’intègre à l’intérieur d’une confrontation stratégique qui voit d’un côté la croissance du mouvement révolutionnaire et de l’autre l’aggravationd’une situation de crise des rapports structurels et de la production. La justification éthique, pour ce type d’attaque, me semble suffisamment identifiable dans l’exploitation elle-même. Ellesseraient alors vraiment superficielles ces questions qui visent à freiner l’élan révolutionnaire, en mettant des obstacles sur sa route du type : « derrière le rôle existe l’homme », ou « nous devons avoir le maximum de respect pour la vie humaine ». Il suffit de penser que ceux qui hurlent le pluspour le respect de la vie humaine sont justement ceux qui massacrent de sang-froid dans les rues et les usines et partout où ont lieu les épisodesde la lutte de classe.
Aujourd’hui, en Italie, la lutte armée se développe dans un sens que les anarchistes aussi devraient trouver juste. Négation progressive du caractère irremplaçable du parti armé et diffusion sur le territoire des attaques violentes à tous les niveaux, contre les réalisations du capital et contre les hommes du capital.
S’écroulent alors les objections de ceux qui soutiennent une différence nette entre « lutte armée » et « travail politique de masse », imaginant que ceux qui participent aux attaques violentes contre le pouvoir, et qui donc se retrouvent à agir dans la sphère des formes organisées et non-organisées de la lutte armée, devraient nécessairement « entrer en clandestinité », couper tout rapport avec leur vie de toujours et avec leur travail et incarner le type parfait du guérillero tiers-mondiste. Justement la négation progressive de la validité du parti armé de type léniniste amène à admettre que l’attaque violente et armée contre le pouvoir doit être diffusée sur le territoire et structurée de manière à éviter la rupture que la clandestinité rend inévitable. Aujourd’hui tout cela est possible, c’est pour cela que persister dans ces formulations manichéennes : lutte armée ou lutte de masse, comme le font certains compagnons, ne peut que contribuer à créer une atmosphère de criminalisation au détriment de ces compagnons qui comptent refuser cette distinction.
Des mouches cochères
« Notre intention n’est pas… tant de discuter et donc d’argumenter… mais plutôt de témoigner de notre indignation et de notre préoccupation ».
(Chieur d’encre)
« Nous considérons comme dramatiquement faux leur choix (celui de la lutte armée) pour eux avant tout et pour le mouvement : toutefois nous nous rendons compte qu’il serait ridiculement inutile d’en discuter ici et maintenant. Nous voudrions seulement que ce choix ne signifie pas – comme trop d’éléments le laissent présager – un suicide éthique de leur et de notre anarchisme ».
(Prêtre déguisé)
« Nous ne voudrions pas nous retrouver pour les cinq années à venir à devoir employer toutes les énergies du mouvement pour expliquer que nous sommes de nouveau victimes de « provocation ».
(Chieur d’encre)
Si ce qui a été écrit est vrai, que le plus grand malheur de Don Quichotte ce ne fut pas ses illusions mais Sancho Panza, cela reste aussi valide pour la situation du mouvement révolutionnaire aujourd’hui.
Il y a, parmi nous, de braves personnes, au grand cœur et pleines de sollicitudes pour les problèmes des autres, qui ne veulent d’aucune manière que les forces vives du mouvement s’engagent dans des voies dangereuses. Elles sont prêtes à tout pour cela, même à la délation, à la dénonciation publique, à la marginalisation de ceux qui comptent alimenter un débat qu’eux considèrent comme dangereux. De plus, l’un des éléments le plus utilisé pour le discréditer est justement celui de l’impossibilité de débattre sur certains sujets – comme la lutte armée – parce que les seuls qui seraient autorisés à se saisir du problème sont ces compagnons qui vivent en clandestinité, ou ces compagnons qui se trouvent en prison, déjà frappés par la répression. Et cela sur la base du raisonnement que ces compagnons ont « les cartes en main » pour pouvoir parler de lutte armée, l’ayant eux-mêmes vécu et pratiqué. Les autres, ceux qui ne se trouvent pas en prison, qui ne se trouvent pas en clandestinité, n’ont pas le droit de parler de ces problèmes, car ce serait comme dire : « armons-nous et allez-y, vous ».
Et si quelqu’un s’obstine à parler de telles choses, il est criminalisé, ou bien il est désigné comme provocateur, ou bien – si cela ne demeure pas matériellement possible – il est ridiculisé avec les techniques de mystification journalistiques les plus raffinées : du silence aux fausses excuses, du mensonge aux injures.
Cette manière d’agir est « éthiquement » justifiée au nom des intérêts du mouvement. Ces vestales, gardiens du temple sacré du mouvement révolutionnaire, lâchent leur meute dès que quelqu’un se hasarde à mettre les pieds sur le terrain qu’ils ont eux-mêmes qualifié comme dangereux.
Je pense que de tels comportements sont condamnables et qu’ils doivent être remplacés par la méthode plus correcte de la critique et de l’approfondissement. Personne ne peut s’arroger le droit de s’autodéfinir gardien du trésor du temple, mais chacun peut, personnellement, apporter sa contribution critique aux problèmes, du point de vue qu’il considère comme important à défendre. Cela s’appelle de la bonne foi, et face à la bonne foi on est disposé différemment que devant l’attaque venimeuse et colérique d’un misérable groupe d’intellectuels terrorisés par l’éventualité que quelqu’un veuille « suicider » leur anarchisme. Par pitié, qu’ils se la gardent leur momie desséchée. Nous préférons de loin l’anarchisme que les masses des exploités et les minorités révolutionnaires cherchent jour après jour à réaliser, avec toutes leurs erreurs et leurs limites, plutôt que cet anarchisme de musées et de salles d’anatomies.
Et pour cet anarchisme, qui s’est finalement décidé à passer à l’attaque, nous sommes prêts à nous battre.
Appendice
Recension de E. Henry, Coup pour coup, Bergamo, Edizioni Vulcano, 1978, 174 pages, publiée sur Anarchismo n. 23-24, 1978.
Un recueil contenant une biographie d’Émile Henry, deux lettres, le compte rendu du procès, quelques aphorismes, et un appendice avec une lettre intéressante de Malatesta et une correspondance inutile tirée du « Petit Journal ».
Le petit volume, il faut le dire tout de suite, présente un problème qui dépasse de très loin le stupide louvoiement des historiens, même des historiens de l’anarchisme : le geste d’Henry fut quelque chose d’effrayant, quelque chose qui secoua non seulement la soi-disant « opinion publique », mais également les compagnons. Et la lettre de Malatesta, insérée en appendice, est un exemple de cette perplexité, saisie par l’anarchiste italien et d’une certaine manière justifiée, mettant en avant la prudence, cette même prudence qui, quelques années avant, avait poussé des gens comme Kropotkine et Grave à hurler au « provocateur » à l’égard de Ravachol.
Mais prenons les choses dans l’ordre.
Ce n’est pas vrai du tout que le geste d’Henry s’intègre dans la chaîne des attentats et des attaques que les anarchistes « fin de siècle » réalisèrent contre les institutions et leurs représentants. Le geste d’Henry opère un « saut qualitatif » qui a été saisi, bien que de manière un peu floue, y compris par les compagnons qui à ce moment se trouver à lutter contre la répression.
Ce jeune, cultivé et intelligent, prend avec froideur une décision que d’autres avaient réfléchi et compris, mais pas réalisé : il attaque la bourgeoisie, pas tel ou tel représentant de l’institution étatique, tel ou tel policier, magistrat, tortionnaire, bourreau, espion ou traître, non : toute la bourgeoisie. Il frappe dans le tas, sans discriminations. Il choisit avec soin un des lieux que cette classe fréquente, s’y rend avec son engin infernal, allume la mèche, lance la bombe et s’en va.
De plus, il essaie d’échapper à la capture. Ce n’est pas un martyr, c’est un guérillero, il ne veut pas se sacrifier, il veut continuer sa lutte, il veut continuer à frapper dans le tas. Pour cette fuite, il cherche à couvrir sa retraite, tire pour se défendre, aussi longtemps qu’il n’est pas prisonnier dans les mains de l’ennemi. Et là, une fois pris, il ne demande pas la pitié, il ne se retire pas dans un mutisme d’ailleurs justifiable : il fait du procès une tribune pour illustrer et expliquer son geste envers et contre tous (y compris des compagnons). Il ne cherche pas de circonstances atténuantes, ne parle pas d’ « erreurs », mais dit clairement qu’il a cherché à frapper dans le tas, sans discrimination préventive, parce que c’est dans le tas que se nichent justement ces coupables de l’exploitation qui sont moins identifiables, les représentants de cette classe de boutiquiers, respectable, réactionnaire, sanfédiste, prête à accourir dans les places où on guillotine, prête à applaudir n’importe quel sous-produit napoléonien, prête à se mettre aux pieds du dictateur de service.
Une analyse du concept de classe est incluse dans le geste d’Henry. Pas tant dans ses lettres ou dans son débat au procès, que dans le geste en soi. Le comportement collectif de la bourgeoisie comprend, de façon bien définie, en tant que classe au pouvoir (ou soutien direct du pouvoir) une conscience de classe adaptée aux relations spécifiques des rapports de force (idéologiques et économiques). La classe bourgeoise sait ce qu’elle veut, et la frange des boutiquiers le sait encore mieux que la moyenne et la haute bourgeoisie. Et cette conscience de soi, elle la manifeste aussi dans les passe-temps, dans le divertissement, dans le choix d’un café, d’un restaurant, d’un bordel, d’une croisière, d’un lieu de vacances. La sélection qui s’opère dans ces lieux n’est pas seulement déterminée par le prix des produits, des services et de ce qu’il convient d’avoir avec soi pour s’y rendre, mais elle est déterminée par l’air même que l’on y respire, par l’atmosphère qui y a été créée « exprès », par le choix des accoutrements, des bibelots, des encadrements, des miroirs, des verres et de la moquette. Un prolétaire – aujourd’hui encore, malgré la contamination causée par le consumérisme omniprésent – mettrait rarement les pieds au Caffé Greco, à Rome, et si par erreur il se retrouvait à l’intérieur, il en fuirait rapidement, pas tant à cause des prix effrayants qui s’y pratiquent, mais plutôt parce qu’il se sentirait étranger à cette atmosphère qui y a été créée et que l’on sent comme quelque chose de solide, une atmosphère qui avec une simple évaluation superficielle, peut être rapporté à la nécessité du capital de « vendre ». Il ne s’agit pas ici des lieux de masse où on sacrifie au dieu « marchandise », il s’agit d’autres lieux, plus intimes et conviviaux, où le sacrifice à la religion de la « marchandise » se fait de manière plus raffinée, d’une manière accessible à peu de personnes, d’une manière qui opère une sélection automatique et qui se reflète – presque sans faute – dans l’adéquation de la conscience de classe bourgeoise à la situation des rapports de force en jeu aujourd’hui.
Il ne faut pas dire que la situation historique de la fin du 18ème était différente de la situation présente, et que ces lieux étaient alors beaucoup plus « isolés » qu’ils ne le sont aujourd’hui, parce que la bourgeoisie encore au sommet de l’exploitation coloniale se sentait sûre d’elle et voulait se récompenser avec des bordels et des cafés autant qu’avec des églises et des monuments à sa victoire. Aujourd’hui aussi, dans une phase de transformations sociales profondes, la bourgeoisie conserve une certaine conscience d’elle-même, au moins ces franges qui n’ont pas été irrémédiablement aspirées dans le gouffre de la criminalisation suite aux difficultés, pour le capital, de maintenir un niveau d’emploi suffisamment élevé. Mais ces autres franges, celles qui ont des garanties, celles qui se sont même engrossées avec l’arrivée d’autres groupes – avant prolétaires – sont aujourd’hui le noyau réactionnaire le plus cohérent et le plus difficile à secouer. Et ce noyau, cet amalgame d’intérêts et de laideur, de langage familier et d’imitations écœurantes des splendeurs passées, ce noyau se retrouve dans les mêmes lieux aujourd’hui, dans les mêmes cafés, dans les mêmes bordels.
Voilà. La chose la plus drôle (et, en même temps, la plus tragique) c’est que ce noyau réactionnaire a endossé les attitudes du baratin progressiste de la soi-disant gauche, et pour mieux solidifier la conscience de son statut social, elle a rejeté les habits dépassés d’une réaction qui s’habillait de noir (et qui ferait rire aujourd’hui) pour endosser les habits d’une réaction qui s’habille de rouge et qui ne fait plus rire mais fait peur.
Voilà. Frapper dans le tas, aujourd’hui, si longtemps après le geste d’Henry, non seulement ce serait un geste valide mais ce serait aussi une contribution théorique pour le mouvement, un saut qualitatif, une fois encore.
Malatesta écrivait : « Mais une chose est comprendre et pardonner, autre chose est revendiquer. Ce ne sont pas là les actes que nous pouvons accepter, encourager, imiter. Nous devons être résolus et énergiques, mais nous devons tâcher de ne jamais outrepasser la limite marquée par la nécessité. Nous devons faire comme le chirurgien qui coupe quand il faut, mais évite d’infliger d’inutiles souffrances : en un mot, nous devons être inspirés par le sentiment de l’amour des hommes, de tous les hommes ».
Amour et haine. L’alternative est erronée. Dans l’affrontement de classe, on ne peut pas ressentir de l’amour pour l’ennemi. Un tel amour peut seulement être provoqué par les stimulations de la même classe, c’est-à-dire, par le fait de se sentir concernés par les mêmes choses et par les mêmes idéaux. Dans le cas contraire, quand l’ennemi est vu comme tel – comme ennemi de classe – et que ses intérêts et ses idéaux ne sont pas partagés, mais suscitent au contraire dégoût et indignation, il ne peut y avoir qu’un seul résultat : la haine.
Et Henry répondait : « Il est vrai que les hommes ne sont que le produit des institutions ; mais ces institutions sont des choses abstraites qui n’existent que tant qu’il y a des hommes de chair et d’os pour les représenter. Il n’y a donc qu’un moyen d’atteindre les institutions ; c’est de frapper les hommes ; et nous accueillons avec bonheur tous les actes énergiques de révolte contre la société bourgeoise, car nous ne perdons pas de vue que la Révolution ne sera que la résultante de toutes ces révoltes particulières. »
Amedeo Bertolo, Emile Henry et le sens de la mesure, dans « A-Rivista anarchica » n°2, 1979
Nous n’avons pas l’habitude d’accueillir dans les colonnes de « A » des contributions polémiques vis-à-vis d’écrits parus dans d’autres publications anarchistes. Nous le faisons cette fois, bien volontiers, en publiant cet écrit du compagnon Amedeo Bertolo (membre du collectif éditorial de « A » depuis sa fondation en 1974), parce que la question affrontée – celle du terrorisme et de la violence indiscriminée – revêt une grande importance, et parce que nous tous du collectif éditorial nous reconnaissons pleinement dans cet écrit.
Nous avons toujours cru qu’Emile Henry et son attentat au Café Terminus faisaient partie, comme l’attentat au Diana et quelques autres épisodes, du passé anarchiste le moins exemplaire. Que c’était, si ce n’est « un cadavre dans le placard », au moins ce type d’anarchisme qui s’explique (ou peut-être seulement qui s’exorcise) par un contexte socio-économico-politique particulier etc. Nous avons toujours cru que tout le mouvement anarchiste, tirant des leçons de son passé, avait acquis une conception équilibrée de l’usage possible de la violence comme moyen de lutte, que le « terrorisme anarchiste », tant parce qu’il est contraire à notre nécessaire cohérence entre les moyens et les fins, que parce qu’il s’est démontré être désastreusement contre-productif, était considéré comme un « poids mort », et que seuls les plus grossiers trompeurs professionnels de l’historiographie, de l’édition et de la presse pouvaient en agiter le fantôme.
Nous nous trompions. Dans les pages du dernier numéro de la revue « Anarchismo », dans une recension de Coup pour coup, Alfredo Maria Bonanno nous dit non seulement que l’attentat de E.Henry fut un saut qualitatif (positif) dans l’usage révolutionnaire de la violence, parce qu’il marque le passage de l’attentat discriminé (contre des personnes précises du pouvoir et du privilège) à l’attentat dans le tas de « l’ennemi de classe », mais qu’aujourd’hui même, un geste à la Henry indiquerait un « saut qualitatif » analogue et apporterait une « contribution théorique au mouvement » !
Nous avons essayé de rire – à peine, comme d’un médiocre humour noir – mais, bien qu’en nous efforçant de ne pas trop prendre au sérieux ce que nous lisions, nous sentions également nos cheveux se dresser sur nos têtes.
Nous avons essayé d’en rire parce que nous connaissons l’auteur et son insatiable besoin de s’exhiber en rodomontades toujours plus impressionnantes, pour épater le bourgeois, ou plus probablement, puisqu’il est difficile ces temps-ci d’épater le bourgeois avec des truculences verbales partout rabâchées, pour épater l’anarchiste. Cela fait des années, du reste, que Alfredo Maria s’applique à flageller le mouvement anarchiste ramolli et embourgeoisé (excepté Lui) avec la modestie d’un procureur, la grâce d’un bagarreur et l’ingénuité d’un publicitaire.
Ainsi, nous avons encore réussi à « digérer », dans le même numéro de la revue, l’article sur Proudhon où il nous invite à tirer dans la tête de certaines personnes. Ce n’est pas la première fois qu’il fait des invitations de ce genre. Il a eu un succès publicitaire certain avec son « tire, garçon, tire » (autrement dit « armons-nous et allez-y, vous ») assaisonné de joyeuses images comme celle d’un cerveau qui jaillit d’un crâne. Par ailleurs, il semble qu’il s’agisse d’une question de sémantique plus qu’autre chose : on dirait qu’aujourd’hui on dit « je te tire dans la bouche » avec la même facilité que quand on dit « à la limite », « merde » et « c’est-à-dire ». Certes, ça doit être épuisant de continuer à devoir se surpasser en virulence verbale pour continuer à « faire scandale ». On doit recourir à de difficiles exercices rhétoriques, comme certains recyclages de la fin du 18ème, déjà initiés avec le « faux Sartre »1, autre succès publicitaire discret (c’est le temps des revivals) : par exemple les images du bourgeois gras (qui dans le contexte actuel est devenu l’intellectuel socialiste) qui essuie le sang du prolétaire de sa bouche et se cure les dents des morceaux de chair ouvrière à moitié mastiquée. Mais jusque-là nous sommes peut-être encore précisément dans le domaine de la mauvaise rhétorique, pas tant en termes de goûts qu’en termes de disproportion trop visible entre la réalité et le langage.
Jusqu’ici donc nous n’aurions pas trouvé suffisamment de motivation pour prendre la plume, par exemple pour demander par la polémique si l’Apocalyptique considère que Malatesta était un ramolli quand il discutait avec Costa et Merlino plutôt que de leur planter une balle « au milieu du front », ou pour lui demander selon quelle logique un réformiste lui paraît digne de ce traitement mais pas un stalinien, comme ceux par exemple dont il publie avec gourmandise une abondance de documents et de communiqués. La ligne de démarcation entre compagnons est-elle l’usage de la violence « révolutionnaire » ? Seulement la bombe et le P38 (vrais ou de papier) ? Alors, même les fascistes « révolutionnaires » du NAP [Noyaux Armés Prolétaires] sont des compagnons ?
Je n’aurais pas trouvé assez de motivation jusqu’ici pour répondre à la « provocation ». Non, parce que, par caractère, le goût de la polémique m’est absolument étranger. Le fait est qu’après presque vingt ans de présence dans le mouvement, je commence à en avoir par-dessus la tête des polémiques, qui se sont souvent révélées – presque toujours – être des occasions de défoulement interne d’une agressivité que l’on ne parvient pas à tourner vers l’extérieur, tout comme l’ulcère est l’estomac qui s’autodétruit, le corps qui s’attaque lui-même, le réflexe d’une angoissante impuissance individuelle. Une discussion, même animée par quelques pointes belliqueuses (comme le rappelle la racine grecque du mot polémique), peut être constructive ou au moins clarificatrice, certes. Mais l’expérience militante m’a appris que, quand la discorde entre les positions est vaste et s’étend au-delà de l’objet d’une question spécifique, et plus encore quand il y a chez l’interlocuteur un goût évident et autosatisfait pour la bagarre, il y a de fortes probabilités pour que la polémique perde les caractéristiques substantielles de la discussion et devienne un jeu de massacre verbal. Mieux vaut alors ne pas choisir la voie de la polémique directe, du tac au tac, mais la voie de la confrontation indirecte, aussi bien entre ce que l’on dit et fait qu’entre ce que font et disent les autres composantes individuelles ou collectives de l’anarchisme.
Et pourtant, j’ai pris la plume, courant le risque de surévaluer l’importance négative d’une certaine prose, en faisant résonner sur « A » les absurdités hallucinantes apparues dans une autre revue. Le fait est que la recension en question, à mon avis, dépasse la limite de l’extrême terribilisme habituel de cette revue, du violentisme verbal avec lequel on cherche à faire vivre un succédané sur papier de l’insurrection, à faire passer pour une pratique sociale – tout comme la Résolution de la Direction Stratégique de l’autoproclamé noyau dur du Parti Communiste Combattant – cette violence diffuse qui est en réalité une pratique militante, version armée de l’illusoire « demain la révolution ». Concernant les qualités et les défauts de cette forme de lutte, sur lesquels nous sommes bien loin d’exprimer un jugement négatif de manière indiscriminée, la discussion est grande ouverte. À notre avis elle devrait pourtant être menée avec plus d’équilibre et de rigueur morale, à partir du moment où l’histoire aurait dû nous apprendre quel rapport délicat et difficilement prévisible il y a entre l’utilisation du moyen violent et la croissance révolutionnaire et libertaire de la conscience, de la cohérence aussi bien éthique que tactique et stratégique entre les moyens et les fins. Mais jusqu’à ce que quelqu’un rêve de « développement de l’affrontement à des niveaux inimaginables » (à lire avec un crescendo en voix de fausset, et peut-être même avec une inflexion dialectale artistiquement rusée de faux prolétaire), on peut simplement lire un excès « d’optimisme », tout comme certains d’entre nous exagèrent en « pessimisme ».
Mais quand on théorise de frapper dans le tas, on dépasse, je crois, la limite tolérable de l’artifice rhétorique construit sur mesure par un improbable catastrophisme, pour tomber dans l’irresponsabilité d’une excitation et auto-excitation émotionnelle qui sont plus matière à une psychanalyse qu’à une analyse politique.
Pour le moment, dans cette recension, on pose encore une limite à l’indiscrimination de la violence : dans le tas de la « bourgeoisie ». Mais qu’est-ce que la bourgeoisie aujourd’hui ? Si la faute de celui que l’on tue n’est pas individuelle mais « objective », de classe, comment établit-on où commence et où finit cette « bourgeoisie » ? Là où, comme dans les structures italiennes du capitalisme tardif, le pouvoir est diffus, dilué dans un dégradé continu tout comme le privilège et le parasitisme sont diffus, dilués, entremêlés, là où l’État est intériorisé, où le « cœur de l’État » est aussi dans les exploités parce qu’il n’existe plus une culture prolétaire imperméable et antagoniste à l’État, quelle est cette bourgeoisie sur laquelle frapper dans le tas ? C’est vrai qu’à un niveau d’abstraction sociologique, il est encore possible d’identifier – comme nous l’avons fait nous aussi – une classe dominante (un hybride capitaliste et techno-bureaucratique) qui occupe le sommet de la pyramide sociale, mais c’est une chose d’identifier les limites des classes au niveau analytique, c’en est une autre de les identifier dans un but opérationnel.
Dans cette situation, il est terriblement facile de donner du « bourgeois » une définition idéologique et psychologique qui se dilate à volonté. Et alors, pour quel motif s’arrêterait-on ici dans la montée terroriste, et ne pourrait-on pas continuer et déclarer que d’autres « sauts qualitatifs » sont possibles ? Par exemple, on peut défendre (on peut presque tout avec les mots) qu’assassiner des ménagères ou des ouvriers signifie : 1) frapper des individus « objectivement » coupables (les ménagères votent Démocratie Chrétienne et suivent les conseils du prêtre et de Gustavo Selva, les ouvriers se « font État » avec le PC et les syndicats…), 2) contraindre les exploités ignares à se réveiller du sommeil de la télévision et de la consommation, les mettre face à la brutalité déguisée objective du système, 3) j’en passe et des meilleures. Et avec ces motivations, pourra-t-on nier la validité de frapper dans le tas odieux de la classe moyenne ?
Arrêtons-nous ici, car notre intention n’est pas tant – pour les raisons déjà exposées ici – de discuter et donc d’argumenter point par point, de réfuter et documenter, que de témoigner notre indignation et notre préoccupation. Rédigeons seulement une dernière considération. Nous avons l’impression de retourner dix ans en arrière, en 1969, quand une bande « d’enragés » criait dans les rues « bombe-sang-anarchie » et que quelques bavards exaltés irresponsables d’humeur nihiliste débattaient sur la plus ou moins grande utilité de mettre des bombes dans les banques – temples du capital – et dans les grands magasins – temples de la consommation. Puis vint le massacre de Piazza Fontana, commis par les fascistes et les services secrets – moins bavards – et attribué aux anarchistes. Nous ne voudrions pas nous retrouver, pour cinq ans encore, à devoir employer toutes les énergies du mouvement pour expliquer que nous sommes une nouvelle fois victimes de « provocation ». Et ici nous vient irrésistiblement à l’esprit la photo de Alfredo Maria Bonanno (publiée il y a quelques années dans un opuscule édité par « La Fiaccola ») tenant un meeting du haut d’une estrade sur laquelle on peut lire en grand : « Les bombes ce sont les fascistes qui les mettent ».
Pire encore. Vu qu’au sein du mouvement anarchiste aussi se reflète le désespoir/la désintégration de l’extrême gauche (effet de la Grande Déception des attentes révolutionnaires à court terme), que se substitue à la créativité vitale de ses expressions les plus heureuses une mortifère destructivité – autodestructivité (homicide-suicide), vu qu’au-delà des théoriciens de salon de la « violence prolétarienne » il existe aussi des protagonistes en chair en os et en nerfs de l’angoisse existentielle, de la marginalisation et de la rébellion extrême contre une situation qui semble indéfiniment « bloquée », nous ne voudrions pas que quelqu’un prenne à la lettre les divagations sur le fait de frapper dans le tas et de mettre, disons, une bombe dans un bar de la Piazza del Duomo à Milan ou – pourquoi pas ? – sur la via Etna à Catane.
Il ne suffirait pas alors de se décharger de la terrible responsabilité morale, d’écrire quelque chose de similaire à ce qu’Il écrivit à l’occasion de l’attentat au commissariat de Milan, qui est la plus récente approximation d’un attentat qui vise dans le tas (mais pas tant « dans le tas » que ça et plutôt involontairement). Alors, tout en condamnant le geste, nous défendrions la figure de l’auteur contre les commodes et trop faciles calomnies de matrice gauchiste. Pas comme l’Apocalyptique, comme il apparaît aux pages 429-431 de ses écrits publiés et inédits, recueillis dans la précieuse anthologie La dimension anarchiste. Signe du changement tumultueux des temps : ces anthologies, à l’époque de la déplorable modestie bourgeoise, se publiaient posthumes, pas à la diligence de l’auteur…
Paolo Finzi, Violentisme et éthique, dans « A-Rivista anarchica », Milan, n° 3, 1979
Même si jusqu’à maintenant seule l’intervention critique de Bertoli nous est parvenue, nous savons que l’article Emile Henry et le sens de la mesure publié dans le dernier numéro a suscité plus d’une réaction. En attendant que les opinions se concrétisent en écrits, permettant ainsi l’ouverture d’un débat à plusieurs voix dans le prochain numéro à propos des sujets soulevés par cet article, nous publions dans les pages qui suivent l’opinion d’un compagnon de la rédaction, qui affrontent quelques aspects éthiques des thèmes en question.
Ils reconnaissent que les BR sont des staliniens, mais Curcio est un dur nom de Dieu. Ils s’enthousiasment pour Azione Rivoluzionaria, ceux qui s’engagent, pas du tout comme vous qui vous êtes enfermés dans vos locaux à vous branler avec la propagande. Si tu leur fais remarquer que la stratégie proclamée au procès de Parme par les militants d’AR (1° objectif : construire le front uni des organisations communistes combattantes) est pour le moins hallucinante et suicidaire, ils te traitent de réformiste, de chiffe molle, et te donnent du et-toi-où-est-ce-qu’elles-sont-tes-couilles-pour-faire-comme-eux ? Même s’ils le nient, ils font de la lutte armée un mythe, le mythe unique, et par conséquent ils souffrent d’un terrible complexe d’infériorité vis-à-vis de ceux qui la font « bien ». Et par « bien », ils entendent par-dessus tout beaucoup d’actions, beaucoup de jambisations, beaucoup d’éliminés/punis/exécutés/etc. Si tu leur parles d’éthique anarchiste, ils te rient au nez, ils te traitent de chrétien. Si tu écarquilles les yeux aussitôt qu’ils te racontent qu’à la dernière manifestation, dans les rangs des anarchistes, on a crié le slogan démentiel « dix, cent, mille Torregiani, boutiquiers pour vous il n’y a pas de lendemain », ils te reprochent ton moralisme. Et t’expliquent qu’il y a pègre et pègre, que ceux de la « petite pègre pour le communisme » sont des compagnons, que comme ça un Torregiani quelconque y pensera à deux fois avant de faire le fanfaron.
Ce que par-dessus tout ils n’arrivent pas à comprendre, c’est quand tu leur parles de la valeur de la vie humaine, de la nécessité de la respecter au maximum, de l’horreur que tu éprouves devant la violence absurde qui caractérise inutilement les hauts faits de nombreux révolutionnaires. Le minimum que tu reçois c’est une comparaison avec Jean Paul II. Nous sommes en guerre, te disent-ils, et ce n’est sûrement pas le moment le plus adapté pour se mettre à faire les philosophes. Qui en a quelque chose à faire, si un commando de Prima Linea tend un guet-apens à deux policiers, les crible de balles et laisse sur le trottoir le cadavre d’un jeune passant ? Qui en a quelque chose à faire si dans l’attentat contre l’association des journalistes revendiqué par des Chats Sauvages à Bologne une femme qui n’y était pour rien meurt par mégarde ?
Eux, les super-compagnons, ils s’en foutent. Nous non. Pour nous la référence à l’éthique, à l’éthique anarchiste, a toujours la priorité sur n’importe quelle autre considération. Cela ne nous suffit pas qu’une de nos actions cause un désavantage à « l’ennemi », ce qui nous intéresse par-dessus tout, c’est que notre cause en tire un avantage.
Si pour « vaincre » nous nous trouvions dans des situations telles qu’il nous faudrait renoncer à notre éthique, utilisant systématiquement des moyens contradictoires et incompatibles avec notre fin, nous aurions déjà perdu d’avance. Car l’anarchie ne peut naître que du concours constructif entre les hommes, pas de l’élimination physique et totale de « l’ennemi ». Car notre démarche dans l’histoire se mesure en conscience conquise par l’action directe et par l’anarchisme, pas en nombre de morts et de blessés disséminés sur le pavé.
Soyons clairs. La logique exprimée par des épisodes comme ceux de Turin et Bologne cités ci-dessus, et en général par toute la stratégie de la lutte armée aujourd’hui en Italie, est celle de l’extermination de l’ennemi, une logique qui n’est pas et ne peut pas être la nôtre, mais celle de ceux qui ont une conception autoritaire et totalitaire du conflit social. C’est la logique, renversée, de l’État. Et même si, plus modestement, la logique n’est pas celle de l’anéantissement (selon le lexique des Brigades Rouges et de Prima Linea), mais celle des représailles, celle-ci nous est tout aussi étrangère. Le geste vengeur (qui frappe celui qui est subjectivement coupable et le frappe avec une juste proportion entre « faute » et réponse vengeresse) est une chose, les représailles terroristes indiscriminées en sont une autre, qui ont, à juste titre, toute une tradition militaire qui a atteint des sommets dans l’impitoyable efficacité nazie.
Ce n’est pas une question superficielle, il ne s’agit pas non plus de « branlettes moralistes », comme les définissent d’habitude les super-compagnons P38-istes. Nous ne pouvons pas utiliser des moyens étrangers ou carrément antinomiques avec nos fins, sauf en niant nos fins, c’est-à-dire en nous niant nous-mêmes en tant qu’anarchistes. D’autres (qu’ils soient réformistes, révolutionnaires ou réactionnaires) peuvent justifier les moyens par les fins. Pas nous. Au contraire, ce sont plutôt nos moyens qui justifient nos fins et, dans tous les cas, les moyens doivent refléter autant que possible ces valeurs morales qui elles-mêmes reflètent nos propres fins.
Et ça ne nous va pas de dire que tuer un policier est cohérent avec nos fins parce que cela élimine un instrument du pouvoir. C’est confondre les hommes avec les rôles, ce qui est éthiquement inique, logiquement idiot et stratégiquement fou. Comme de penser supprimer l’exploitation de l’agriculture en exécutant les vendeurs de fruits et légumes, ou éliminer la religion en exécutant les curés de campagne. Cela revient à contredire gravement la valeur fondamentale de la vie humaine, pour en contrepartie pas même un modeste plat de lentilles propagandistes ou tactiques, mais pour un résultat carrément nul, sinon négatif.
Concernant la valeur stratégique, c’est-à-dire l’efficacité de la lutte armée, nous ne nous attardons pas. Nous ne pensons pas – nous l’avons répété de multiples fois – que la lutte armée ait aujourd’hui en Italie quelque chance de succès, nous ne croyons pas qu’elle en ait en général, et encore moins dans notre perspective libertaire. Toutefois, nous ne comptons pas discuter de cela avec des compagnons qui pensent (ou ressentent) différemment. Nous estimons que leur choix est dramatiquement erroné, pour eux avant tout, et pour le mouvement : cependant, nous nous rendons compte que ce serait ridiculement inutile d’en discuter ici et maintenant. Nous voudrions simplement que ce choix ne représente pas – comme trop d’éléments le laissent présager – un suicide individuel et collectif et, plus encore, un suicide éthique de leur et de notre anarchisme. Nous voulons dire que si à Turin étaient tombés dans un guet-apens le généralissime Dalla Chiesa ou d’autres personnages de premier plan de l’appareil répressif étatique, cela aurait été une chose clairement différente (et perçue inévitablement comme telle par les gens), même si, à notre avis, tout aussi inutile sinon contre-productif.
Ce dont nous cherchons à parler, c’est de ce qui est juste ou ne l’est pas, pas ce qui est utile ou inutile. Ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas de moralisme de philistin, mais seulement d’une manière différente de juger de la validité des moyens choisis d’un point de vue anarchiste.
Après tout, quelqu’un pourrait considérer ces considérations superficielles. Il nous semble, au contraire, qu’il y a dans notre mouvement trop de sous-estimations pour cette cohérence éthique, qui est aussi une cohérence logique. Cette cohérence qui semble être une faiblesse de l’anarchisme parce qu’elle s’oppose à de nombreux (faux) « raccourcis » mais est, en réalité, sa force. Ce qui l’empêche, par exemple, d’être une idéologie pour couvrir de nouvelles dominations et de nouvelles abominations. Ce qui l’empêche de parcourir les plus honteuses « voies du socialisme » (?!) parcourues par d’autres sous le parapluie d’idéologies plus « souples ». C’est justement cette cohérence qui est le noyau essentiel sans lequel l’anarchisme ne serait qu’une version, peut-être plus extrémiste mais indubitablement plus inefficace, du gauchisme.
Ceux qui, parmi nous, privilégient l’efficacité des moyens sur leur effet (c’est-à-dire leur capacité à se rapprocher des fins) et admirent, par-dessus tout, la technique de la guérilla, la capacité de « feu », la bravoure et des « valeurs » similaires, sont parmi nous par erreur. Ils croient être anarchistes, mais ne connaissent pas et ne partagent pas la dimension essentielle de la cohérence entre les moyens et les fins de l’anarchisme. Mais… les anarchistes, les bombes, les fusils, les poignards, l’histoire, la tradition, etc. Bien sûr. Mais que l’on regarde avec une attention particulière le « terrorisme » anarchiste et, à part quelques cas marginaux, on verra que ce n’était pas du terrorisme, et qu’une forte tension éthique ainsi qu’une perpétuelle recherche de cohérence présidaient l’utilisation anarchiste de la violence. Et dans les cas de conscience à notre avis exemplaires il y avait une claire répugnance (totalement antinomique au goût répandu aujourd’hui) pour la violence, et la volonté d’en utiliser le moins possible. C’étaient ceux qu’Albert Camus, dans son essai exceptionnel L’homme révolté, appelle les « meurtriers délicats ». Ceux qui ne tuaient même pas les tyrans le cœur léger (« joyeusement »), car ceux qui tuent à cœur léger sont les gangsters, les policiers, les mercenaires, les Torquemada (du christianisme, de l’islam, du marxisme-léninisme…).
Gianfranco Bertoli, Le prix à payer, sur « A-rivista anarchica », n.4, 1979.
Chers compagnons (…) il s’en est écoulé du temps, depuis mon second procès à Milan. Luciano Lanza qui voulait être présent avec vous (et je ne sais pas ce que cela a signifié pour moi) m’a transmis, par le biais de l’avocat, deux des trois volumes (le premier et le troisième) des écrits de Malatesta (ils font partie des quelques livres que j’ai réussi à sauver au cours de mes « péripéties » carcérales et que je conserve encore), eh bien, dans les dernières pages du troisième volume, intitulées « dernières pensées », il y a une phrase, une considération tellement humaine, tellement « modeste » et privée de rhétorique, à m’en frapper profondément et me pousser à corriger et revoir un peu tout mon univers mental, c’est celle-là : « Celui qui lance une bombe et tue un passant dit que, victime de la société, il s’est révolté contre la société. Mais le pauvre mort pourrait dire : Mais quoi, c’est moi la société ? ».
Cette considération du « vieux » Malatesta (celui de 1933, année où je suis né), simple, voire élémentaire, tout à la fois calme et douloureuse, m’a profondément frappé et n’a pas peu contribué à fêler la « tour d’ivoire » de mes certitudes « absolues », du culte sans limites de ce « dieu » sans le « d » initial [en italien dieu se dit dio, ce qui sans le d donne io, qui signifie je] dont parlait Bruno Filippi, de mes flatteries avec une espèce de « sur-hommisme » à la saveur nietzschéenne, par ailleurs pathétique et impuissant.
Bien sûr ce n’est pas seulement à cause de ces mots, il y a eu d’autres choses, comme le dialogue que j’ai établi avec vous, à travers la difficile médiation du langage épistolaire, quand j’étais à Porto Azzurro, et puis tant d’autres choses qu’il serait long d’énumérer, mais je me suis retrouvé, essayez de me comprendre, à devoir, sans renier mon passé, tout réfléchir à nouveau et reconsidérer, des situations pas privées de doute, des questions sans réponses, des contradictions déchirantes et une « crise » dont je n’ai pas encore réussi à sortir complètement. De plus, la réalité existentielle dans laquelle je me trouve contraint est bien loin de pouvoir être considérée comme optimale pour la poursuite d’une certaine sérénité de jugement et d’un relatif équilibre. Du coup, puisque je ne pourrais pas éviter de considérer comment chaque acte humain et la pensée même sont, au moins en partie, influencés et conditionnés par l’état d’âme et par les conditions ambiantes mêmes, je compte sur votre bienveillante prédisposition et une sévérité non nécessaire pour juger et évaluer les opinions que je vais vous exposer et la forme avec laquelle je le ferais : ce n’est pas sans un certain « malaise », ni sans avoir dû, avant, dépasser des hésitations considérables, et quelques perplexités que je me hasarde à m’immiscer dans une polémique, déjà devenue âpre, entre des compagnons bien plus cultivés, bien plus préparés et capables que je ne pourrais jamais parvenir à l’être, même dans les meilleures conditions possibles.
Cela d’autant plus que, comme en cette occasion, si je veux être sincère (et la sincérité est la seule qualité que je peux espérer donner à mes paroles), je ne pourrais me limiter à un alignement sur une des deux positions opposées, mais je serais contraint d’exprimer des critiques aussi bien à la thèse fondamentale de la recension de A. M. Bonanno du livre Coup pour coup, qu’à certains arguments auxquels a recours Amedeo Bertolo dans sa réponse sur les pages de « A ».
Si je me suis résolu, malgré tout, à me risquer sur un terrain bien trop difficile pour moi, c’est pour deux raisons principales : en premier lieu parce que j’ai été, bien que marginalement, « mis en cause » et cela me donne un petit droit à « donner mon avis » sur ce que je peux valoir. En second lieu parce que, même si dans le milieu anarchiste on parle beaucoup « d’auto-d%C
