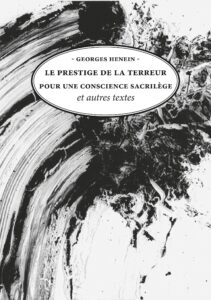 « Dans ce glissement collectif vers une condition de sécurité dans la terreur, qui déclenchera le cran d’arrêt ? Qui fera justice de ce que les hommes vont s’habituer à prendre pour leur droit à la terreur et presque pour l’aboutissement normal de leurs anciennes aspirations à la liberté ?
« Dans ce glissement collectif vers une condition de sécurité dans la terreur, qui déclenchera le cran d’arrêt ? Qui fera justice de ce que les hommes vont s’habituer à prendre pour leur droit à la terreur et presque pour l’aboutissement normal de leurs anciennes aspirations à la liberté ?
Pas un parti certes, ni aucune des organisations totalitaires préposées à la garde de l’homme. Pas un parti, mais peut-être des partisans d’un genre nouveau qui abandonneraient les modes classiques de l’agitation pour des gestes de perturbation hautement exemplaires.
[…]
Le réalisme politique se fonde sur deux formules qui ne se complètent qu’en apparence. « Tous les moyens sont bons », nous disent les réalistes. Et ils ajoutent l’instant d’après : « Il faut savoir s’adapter aux circonstances. » L’antinomie qui rend ces deux maximes inassociables, ne saurait retenir longtemps l’attention des réalistes. Pour ceux-ci en effet, il n’est pas d’antinomies définitives, pas plus qu’il n’est d’antagonismes irréductibles. Seul leur importe de développer à partir de certains aphorismes primaires, une philosophie du camouflage destinée à leur procurer la liberté de manœuvre la plus confortable. À la rigueur on concevrait qu’ils disent : « Tous les moyens sont bons pour adapter les circonstances. » Mais adapter les circonstances, au lieu simplement de s’y adapter, implique une volonté de changer le réel, de faire pression sur l’obstacle et non de se laisser modeler par lui.»
Pour télécharger la brochure: Le prestige de la terreur – Vers une conscience sacrilège et autres textes – Georges Henein A5 page-par-page
Ci-dessous, le texte de la brochure:
Le prestige de la terreur
(1945)
Finir les fers au pied, c’eût été le but d’une vie. Mais c’est une volière à barreaux. Indifférent, autoritaire, sans gêne, le bruit du monde fluait et refluait à travers le grillage ; le captif, au fond, était libre : il pouvait prendre part à tout, rien ne lui échappait au dehors ; il eût pu même déserter la cage ; les barreaux se distendaient sur la largeur d’un mètre ; il n’était même pas pris.
Franz Kafka
Le 8 août 1945
Ceci n’est pas une thèse. Car une thèse non seulement s’écrit de sang-froid et avec toutes les précautions littéraires d’usage, mais encore nécessite une accumulation de références et de données plus ou moins statistiques à quoi je m’en voudrais de sacrifier le mouvement de révolte et de fureur qui me dicte ce texte. De plus, l’ancien public des thèses, désertant toute réflexion prolongée, se complaît aujourd’hui dans la lecture des multiples « Digest » en circulation et dans le récit des intrigues sentimentales, diplomatiques et policières qu’une presse rompue à toutes les ignominies lui sert, chaque matin, avec le déjeuner.
Ceci n’est pas une thèse et ne se satisfait pas de n’être qu’une protestation. Ceci est ambitieux. Ceci demande à provoquer les hommes couchés dans le mensonge ; à donner un sens et une cible et une portée durable au dégoût d’une heure, à la nausée d’un instant. Les valeurs qui présidaient à notre conception de la vie et qui nous ménageaient, çà et là, des îlots d’espoir et des intervalles de dignité, sont très méthodiquement saccagées par des événements où, pour comble, l’on nous invite à voir notre victoire, à saluer l’éternelle destruction d’un dragon toujours renaissant. Mais à mesure que se répète la scène, n’êtes-vous pas saisi du changement qui s’opère dans les traits du héros ? Il vous est pourtant facile d’observer qu’à chaque nouveau tournoi, saint Georges s’apparente sans cesse de plus près au dragon. Bientôt saint Georges ne sera plus qu’une variante hideuse du dragon. Bientôt encore, un dragon camouflé, expert à nous faire croire, d’un coup de lance, que l’Empire du Mal est terrassé !
Le 8 août 1945 restera, pour quelques-uns, une date intolérable. Un des grands rendez-vous de l’infamie fixés par l’Histoire. Les journaux rapportent avec délices les effets de la bombe atomique, futur instrument de polémique, de peuple à peuple. Les émissions radiophoniques de la soirée annoncent l’entrée en guerre de l’Union soviétique contre les cendres et les ruines du Japon. Deux événements, d’ampleur inégale sans doute, mais qui participent de la même horreur.
L’opinion mondiale s’était, il y a dix ans, dressée frémissante pour protester contre l’usage de l’ypérite par les aviateurs fascistes lâchés sur l’Éthiopie. Le bombardement du village de Guernica, rasé au sol par les escadrilles allemandes en Espagne, a suffi à mobiliser – dans un monde encore fier de sa liberté – des millions de consciences justes. Quand Londres, à son tour, fut mutilée par les bombes fascistes, on sut de quel côté de l’incendie se situaient les valeurs à défendre. Puis l’on nous apprit que Hambourg brûlait du même feu que Londres, l’on nous instruisit des bienfaits d’une nouvelle technique de bombardement appelée « bombardement par saturation » à la faveur de laquelle d’immenses zones urbaines étaient promises à un nivellement inéluctable. Ces pratiques perfectionnées, ces suprêmes raffinements dans le meurtre n’avaient rien qui pût rehausser la cause de la liberté, le parti de l’homme. Nous étions plus que quelques-uns, ici, en Grande-Bretagne, en Amérique, à les tenir pour aussi détestables que les diverses formes de supplice mises au point par les nazis. Un jour, c’était une ville entière qui était « nettoyée » par un raid de terreur. Le lendemain, une gare où s’entassaient des milliers de réfugiés, est, grâce à un super-viseur scientifique, criblée à mort. Ces jeux inhumains apparaissent soudain dérisoires, maintenant que la bombe atomique a pris service et que des bombardiers démocratiques en essaient les vertus à même le peuple japonais ! Qu’importe en effet l’assassinat prémédité de quelques dizaines, de quelques centaines de milliers de civils japonais. Chacun sait que les Japonais sont des jaunes et, par surcroît d’impudence, de méchants jaunes – les Chinois représentant les jaunes « gentils ». Un personnage qui n’est pas un « criminel de guerre » mais l’amiral William Halsey, n’a-t-il pas déclaré : « Nous sommes en train de brûler et de noyer ces singes bestiaux de Japonais à travers tout le Pacifique, et nous éprouvons exactement autant de plaisir à les brûler qu’à les noyer. » Ces mots exaltants et rassurants quant à l’idée que les chefs militaires veulent bien se faire de la dignité humaine, ces mots ont été prononcés devant un opérateur d’actualités…
Saint Georges exagère. Il commence à nous paraître plus répugnant que le dragon.
Au point auquel nous ont portés les derniers développements de la politique et de la guerre, il est indispensable d’affirmer que le bien-fondé d’une cause doit se juger, essentiellement et d’abord, sur les moyens qu’elle met en oeuvre. Il est indispensable d’établir, au profit des causes qui risquent encore d’en appeler au meilleur de l’homme, un inventaire des moyens non susceptibles d’obscurcir le but poursuivi. Le recours à la délation face à une nécessité passagère se traduit, en peu de temps, par une administration de la délation. Il se forme aussitôt chez une partie des citoyens, un pli de la délation – chez l’autre partie, une hantise de la délation. Voulez-vous aiguiller le débat vers les fins ultimes desquelles chacun se réclame, on se lèvera, en inspectera le pilier et l’aspect de l’escalier, on fermera ensuite la porte à double tour et l’on ne s’exprimera qu’en termes mesurés et selon un mode d’esprit devenu subitement académique. Le moyen est passé à l’état d’institution. Il coupe en deux la vie d’une nation, la vie de chaque homme. Et il en va de même des autres moyens volés à l’ennemi pour mieux le dominer et le détruire, mais dont on découvre – à victoire remportée – qu’ils ont été élevés au rang de difformités nationales, de tares intellectuelles soigneusement protégées contre les révoltes possibles de la raison. C’est ainsi que le culte de l’infaillibilité du chef, le renforcement délirant des fausses hiérarchies, la mainmise sur toutes les sources d’information et tous les instruments de diffusion, l’organisation frénétique du mensonge d’État à toutes les heures de la journée, la terreur policière croissante à l’égard des citoyens attachés à leur relative lucidité – sont devenus des formes communément admises du progrès politique et social ! Et c’est précisément contre un si puissant concours d’aberrations qu’il faut nous répéter, sans répit, l’évidence suivante :
Que le prolétariat ne saurait songer à s’élever en recourant aux moyens par lesquels ses ennemis s’abaissent. Qu’une sorte de socialisme qui devrait son avènement à des prodiges d’intrigue, de délation, de chantage politique et d’escroquerie idéologique, serait vicié à l’origine par les instruments mêmes de sa victoire, et l’homme et les peuples pécheraient par excès de candeur s’ils en attendaient autre chose qu’un changement de ténèbres.
Le 8 août 1945, alors que fume encore la plaie béante d’Hiroshima, ville-martyre choisie pour l’essai de la première bombe atomique, la Russie de Staline assène au Japon le fameux coup-de-poignard-dans-le-dos breveté par Mussolini. Cependant, celui-ci aurait tort de se retourner dans sa tombe, en rêvant de droits d’auteur. Car on ne s’est pas contenté de plagier ses beaux gestes ; on a voulu ajouter à son apport historique. Le texte de la déclaration de guerre soviétique nous informe en effet que cette entrée en guerre de l’URSS n’a d’autre but que « d’abréger la guerre » et « d’épargner des vies humaines » ! Trêve de petits moyens – voilà donc une fin en elle-même, une fin dont nul ne contestera qu’il soit difficile d’égaler la noblesse. Et pendant des siècles à venir, les trouvères staliniens de la Mongolie extérieure auront loisir d’épiloguer sur le caractère pacifiste et humanitaire de la décision du Maître.
Le 8 août 1945 est une des dates les plus basses dans la carrière de l’humanité.
Des guerres justes et du danger de les gagner
Plusieurs années avant que le monde ne soit précipité dans la guerre contre le fascisme, d’âpres discussions firent rage dans les mouvements de gauche entre adeptes du pacifisme intégral et militants de la lutte à mort contre la tyrannie. Un des thèmes qui revenaient le plus souvent dans ce long échange d’idées et d’arguments, était celui des « guerres justes ». Avec une habileté qui n’était pas toujours à toute épreuve, les pacifistes intégraux s’employaient à démontrer qu’il n’existait pas de guerres justes. Que prétendre combattre la tyrannie par la guerre c’était se livrer soi-même à la tyrannie d’un appareil militaire sans frein, de lois d’exception sans pitié, de politiciens investis des pouvoirs les plus arbitraires et plus ou moins dispensés d’en rendre compte. La guerre en elle-même et à elle seule, constitue une tyrannie qui ne le cède en rien à celle que vous vous proposez d’abattre, nous disaient sans nous convaincre les théoriciens du pacifisme intégral.
Ils se trompaient. Il existe des guerres justes. Mais le propre des guerres justes est de ne pas le demeurer longtemps.
N’oublions pas que les guerres « justes », si elles produisent des Hoche et des Marceau, produisent par ailleurs des Bonaparte, ce qui est, pour elles, une façon particulièrement démoniaque de cesser d’être justes. Mais d’autre part – et en l’absence de tout Bonaparte à l’horizon – une guerre « juste » se distingue des ordinaires expéditions de brigandage, en ce qu’elle impose, à ceux qui en prennent charge, un rythme et des exigences qui leur sont difficilement tolérables. Pour tenir en éveil une entreprise fondée sur la ferveur populaire, il faut que les équipes responsables de la conduite de la guerre aient la claire audace de laisser aux forces mouvantes sur lesquelles elles s’appuient leur caractère de masses en combustion – de masses en plein devenir et conscientes du sens de leur élan. Mais la règle persistante chez les meneurs de peuples – souvent même chez ceux qui semblent venir tout droit de la ligne de feu ou du meeting d’usine – est d’user de leur poids hiérarchique pour ramener les forces motivantes qui leur sont confiées, dans les cadres traditionnels d’un pays en guerre. Et quand je dis « cadres traditionnels », j’entends rationnement de la vérité, rationnement de l’enthousiasme, rationnement de l’idéal. J’entends raidissement arbitraire des forces mouvantes d’une nation, sur l’ordre de ceux qui redoutent dans le « mouvement » d’aujourd’hui, le « bouleversement » de demain. Ces cadres traditionnels – simples masques à poser sur le visage de telle ou telle guerre pour en effacer l’expression originale et la rendre semblable à toutes les autres – on peut les emprunter tantôt des archives du musée de la Guerre, tantôt des pratiques de l’ennemi. Cela s’appelle : dans un cas, « s’inspirer des leçons du passé », dans l’autre, « profiter de ce que votre adversaire vous apprend ».
Ce ternissement des valeurs vives du présent que l’on est toujours prêt à envelopper dans de vieilles formules sacramentelles comme dans un linceul, ce transfert dans le camp de la justice des procédés et des routines mentales de l’ennemi, le déroulement de la guerre contre le fascisme ne nous en offre que trop d’exemples. Il me souvient nettement que le premier communiqué de guerre soviétique s’achevait par la mention d’un soldat allemand, cité nommément, qui s’était dirigé vers un poste russe en déclarant ne pas vouloir prendre les armes contre un État prolétarien. Cette seule phrase du communiqué rendait, devant l’histoire, un son plus éclatant que les exploits motorisés qui la précédaient ou qui l’ont suivie. Elle attestait, par-dessus le fracas du combat, que la fraternité des travailleurs gardait et devait garder le pas sur la division des hommes en groupes ethniques et nationaux. Là était le bien à préserver entre tous – la vertu susceptible de faire craquer les cadres vermoulus de la guerre entre nations. Et pourtant c’est, encore une fois, vers ces cadres traditionnels, que les travailleurs furent reconduits, furent égarés. Au lieu d’exalter les héros populaires russes et allemands qui s’étaient jadis tendu la main en de mêmes luttes libératrices, les services de propagande soviétiques se complurent très vite dans un pathos effroyable d’où n’émergèrent que des figures parmi les plus sinistres de l’histoire de Russie. Le prince Alexandre Nevsky connut à nouveau toutes les enflures de la gloire parce qu’en l’an 1242 il eut la bonne fortune de mettre en déroute les Chevaliers de l’Ordre Teutonique. Par contre, le souvenir d’un Pougachev et d’un Stenka Razin – champions légendaires de la cause paysanne – fut mis en veilleuse car il était jugé que ces personnages avaient par trop malmené les autorités de leur temps. Le 7 novembre 1941, s’adressant aux combattants de l’Armée Rouge, Staline offrit à leur vaillance d’étranges antécédents : « Puissiez-vous, leur dit-il, être inspirés par les courageuses figures de vos ancêtres : Alexandre Nevsky, Dimitri Donskoy, Kuzma Minin, Dimitri Pozharsky, Alexander Suvorov, Mikhail Kutuzov ».
L’héroïsme ancestral n’a, dans aucune armée, eu beaucoup de prise sur le moral des soldats. Mais quant aux ancêtres taillés en icônes par Staline et présentés au pieux baiser des masses, il n’en est pas un seul qui n’ait eu, par rapport aux luttes du peuple russe pour s’arracher à son grabat de misère, une fonction réactionnaire et haïssable.
Que l’on ait tenu à détourner vers de tels noms l’imagination héroïque des défenseurs de l’URSS, il y avait déjà là de quoi frapper de sénilité une guerre dont certains attendaient qu’elle améliorât le monde. La suite fut à la hauteur de ce début. L’exhumation d’Alexandre Nevsky entraîna la révision de huit siècles d’histoire européenne. Empruntant non plus du passé mais de l’ennemi, Staline opposa à la théorie hitlérienne de la mobilisation de l’Europe contre l’assaut asiate, un retour pur et simple au panslavisme le plus borné. Les débats des différents congrès panslaves organisés au cours de cette guerre, sur l’initiative de Moscou, ont fait reculer l’intelligence au même titre que les émissions de Radio-Berlin. Le long développement de l’Europe n’apparut plus que comme prétexte à divisions raciales – sujet à un conflit ans cesse renaissant entre Slaves et Germains. Le dernier congrès panslave (Sofia, février 1945) a consacré l’existence d’un bloc slave héritier d’une union scellée à travers des siècles de batailles et remontant à la victoire de Grunewald (1410) remportée par les armées slaves unies contre les Germains. Ainsi, l’on a fini par se battre bloc contre bloc, race contre race, insanité contre insanité ! Ainsi les guerres « justes » ne résistent-elles pas longtemps à l’infamante contagion des idées qu’il leur était demandé d’anéantir. « Entraînés par nécessité, à contrecœur, à accomplir au jour le jour, une série d’actes en tous points semblables à ceux de l’ennemi, comment éviterons-nous de tendre avec lui à une limite commune ?» s’inquiète André Breton. « Prenons-y garde : du fait même que nous sommes contraints d’adopter ses moyens, nous risquons d’être contaminés par ce dont nous croirons que nous triomphons. » [In Lumière Noire par André Breton, cf. L’Arche n° 7.]
Je dis que nous assistons actuellement à une pénétration du comportement politique hitlérien dans les rangs de la démocratie. Cette pénétration ne scandalise presque personne ; trop de gens y trouvent leur convenance matérielle et leur confort moral. Cette pénétration s’étale dans tous les journaux, dans toutes les nouvelles qui nous parviennent sur le sort que l’on se prépare à faire au monde. Par exemple, l’annexion de territoires sans l’agrément préalable des populations était communément considérée comme un outrage au droit, relevant de la frénésie impérialiste d’un Hitler. Or aujourd’hui, voilà que la chose se présente tout différemment et sous le seul rapport de l’utilité nationale ; tel port m’est tout à fait utile et j’aimerais qu’il me fût octroyé, déclare une puissance – et si on lui objecte que ce port a toujours fait partie d’une autre unité nationale, elle répondra que c’est possible, mais qu’elle en a fort besoin et que sa victoire lui donne droit à ce petit larcin. Ainsi en va-t-il désormais non pas d’un port ou d’une ville isolée, mais de vastes ensembles de territoires devenus parfaitement mobiles et aptes à changer de propriétaire en l’espace d’une nuit. Le transfert de populations passait également pour une opération cruelle à laquelle seuls les régimes de force se permettaient de recourir. Ces transferts sont cependant envisagés aujourd’hui sur une échelle non inférieure à celle des rafles sombres du nazisme. Ici, je laisse la parole à Louis Clair, un des principaux collaborateurs de la revue américaine Politics, dont la capacité d’indignation nous aide à respirer encore :
« Les peuples sont déplacés comme du bétail ; si vous me donnez 500 000 Allemands-Sudètes, je m’arrangerais pour vous remettre une certaine quantité de Tyroliens ; peut-être pourrions-nous échanger quelques Allemands contre des machines-outils. Hitler, ici aussi, a mis en marche un mécanisme qui est en train de prendre d’inquiétantes proportions… La précipitation avec laquelle les puissances victorieuses se disputent la seule marchandise qui, en dépit des perfectionnements de la technique, reste plus demandée que jamais – le labeur d’esclave – est quelque chose de véritablement obscène ».
Une guerre a été gagnée. Mais est-on tellement sûr que Hitler ait perdu la sienne ?
« Faute de mieux… »
Lorsque l’on s’interroge sur les raisons qui tendent à convertir une guerre « juste » en une guerre ordinaire, en une guerre tout court, et plus généralement lorsque l’on s’interroge sur les raisons qui enlèvent aux masses le contrôle des causes élevées auxquelles elles se dédient, l’on se trouve vite enfermé dans un circuit hallucinant. D’une part en effet, l’ampleur et la concentration de la vie économique moderne ont fait de chaque parti, de chaque syndicat, de chaque administration, des organismes quasi totalitaires qui poursuivent leur route en s’abandonnant à leur propre poids spécifique et nullement en se référant aux cellules individuelles qui les composent. Ces partis, ces syndicats, ces administrations étatiques modernes sont protégés contre les démarches de la raison critique (aussi bien d’ailleurs que contre les sursauts affectifs et les révoltes du cœur) par leur seule et souveraine pesanteur. Ces édifices déconcertants fonctionnent par la grâce d’une humanité toute spéciale, d’une humanité d’initiés. Pour être admis à présenter une motion au terme du Congrès d’un parti de gauche tolérant quelque échange d’opinion, il faut une année de manœuvres extrêmement délicates à travers un dédale de secrétariats et de comités qui rappellent à s’y méprendre les mystères de l’inaccessible tribunal où Kafka laisse trembler dans Le Procès – l’image indéfiniment réfléchie de notre angoisse. Et si ces épreuves initiatrices sont favorablement surmontées, si nul faux pas n’est venu contrarier l’avance de la motion, alors sans doute son objet se sera suffisamment estompé pour ne plus susciter qu’un intérêt rétrospectif et presque de la pitié pour qui se hasarderait à lui accorder son soutien. D’autre part, les citoyens clairvoyants et énergiques, mieux encore, les individus disposant d’un certain prestige intellectuel, qui seraient tentés d’intervenir afin de rectifier l’orientation d’un parti, d’un syndicat ou d’un gouvernement, savent trop bien que ces différents organismes ont les moyens de tisser autour d’eux une toile mortelle – une toile de silence qui ne tarderait pas à les retrancher de toute vie publique. Cette toile de silence s’est refermée à jamais sur quelques-uns des plus brillants esprits de la société soviétique – écrivains, savants, journalistes, militants ; elle serre de plus en plus près, en Europe et en Amérique, d’autres esprits, résistants et purs, exagérément épris de liberté… Il est quelque chose de pire pour l’être civilisé que sa perte de pouvoir sur les organismes qui le représentent et agissent en son nom. C’est la résignation à cette perte. Résignation dont nous informent des signes innombrables et flagrants. Résignation que nous reconnaissons – en guerre comme en paix – à l’attitude standard de personnes douées, cultivées et portées à l’action – et cependant confites dans leur propre défaite. Cette résignation tient en trois mots : « Faute de mieux… » Si on adhère au Parti communiste (ou à tout autre…) sans être le moins du monde rassuré sur sa politique présente et future, c’est « faute de mieux »… Si l’on finit par s’accommoder d’une redistribution de territoires dont on s’avoue qu’elle ne rendra aux peuples ni le sourire, ni l’abondance, c’est « faute de mieux ». Si l’on vote pour un candidat dont l’aspect moral vous répugne et dont la fermeté politique s’annonce douteuse, c’est « faute de mieux ». Si l’on s’abonne à un journal qui sacrifie volontiers son souci de la vérité à des considérations publicitaires ou commerciales, c’est « faute de mieux »… Cette femme que l’on embrasse fébrilement en bafouillant des serments éternels : « faute de mieux ». Ce cinéma où l’on s’enfonce, tête baissée, pour s’épargner une heure de présence sur terre : « faute de mieux ». Ce livre auquel l’on s’attarde parce qu’il a été couronné, alors que tout vous invite à en vomir le contenu : « faute de mieux ». Ce chef sublime au culte duquel l’on se rallie en soupirant, imprégné que l’on est du répertoire de sa grandeur : « faute de mieux »… « Faute de mieux » devient un placement, une philosophie, un état civil, un maître, une boutade, un alibi, une prière, une arme, une putain, un sanglot, une salle d’attente, une pirouette, l’art de se faire l’aumône, une boussole pour piétiner sur place, une épitaphe, un 8 août 1945… Deux hommes, voisins par la pensée, sont cependant capables de s’entre-détruire parce qu’ayant la même conception du « mieux » et ce « mieux » leur faisant défaut, ils se rabattent sur deux modes concurrents d’existence compensatoire, sur deux systèmes de convictions et de gestes tangents du « mieux » commun, mais non tangents du même côté. Alors, d’approximations en approximations, de substitutions en substitutions, l’on se trouve refoulé, insensiblement, poliment, vers on ne sait quel coin abject où mûrissent des cloportes… On s’effare, mais à tort. Cela n’est pas un cachot ; c’est une demeure… Il fait plus que nuit… Au loin, des trains sifflent avec un air de partir… On voudrait hurler, ameuter des gardiens imaginaires… Demain matin, où en sera-t-on de soi-même ? Vous laissera-t-on seulement passer ? Oui, sans doute, l’on vous permettra de fuir, d’aller vous bâtir au Congo une seconde vie… Une vie sur pilotis avec, dans l’ombre, le même cancer triomphant où pactisent les forces de l’ennui et l’horreur panique de la liberté.
Le droit à la terreur
Tout se passe, depuis deux siècles, comme si chaque invocation de la liberté, chaque soulèvement marqué de son nom, devaient se traduire – à travers les appareils politiques et étatiques surgis au plus fort de ces soubresauts – par un surcroît de règles oppressives auxquelles l’homme est redevable d’un graduel rétrécissement de la vie. Une nouvelle génération d’encyclopédistes qui procéderait de la même impertinence que l’autre, serait, aujourd’hui, mise hors la loi ou, tout au moins, rapidement réduite à la mendicité.
Tout se passe comme si l’homme ne recherchait, dans cette longue série d’ambitions malheureuses, qu’une certaine forme de sécurité dans la terreur. L’âpre et sévère ouvrage d’Erich Fromm La Peur de la liberté nous enseigne à quel point l’homme redoute le tête-à-tête avec la liberté, à quel point il lui tarde de se dérober aux responsabilités qu’elle lui assigne, à quel point – dans les conditions actuelles de chaos – la grisaille, l’opacité et l’anonymat lui sont des refuges désirables contre le vertige de la liberté.
À cette disposition individuelle de l’être affolé par la complexité du monde qui le sollicite, les grands organismes collectifs sont venus apporter une contribution décisive. Ils ont fixé, avec la rigueur voulue, ce pauvre minimum d’attitudes humaines qui ne se laisse transgresser qu’aux risques et dépens du contrevenant. Le bon citoyen peut se payer un sommeil de plomb, maintenant que la bombe atomique le protège…
Les signes de la terreur montante ne trompent pas. Le premier en gravité est l’effacement progressif du droit d’asile. Mauvaise idée que de s’installer réfugié politique, par ces temps qui tuent… ! Depuis 1930 déjà, Léon Trotski avait été pourchassé comme un sanglier à travers tout le continent européen, de Turquie en Norvège via Paris. Puis vint Vichy qui, d’une main sans remords, livra Pietro Nenni à l’Italie, Breitscheid à l’Allemagne et Companys à l’Espagne. Vichy a disparu mais non cette indéracinable aversion des autorités – démocratiques ou pas – envers le réfugié politique, dernier et beau vestige de la sédition humaine.
Signe de terreur aussi, la déportation organisée des travailleurs, dont il n’est pas question qu’elle prenne fin avec la défaite du nazisme. Les économistes sont là pour veiller au rendement croissant du bétail qui leur est imparti en matériel expérimental. Les conférences internationales ont besoin de graphiques ascendants ! Signe de terreur, l’engloutissement de milliers d’êtres dans une nuit d’où rien ne transparaît. Partis sans laisser d’adresse. Car il y a du bois à couper sur les rivages de la mer Blanche. Avis aux amateurs !
Dernière tristesse, dans le domaine qui a toujours su se soustraire aux pressions des régimes arbitraires du passé, dans le domaine de la pensée attaquante, de la pensée politique, hier encore porteuse d’espoir, on assiste à une étrange adaptation à l’ordre cruel et vain qui se précise sous nos yeux. En témoigne la timidité embarrassée d’une revue comme La Pensée qui, avant la guerre, manifestait une curiosité agitante envers toutes les formes du devenir scientifique et social, et ranimait d’un souffle inquisiteur des problèmes essentiels déjà gagnés par le vieillissement général d’une société qui ne tolère point que l’on ne vieillisse pas avec elle. Les grands noms qui patronnent La Pensée ne couvrent plus, en 1945, qu’un concert de formules statiques et de raisonnements débilitants. On se trouve en présence d’une revue qui semble avoir pour tâche de nous avertir que la pensée marxiste a atteint le point mort. Il en va d’elle aujourd’hui comme d’une force qui, au lieu de dominer le cauchemar contemporain et d’y tracer ses avenues conductrices de lumière, le laisse déposer dans une éprouvette de sûreté où nulle séparation explosive du viable et du non-viable, de l’entraînant et de l’accablant, de l’actuel et du périmé, n’est à craindre pour l’heure présente. Par ailleurs, ne voyons-nous pas Aragon insister, dans un article retentissant, pour que l’on retire des librairies de France les ouvrages de M. Charles Maurras ? L’auteur d’une pareille demande ne se rend apparemment pas compte qu’il fait là acte de défaitisme à l’égard de ce qui devrait être le pouvoir d’attraction de son propre message politique. Il nous faut croire que Maurras et lui-même occupent des positions symétriques l’une de l’autre, et qu’ayant renoncé à se départager par les voies de la raison, ils s’en remettent, l’un après l’autre, à l’arbitrage peu recommandable des policiers. Ainsi, quand elle ne travaille pas à visage découvert, la terreur reste toujours latente, à fleur de débat, prête à accueillir le premier voeu, le premier appel d’un de ses loyaux sujets.
Quant aux individus hors série – particulièrement certaines catégories d’intellectuels et d’écrivains qui n’acceptent pas encore de vivre selon la trajectoire commune – ils sont, eux aussi, happés par le vent de terreur. Leur seul espoir est de renverser le vent ; c’est-à-dire d’exercer, eux, la terreur. Ils sont fascinés non par un Gide ou un Breton ; mais par Lawrence d’Arabie et le Malraux de la période chinoise. Pour la plupart, ils ont aimé cette guerre car elle leur a permis de se mettre en règle avec eux-mêmes en faisant sauter un train, en démolissant un viaduc avant de retourner à leur appartement, à leurs maîtresses émoussées et à leur fidèle routine quotidienne de récits saisissants. Incarner, ne serait-ce que l’espace d’un chapitre, un rôle d’aventurier en marge de tout, récupérer par cet artifice de vocation une partie des élans dont la vie sociale l’a amputé, l’intellectuel moderne ne demande pas, au fond, d’autre pourboire à un monde qu’il n’a plus l’honnêteté de récuser.
Le cran d’arrêt
Dans ce glissement collectif vers une condition de sécurité dans la terreur, qui déclenchera le cran d’arrêt ? Qui fera justice de ce que les hommes vont s’habituer à prendre pour leur droit à la terreur et presque pour l’aboutissement normal de leurs anciennes aspirations à la liberté ?
Pas un parti certes, ni aucune des organisations totalitaires préposées à la garde de l’homme. Pas un parti, mais peut-être des partisans d’un genre nouveau qui abandonneraient les modes classiques de l’agitation pour des gestes de perturbation hautement exemplaires. Beaucoup avaient espéré que le mouvement de la résistance en Europe occupée ménagerait enfin une ouverture dans l’impasse politique et sociale de notre temps. Les grands partis de masses ont été les premiers à flairer ce danger. Eh quoi, on s’apprêtait donc à se dispenser de leurs services ? La volonté populaire se targuait maintenant de se passer d’intermédiaire ? L’alerte fut de courte durée. De même que les forces militaires de la résistance furent rapidement intégrées aux cadres permanents de l’armée – de même ses forces politiques ne tardèrent pas, la flatterie se mêlant à l’intrigue, à regagner la souricière des grands partis. L’épisode – j’ai failli dire l’incident – est clos. Mais quelque chose d’autre devient possible, devient même la seule chose possible. L’ère de la guérilla politique commence et c’est à elle que doivent aller nos réserves de confiance et d’enthousiasme.
Sans doute n’est-il pas facile d’annoncer l’allure que prendra cette guérilla et les exploits qui ne manqueront pas de la distinguer. On pourrait cependant considérer l’attitude vaillamment indépendante d’un Camus – et, sur d’autres plans, d’un Breton, d’un Calas, d’un Rougemont – comme une indication pour l’avenir. L’appareil de la terreur est encore loin d’être sans hésitation et sans fissures. C’est donc au point où cet appareil se fait le plus menaçant – et au fur et à mesure de ses menaces renouvelées – que doivent se porter tout notre esprit de refus, tout ce qu’il y a dans le monde, à un moment donné, d’êtres en état de refus. Et que cela se fasse avec éclat ! Et que cela s’inscrive en exemples troublants dans la conscience des multitudes ! Et que cela se transmette et s’amplifie à travers la vaste prairie humaine, par contagieux sillons de grandeur !
À ce point, j’entends fuser les sarcasmes meurtriers : « Eh, quoi ! vous cherchez à discréditer les partis politiques, à en ruiner le prestige, à en compromettre l’action ; – vous poursuivez donc l’œuvre insidieuse de ces fascistes d’avant et d’après le fascisme, qui jettent le doute sur tous les instruments de délivrance et de progrès ! » En réalité, je ne poursuis rien, je désire ne rien poursuivre qu’une certaine logique de la liberté. Le phénomène fasciste, vu en fonction de l’évolution des partis, n’a servi qu’à précipiter de façon décisive le développement de l’éléphantiasis moral et matériel qui afflige les puissantes institutions de « gauche » où la voix des masses se perd presque aussi aisément que celle des individus. Le but dernier de la guérilla qui s’engage maintenant n’est pas d’éliminer les partis au profit de quelque nouveau système d’exercice de la vie politique. Il est d’arracher aux partis le monopole de la pensée sociale qui se rouille dans leurs comités d’étude ; il est de leur enlever, dans le domaine idéologique, un droit d’initiative auquel ils s’accrochent d’autant plus qu’ils sont bien décidés à n’en faire que l’usage le plus masquant le plus retors. Il s’agit, pour serrer le problème d’aussi près qu’il se peut, de réduire les partis à une condition purement réceptive quant à la maturation et au mouvement général des idées, et purement administrative quant à l’exécution de ces idées. En un mot, il s’agit d’amener les partis à reconnaître les foyers idéologiques qui prendraient naissance en dehors d’eux et à drainer vers l’action pratique tout ce qui se dégagera de valable de l’effervescence ainsi entretenue. Que l’on y prenne garde : la situation objective des partis a considérablement changé depuis vingt ans. Ils tendent tous à devenir des organismes para-étatiques, des appendices de l’État. La notion même – et la fonction – de parti d’opposition est mortellement affectée par ce changement. En Angleterre, aux États-Unis, en France, en Belgique, l’opposition est plus souvent solidaire des pouvoirs, qu’elle n’en est l’ennemie. A cette règle nouvelle des partis doivent correspondre des obligations toujours plus nettes pour les francs-tireurs de la pensée. La première de ces obligations est le transfert des activités idéologiques à des foyers étrangers aux vicissitudes des partis et à leur enlisement progressif dans les cadres de l’État. Mais surtout, cette guérilla n’aura d’effet durable que dans la mesure où elle saura favoriser, dans sa lutte contre le pragmatisme bureaucratique des partis, une plongée dans les frais courants de l’utopie, une renaissance de la spéculation utopique avec tout ce qu’elle comporte d’édifiant et de joyeux.
Il y a une dizaine d’années de cela, nous pouvions prendre comme thème de ralliement des paroles telles que celles de Nicolas Boukharine, l’avant-dernier des grands théoriciens du socialisme :
« Une analyse de l’état réel des choses nous fait entrevoir non pas la mort de la société, mais la mort de sa forme historique concrète et un passage inévitable à la société socialiste, passage déjà commencé, passage vers une structure sociale supérieure. Et il ne s’agit pas seulement de passer à un style supérieur de la vie, mais précisément supérieur à celui qui est aujourd’hui le sien.
Peut-on parler de cette forme sociale supérieure en général ? Ceci ne nous entraîne-t-il pas vers le subjectivisme ? Peut-on parler de critiques objectives quelconques dans ce domaine ? Nous le pensons. Dans le domaine matériel, un tel critérium est représenté par la puissance du rendement du travail social et par l’évolution de ce rendement, car ceci détermine la somme de travail superflu dont dépend toute la culture spirituelle. Dans le domaine des relations inter-humaines immédiates, un tel critérium est donné par l’amplitude du champ de sélection des talents créateurs. C’est justement lorsque le rendement du travail est très élevé et le champ de sélection très large, qu’on verra s’effectuer le maximum d’enrichissement intérieur de la vie chez le nombre maximum d’hommes, pris non pas comme une somme arithmétique, mais comme un ensemble vivant, comme collectivité sociale ».
Aujourd’hui, nous ne pouvons faire à moins de nous demander où en est cet « enrichissement intérieur de la vie chez le nombre maximum d’hommes ». Il n’est pas douteux hélas, que le chemin parcouru depuis avril 1936, c’est-à-dire depuis que nous furent jetés ces mots d’espoir, n’a fait que nous éloigner des perspectives boukhariniennes, n’a fait que sceller, d’étape en étape, l’avènement d’un conformisme intraitable qui réduit la « vie intérieure » à son expression la plus humble et la plus craintive.
Il n’est pas douteux qu’à ce critère de « l’enrichissement intérieur » se soit substitué le critère inverse, et n’en voudrions-nous qu’une preuve entre des milliers, la plus éloquente n’est autre que la « liquidation » de Boukharine lui-même et le peu de cas qui a été fait de cette « liquidation » dans le camp du socialisme et dans le camp de l’intelligence.
À ce conformisme qui sévit dans tous les domaines, sauf dans celui des raffinements terroristes où ces messieurs prennent toujours plaisir à innover, il n’est possible d’opposer avec succès que les forces précisément les plus décriées par lui : la rêverie d’Icare, l’esprit d’anticipation délirant de Léonard, les coups de sonde aventureux des socialistes utopiques, la vision généreuse et tamisée d’humour d’un Paul Lafargue ! Le socialisme scientifique s’est dégradé jusqu’à n’être plus pour ses disciples qu’un pompeux exercice de récitation. Une large aération de l’ambiance et de l’idée sociales s’impose, si l’on veut ménager à l’homme un avenir qui ne soit pas desséché d’avance et qui ne rompe pas à d’injustifiables disciplines, sa faculté de toujours entreprendre.
Contre l’odieux accouplement du conformisme et de la terreur, contre la dictature des « moyens » oublieux des fins dont ils se recommandent, la Joconde de l’utopie peut, non pas l’emporter, mais faire planer à nouveau son sourire et rendre aux hommes l’étincelle prométhéenne à quoi se reconnaîtra leur liberté recouvrée.
IL N’EST QUE TEMPS DE REDORER LE BLASON DES CHIMERES…
Le Caire, le 17 août 1945
Pour une conscience sacrilège
(1944)
Êtes-vous réaliste ? Êtes-vous prêt à le devenir ? Dans l’affirmative, on se chargera de vous. L’avenir daignera vous sourire. Quoi que vous fassiez et dans quelque esprit que vous le fassiez, il vous restera toujours une face de rechange, une porte encore praticable, des mots subtils ou héroïques pour surnager en cas de naufrage, de sérieuses possibilités — si vos tricheries sont à la hauteur de vos ambitions ! — d’émarger un jour à l’une des trois caisses du destin : gloire, avoir et pouvoir. Ou aux trois réunies si vous êtes assez habile pour paraître n’attacher d’importance à aucun de ces trois redoutables instruments de domination. Ainsi font en effet certains grands ascètes de notre temps qui pourtant, lorsqu’ils sont sûrs d’avoir convaincu tout le monde de leur haute intégrité morale, ne résistent pas à l’envie de se faire broder une petite chamarrure par-ci, une grosse fioriture par-là. Remarquez que même pris en flagrant délit de chamarrure, un réaliste de l’ascétisme donnera de son acte mille justifications plausibles, plausibles dans la mesure où elles se situent précisément sur un plan des plus particuliers ; celui de l’utilité immédiate, de l’intérêt tactique. La force, la force immense des réalistes tient à ce qu’ils ignorent le flagrant délit. Quelle prise aura-t-on jamais sur des gens qui sont tellement enfoncés dans ce qu’ils appellent le réel, qu’aucune évidence ne peut suffire à les confondre… ?
Si par contre, vous n’entendez pas vous rendre à la triple tentation que la gloire, l’avoir et le pouvoir exercent au profit du réalisme politique, il faut vous apprêter à passer pour un infatigable remueur d’abstractions. Vous êtes, de l’avis général, sans contact avec la vie, sans connaissance des joies et des souffrances des hommes, voué au domaine stérile de l’idéologie. Dans un monde habitué désormais à trafiquer avec le même entrain, des valeurs de l’esprit et des produits manufacturés, une nuance de mépris croissant s’attache au terme même d’idéologie. Immédiatement, vous voici sur la défensive. Vous devez commencer par prouver que vous ne manquez ni de cœur ni d’entrailles, à des gens qui ont pour métier d’organiser les émotions d’autrui. Et la preuve étant faite, vous leur demeurez aussi suspect qu’avant, puisque vous ne réagissez pas aux cuivres de leurs fanfares. Dès lors que se perfectionne la civilisation du chantage et de la contrefaçon, toute idéologie digne de ce nom se présente comme un insupportable défi à la facilité d’esprit des uns, à la capacité de voltige des autres. Il est édifiant à cet égard, de voir les rescapés d’une orthodoxie qui, à ses débuts, faisait grand étalage d’une rigueur plus policière qu’intellectuelle, fraterniser aujourd’hui avec les amateurs d’expédients et les professionnels de l’improvisation politique, dans une haine commune de toute activité critique de l’esprit, pour ne pas même parler de fidélité à quelque chose d’aussi vain que des principes.
De 1’orthodoxie la plus implacable aux manipulations politiques les moins scrupuleuses, le chemin s’est avéré bien rapide à franchir. Mais si l’orthodoxie a pu conduire, dans la lutte quotidienne, à des pratiques aussi aberrantes, n’est-ce point qu’en substituant à la culture des idées leur culte pur et simple, c’est-à-dire en substituant un rite plus ou moins intangible aux démarches normales de la raison, certaines consciences partisanes ont appris à se dégager à bon compte, d’abord de tout conflit d’interprétation, ensuite de toute question préjudicielle quant au choix de l’action à mener, de l’attitude à prendre ? Un défenseur de ce genre d’orthodoxie, si prompte à descendre dans le ruisseau, résumait pour moi, dans des termes saisissants que je m’empresse de transcrire ici, la règle d’or de son comportement : « C’est précisément, me disait-il, parce que nous avons des principes fortement établis, que nous pouvons tout nous permettre ! » Qu’on y prenne garde. Ceci n’est pas une boutade à liquider d’un haussement d’épaules. C’est l’expression sincère et limpide d’un état d’esprit très général qui consiste a transformer des valeurs vivantes et mouvantes en valeurs emblématiques, à leur consacrer des dévotions rituelles, et à les tenir pour non maculables par les compromissions « réalistes » du moment, au-dessus desquelles elles planent très haut.
Singulière entreprise que celle qui s’acharne à sauver l’idéal en lui donnant des ailes de boue ! Quiconque est porté à adhérer à cette conception de la vie politique, se doit à lui-même de s’aménager deux consciences distinctes et non communicantes, l’une ayant charge d’entretenir en leur prétendue pureté les principes permanents et la vision du but final, l’autre étendant son contrôle bienveillant aux menues fornications au jour le jour. Que par surcroît, cette dissociation constante, ce divorce perpétuel entre les activités immédiates et le monde des principes souverains, puisse passer pour 1’expression dernière de l’esprit de synthèse, voilà qui permet de mesurer les possibilités de mystification dont 1’intelligence est à la fois complice et victime.
Mépris d’abord savamment suggéré, puis spontané et quasi unanime envers toute idéologie soucieuse de rechercher autre chose que des occasions de se nier ou de s’aliéner, soumission de toute pensée à la première réalité venue, réduction arbitraire à un même contenu de notions aussi peu superposables les unes aux autres que dogmatisme et idéologie, orthodoxie et démagogie, tels sont les signes de l’affreuse confusion qui va sans cesse s’aggravant et se compliquant, prenant les hommes à la tête pour mieux les convaincre de se livrer d’eux-mêmes, de leur plein gré, avec le sourire, en vrais citoyens qu’ils sont, à l’une quelconque des tyrannies à la mode.
C’est à force de tirer sur les mots, d’abuser de l’élasticité du langage que l’on a pu en venir à l’état de relâchement actuel où une chose, un homme, une idée, parviennent à être dans le même temps ou successivement, eux-mêmes et leurs contraires. On a souvent répété le mot de ce lieutenant d’Hitler qui, lorsqu’il entendait parler de culture ou d’intelligence, brandissait son revolver. Hélas, pourquoi faut-il que les autres mots intéressant le vocabulaire politique et social des hommes, ne bénéficient point de significations aussi tranchées ? Car il n’est pas jusqu’au mot « paix » qui, ayant depuis longtemps cessé d’être rassurant, ne traîne après lui on ne sait quelles terreurs secrètes, on ne sait quel relent de catastrophe. En attendant que soit constitué, selon le conseil de Denis de Rougemont, un « ministère du sens des mots », il importe de redonner une substance claire et précise aux termes les plus corrompus, les plus avilis par un usage aveugle.
Une idéologie n’est pas un catéchisme. C’est un noyau d’idées directrices, excitatrices, qui orientent l’esprit mais qui surtout, 1’incitent à penser, à prendre — en développant fructueusement ces éléments de départ — conscience de sa liberté.
Une idéologie saisit la pensée d’un certain message, mais loin d’en brider le mouvement naturel, elle n’en compromet pas un seul instant la précieuse autonomie. Tout message complémentaire est le bienvenu. Toute contribution originale de la pensée saisie, assure le rebondissement nécessaire et continuel du message idéologique. Une idée doit être pensée par tous, non par un. C’est ici que la lutte contre les idées reçues — contre l’enregistrement docile de formules préétablies par des millions de sujets apprivoisés — doit s’élever à son point culminant. C’est ici qu’à l’escamotage du libre arbitre individuel par les mille ruses de la suggestion ou les mille menaces de la violence d’État, doit s’opposer la participation consciente de chacun au développement des valeurs idéologiques. Si nous déplorons l’espèce d’abandon et de délabrement dans quoi sont tombées les idéologies du siècle, c’est bien parce que nous y voyons un grave recul de la liberté sous sa forme la plus haute, la plus créatrice. Une société qui ne mettrait en présence que des fournisseurs d’idées — en nombre limité et en service contrôlé — et des consommateurs d’idées en état de passivité quasi hypnotique — une société ou les échanges intellectuels se ramèneraient à des préparations de laboratoire d’une part, et de l’autre, à des manifestations rituelles d’adhésion et d’enthousiasme plébiscitaire, une société comme celle-là ne serait, sous des dehors peut-être plus cléments, ni plus ni moins monstrueuse que l’organisation hitlérienne de la servitude.
Contrairement aux doctrines, lesquelles ont pour objet de cristalliser — donc de stabiliser — l’opinion autour de leur enseignement, lui- même durci et ossifié, toute idéologie se double d’un appel implicite à son propre dépassement. Il n’est pas à cet égard, de meilleur entraînement pour l’esprit que celui qui consiste à battre en brèche les convictions-limites, à reculer sans répit son propre champ visuel. Pendant des centaines et des centaines d’années, l’esprit a éprouvé le sinistre besoin de se retrancher derrière des séries sans fin de lignes fortifiées dont chacune a constitué, en son temps, la ligne de la plus grande ignorance. L’humanité a vécu jusqu’ici presque uniquement sous l’empire de croyances irrationnelles c’est-à-dire à genoux. Et chaque fois qu’une conquête de la raison survenait pour accorder à l’homme une part croissante de liberté, les forces de régression, un instant désemparées, ne tardaient pas à regagner le terrain perdu, à canaliser les élans libérateurs, à dresser de nouveaux autels ou à moderniser les anciennes idoles, en un mot à enfermer les acquisitions du génie humain dans un système de discipline rituelle où elles ne font que sanctionner de leur prestige l’incessant retour à l’oppression. Ainsi se poursuit entre l’homme et la liberté un véritable supplice de Tantale, la liberté se dérobant à l’heure même où tout concourt à son triomphe et cédant la place à quelque édifice tyrannique au fronton duquel son nom brillera néanmoins comme une fausse étiquette sur un article de contrebande.
La lutte anti-idéologique ne tend qu’à désarmer l’intelligence, à la dépouiller de sa fonction inquisitrice, à l’habituer au respect des vérités hiérarchiquement établies et valables jusqu’à nouvel ordre. Sous prétexte d’en finir avec les spéculations abstraites, nous allons vers des dogmes élémentaires, vers d’effroyables catéchismes sociaux où les mots les plus exaltants se déclineront à coups de matraque.
L’idéal des réalistes serait d’ériger l’intelligence en une sorte de Journal officiel. Est-ce qu’on discute le Journal officiel ? On y prend connaissance des décrets du jour. Cependant que dans la rue et sur les places publiques, des attractions choisies maintiendraient l’excitation favorable des foules. Qui contestera que les défilés sur la place Rouge ont été pour beaucoup dans la solidité du régime stalinien ? Ainsi le cœur et 1’esprit sont servis par les réalistes à pâtures égales… Le jour où les hommes déserteront les défilés et les mausolées, les réalistes leur reprocheront sans doute d’avoir perdu leur cœur, alors qu’ils n’auront fait qu’en réserver les battements pour un meilleur usage.
Le réalisme politique se fonde sur deux formules qui ne se complètent qu’en apparence. « Tous les moyens sont bons », nous disent les réalistes. Et ils ajoutent l’instant d’après : « Il faut savoir s’adapter aux circonstances. » L’antinomie qui rend ces deux maximes inassociables, ne saurait retenir longtemps l’attention des réalistes. Pour ceux-ci en effet, il n’est pas d’antinomies définitives, pas plus qu’il n’est d’antagonismes irréductibles. Seul leur importe de développer à partir de certains aphorismes primaires, une philosophie du camouflage destinée à leur procurer la liberté de manœuvre la plus confortable. À la rigueur on concevrait qu’ils disent : « Tous les moyens sont bons pour adapter les circonstances. » Mais adapter les circonstances, au lieu simplement de s’y adapter, implique une volonté de changer le réel, de faire pression sur l’obstacle et non de se laisser modeler par lui.
Les réalistes ont peur de 1’inconnu. Leur rôle n’est pas de changer le réel, mais de le ménager. Car ou seraient-ils plus à leur aise que dans une réalité cordiale et familière qui les récompense en succès de toutes sortes, de la stabilité quelle leur doit ? À la fin il peut n’être plus facile de distinguer qui, du réel ou du réaliste, a apprivoisé l’autre. Mais si quelque changement radical s’impose, tout redevient parfaitement clair. C’est alors que « tous les moyens sont bons » pour surseoir à ce changement, pour en démontrer l’inutilité, et, en dernière analyse, pour en écraser les partisans. S’en remettre à un réaliste du soin de changer les choses c’est charger un valet de cirque de débrouiller la jungle.
Non, tous les moyens ne sont pas bons ! Il est certains moyens, précisément les plus recherchés des réalistes, qui ne sont bons qu’à fausser l’engrenage normal des événements et à introduire dans les plans d’action que l’on s’était tracés, une déviation telle, qu’elle suffit généralement à tenir en échec les forces de redressement accourues en vain au carrefour. Tout comme ces plaies qui défient la cicatrisation, les angles ouverts par les « déviations réalistes » deviennent, à partir d’un écart donné, bien difficiles à refermer. D’autant plus que le réalisme consiste à s’installer dans la déviation et à la considérer non comme un état intermédiaire, mais comme un état final, une situation en soi. Une situation que les non-réalistes devront se résoudre à trancher, à la manière un peu brutale dont les Jacobins de 93 tranchaient les têtes.
Lorsque des politiciens qui n’ont vécu que d’expédients, parlent de laisser libre essor aux volontés populaires, soyons sûrs que ce recours au peuple ne constitue qu’un expédient de plus dans leur jeu. En règle permanente d’ailleurs, ces politiciens n’en appellent au peuple que lorsqu’ils sont menacés d’être délogés par une bande rivale, plus adroite et plus riche en expédients. La question a été souvent posée, de savoir si les masses avaient intérêt à répondre à des appels occasionnels et utilitaires de ce genre. Car il se trouve dans les rangs des travailleurs à peu près autant de professeurs de réalisme que dans le camp adverse. Il fait beau voir ces Machiavel en casquette mettre délicatement au point les alliances les plus scabreuses, les réconciliations les plus navrantes, les greffes politiques les moins recommandables. De 1933 à 1939 ces rapprochements contre nature du peuple et des salons, de l’usine et de la sacristie, ont largement contribué à démoraliser les éléments demeurés sains et agressifs dans une Europe non encore occupée mais déjà mûre pour l’occupation. Dans cette course à l’adultère politique on commence par tromper son idéal avec le voisin d’en face, puis on finit par partager n’importe quel lit avec n’importe quel partenaire.
Le peuple a en lui-même ses propres ressources, ses propres hommes, ses propres instruments de lutte, sa propre conception du pouvoir. Il n’a pas à sous-louer des professionnels déjà usés au service d’autrui, pour l’accomplissement de sa propre besogne. Il n’a pas non plus à prêter ses énergies et son drapeau à des entreprises de repêchage de politiciens et de partis également tarés, les premiers par la pratique illimitée de l’intrigue, les seconds par la pratique illimitée du compromis.
Lorsque les masses s’entendent inviter à l’action par des personnages ou des groupements qui ne doivent leur survivance qu’à l’inaction des masses, il y a pour ces dernières toutes raisons de s’inquiéter. Car il ne peut s’agir, bien entendu, que d’une certaine action canalisée dans un certain sens. Jusqu’à présent les politiciens ont maintes fois réussi à canaliser les masses ; les masses jamais à canaliser les politiciens. Ceux qui incitent les masses à se mettre à la remorque de tel ou tel grand homme — « le seul chef possible » — ou de tel ou tel parti pressé de dégénérer en parti unique, libres, l’un et l’autre, de disposer à leur gré des désirs populaires, ceux qui prétendent qu’à force de dévotion il sera malgré tout permis au peuple d’influer sur les décisions du chef ou du parti, ceux-là sont en vérité d’étranges conseillers, de la bouche desquels on peut tout juste apprendre l’art de falsifier l’histoire.
Il n’est pas question cependant, par crainte de voir les élans populaires captés et mis à profit par les agents de la réaction, de retomber dans l’impasse de l’abstentionnisme. Les masses gardent un rôle énorme, un rôle suprême à jouer. Mais un rôle autonome. Chaque fois qu’il est nécessaire de les flatter du haut d’une tribune, on leur parle de leur poids dans la balance des forces politiques. Ce poids est réel. L’essentiel est de savoir qui le déplace.
L’action autonome des masses — avec ce qu’il lui faut de romantisme pour rétablir l’unité morale de la fin et de moyens, rompue par les politiques réalistes — cette action autonome doit pouvoir raser au sol l’échafaudage monstrueux d’expédients et d’artifices sous lequel nous risquons, à la longue, d’être stupidement ensevelis.
On dit que le pouvoir use. Cela est vrai jusqu’à un certain point. Mais la peur du pouvoir use davantage. Cette peur du pouvoir, d’un pouvoir qu’ils ne devraient précisément qu’à l’action autonome des masses, a ravagé pendant des années les plus éminents représentants de la gauche européenne et les a rejetés peu à peu dans le camp des réalistes et des tricheurs. Que d’occasions irremplaçables n’ont-elles pas été perdues simplement parce que ces malheureux pris de panique, agitaient au regard des foules leur diagnostic favori : « La situation n’est pas mûre !… ». Ce qui signifiait neuf fois sur dix, qu’il fallait la laisser mûrir pour l’ennemi !
On ne se guérit pas aisément de la peur. On se guérit de ceux qui la propagent. Les vaillants dialecticiens dont « les situations ne sont pas mûres » doivent être mis hors d’état de trembler. C’est-à-dire que leurs mandats doivent, avec tous les ménagements possibles et avant que de nouvelles situations ne mûrissent, les décharger de leurs responsabilités.
Entre les chefs des partis populaires et ceux des partis réactionnaires, il n’existe qu’une légère démarcation qui vient de ce que leurs craintes respectives n’ont pas tout à fait le même objet. À droite, on redoute les principes pour eux-mêmes. À gauche, on redoute leur mise en action.
Peur du pouvoir, peur des situations trop mûres et des moyens trop droits, peur de se déclarer, peur de se refuser — les désastres de ces vingt dernières années sont faits de l’accumulation de toutes ces petitesses. Et maintenant il faut sortir de la nuit, et c’est là le plus difficile. De même que les yeux s’habituent à l’obscurité, l’esprit s’habitue à 1’ignorance, la raison s’habitue au progrès du fétichisme, l’homme libre s’habitue aux contraintes que ses maîtres lui forgent sous le nom gracieux de « discipline consentie ».
Il faut sortir de la nuit et ce n’est ni l’éloquence des tribuns, ni l’héroïsme des martyrs, qui peuvent nous y aider. C’est en réagissant contre la prétention des grands Partis à une autorité dogmatique absolue, c’est en ramenant à la mesure de l’homme ces organismes hypertrophiés livrés sans contrôle à une poignée de secrétaires « réalistes », c’est en faisant de l’exercice individuel des facultés critiques non pas un chef d’accusation dans d’absurdes procès de sabotage ou de trahison, mais la condition nécessaire d’une pleine lucidité sociale jamais atteinte encore, c’est dans ce sens et à ce prix que pourra s’ébaucher une première délivrance.
Ni l’éloquence des tribuns, ni l’héroïsme des martyrs. La libre et sacrilège conscience des hommes sans plus besoin d’intercesseurs auprès du destin.
Le Caire, fin juillet 1944
ANNEXE I
La confusion des langues est, en politique, un fait bien établi. Depuis de nombreuses années, la politique a soumis le langage à un régime forcené et délirant. Ce n’est pas d’aujourd’hui que date cette Tour de Babel. La politique s’est laissé gagner par un virus connu dans l’histoire de la philosophie, sous l’étiquette de nominalisme. Le nominalisme fut découvert par les stoïciens qui démontrèrent que la plupart des idées et des généralisations alimentant le débat philosophique de leur temps, n’étaient que des mots. La période de nominalisme politique de notre après-guerre a réussi à plonger l’humanité dans un tourbillon de faux problèmes énoncés en termes ambigus et creux. Tous les partis qui se disputèrent le pouvoir, sont — chacun pour sa part — responsables de cet état de choses, mais d’abord et surtout, les partis fascistes issus de la guerre. Les hommes se sont trouvés ainsi détournés de leurs besoins réels et entraînés dans un labyrinthe de miroirs déformants. Par exemple, si un parti se constitue pour combattre le socialisme et protéger les intérêts des classes possédantes, il se déguisera bien entendu en Parti « social », « démocratique », ou même « socialiste ». Si un parti politique se qualifie de « radical », il s’agit indiscutablement d’un Parti des plus modérés. Si un nouveau parti prend naissance à la suite d’une scission survenue dans un parti existant, il s’intitulera « parti d’unité ». Si un parti reçoit des consignes et des subsides de l’étranger, vous pouvez être certain qu’il se fera en toutes occasions, le champion de l’indépendance nationale.
Ce nominalisme politique projette souvent un humour macabre sur la scène contemporaine. Lorsque des troupes sont envoyées dans un pays ami à seule fin d’y entretenir la guerre civile, cette petite opération est baptisée, vous ne l’ignorez pas, « non-intervention ». Lorsque des adversaires politiques souvent destinés à être « abattus tandis qu’ils tentaient de s’enfuir », sont jetés en prison, c’est toujours pour mieux assurer leur protection. Les tribunaux politiques qui n’ont d’autre objet que de terroriser l’opinion, sont appelés « tribunaux populaires ». Les armements sont partout justifiés sous prétexte qu’ils doivent servir à maintenir la paix. Si vous abjurez vos engagements, il est à peine besoin d’expliquer que c’est pour « sauver votre honneur ».
Ignazio Silone
(The School for Dictators, Jonathan Cape, London, 1939, P- 164-165)
ANNEXE II
N’êtes-vous pas émerveillé par toutes ces statues qu’on élève à tout bout de champ, ces commémorations, ces anniversaires qu’on célèbre à chaque instant, ces noms de rues qu’on change sans qu’on sache trop pourquoi, le nombre d’idoles de tous genres qu’on offre à l’admiration publique ?
Il y a dans ce besoin de vénération qu’on satisfait sans cesse, une médiocrité, une bassesse…
Paul Léautaud, Nouvelle Revue française, 1er décembre 1928
ANNEXE III
Ceux qui n’ont pas encore compris que la liberté ne peut être donnée à personne, mais seulement conquise par chacun ; quelle est « incompatible avec la faiblesse », comme le disait Vauvenargues, c’est-à-dire incompatible avec l’égoïsme, l’insignifiance et l’esprit de combine, l’arrivisme, l’opportunisme et la fuite devant les responsabilités, la bêtise vaniteuse et la paresse de pensée, le respect de l’argent, le ton hâbleur, le bluff et le sentimentalisme qui font toute la démagogie, le culte du succès facile et hasardeux, la peur des coups, la peur des paroles claires — bref, tout ce qui caractérise les mœurs politiciennes de nos pseudo-démocraties, et les goûts de leur « grand public » tels que les entretiennent et les exploitent le cinéma, les mauvais livres à gros tirage et la publicité ; ceux qui n’ont pas encore compris que la liberté est incompatible avec tout cela ; ceux qui ne savent pas prouver qu’ils l’ont compris — ceux-là ne méritent rien de mieux qu’Hitler.
Denis de Rougemont, La Part du diable (Éd. Valiquette, Montréal, 1942, p. 174)
A propos de patrie
(1935)
On me dit : « Si vous ne respectez pas la patrie, vous êtes un anormal ou un dégénéré. »
Je réponds : « Avant de respecter quelque chose, je tiens à connaître son contenu. Expliquez-moi, je vous prie, ce que c’est que la patrie. »
Ici, embarras, confusion, pathos. Pour les uns, la patrie c’est le lieu, et plus généralement, le pays où l’on est né. Je veux bien, mais alors je constate que le fait de naître en un lieu plutôt qu’en un autre est purement accidentel, et ne saurait suffire à déterminer chez l’homme une préférence inévitablement arbitraire. Si le lieu en question a une valeur d’attrait, il l’a pour tout le monde et non pas pour un seul, il l’a indépendamment de l’événement qui crée un lien artificiel entre l’homme et lui. Du moment que la patrie est seulement un local, je revendique le droit de mépriser ce local, quand même serais-je obligé d’y vivre.
Pour d’autres, la patrie c’est le patrimoine que nous lègue une certaine tradition, pour qu’à notre tour nous le conservions et le transmettions. Or, la tradition est une des majeures entraves de l’esprit humain. Toute critique de la tradition est impossible. On l’accepte ou on la refuse. Nous la refusons. Et nous refusons dans le même temps, ce paquet qu’on nous livre en son nom, idées-croyances-manies nationales, affublement grotesque uniquement capable de corrompre les originalités. L’essentiel est d’être soi-même, vivant, et non de vivre selon les morts. On sait l’image fameuse et toujours exploitée : « Défendons le sol de nos pères. » Le sol de nos pères on s’en fout, c’est notre sol à nous qui vaut. Et ce sol, c’est l’univers entier.
Le groupe de l’« Ordre nouveau » offre une définition de la patrie, qui demande un examen plus attentif. La patrie y devient « le milieu physique et psychologique où l’homme prend conscience en même temps de sa personnalité et du monde extérieur ; elle est donc limitée et régionale, définie par les contrats affectifs qu’un homme ou un groupe d’hommes peut éprouver directement ». Les auteurs de cette honorable définition ne semblent pas mettre en doute, un seul instant, le fait que le milieu où l’homme prend conscience du monde extérieur puisse ne pas coïncider avec celui où il prend conscience de sa personnalité. La connaissance de soi vient, non pas de la contemplation d’une réalité voisine, mais bien de certaines intersections rares, précieuses et rapides. Nul ne sait, au juste, dans quel lointain il trouvera une image accrue de lui-même, transparente jusqu’à l’évidence. Nos miroirs sont comptés. Ils se dressent devant nous, par surprise, puis disparaissent dans des nuits infranchissables. Et nous demeurons leur souvenir. Ma patrie peut être une figure de Chine, où coexistent miraculeusement la mort et la vie. Elle peut être le paysage d’un rêve, retrouvé au hasard de la grande continuité terrestre. Elle peut être en des paroles assez fortes pour avoir résisté aux siècles et triomphé des distances.
Pour peu que l’on associe la patrie à une prise de conscience essentielle, on en fait l’égale d’un destin. Et l’erreur est de vouloir limiter ce destin, l’asservir à un temps et à un espace ennemis de tous les passages. L’erreur est de vouloir réduire cela qui dépend du plus périlleux des choix, à la mesure d’une notion officielle, commune et indiscutée. Il n’y a pas une patrie. Il y a la patrie de chacun, acte de pureté dû à un excès de volonté individuelle. La patrie c’est tout l’irréductible qu’on a accueilli et gardé en soi, c’est tout ce que l’on est seul à défendre. Avec quelle passion et quelle fierté. À ce sens, nous conduit notre expérience idéologique, aucun autre sens n’étant pensable sans que s’élève une série de contradictions entre l’être et le milieu.
Si bien qu’en définitive, la patrie ne saurait avoir d’existence qu’abstraite. Pour des raisons politiques, et donc suspectes, on a procédé à une tentative organisée de concrétisation de l’idée de patrie. Favorisée par certaines ignorances, cette tentative a brillamment réussi et installé un confortable et très respecté mensonge. La patrie telle qu’elle est pratiquée dans nos sociétés, n’est rien qu’une variété de camp de concentration. Ne pas s’y tromper. La patrie correspond dans l’esprit humain à un besoin antérieur à la forme qu’actuellement les politiciens lui prêtent, à un besoin qui survivra à cette forme, au besoin précis et avoué d’avoir quelque chose d’irremplaçable et d’impartagé à défendre.
« Contrats affectifs… », dites-vous, amis de l’Ordre nouveau. Bien. Très bien. D’accord. Mais alors, comment osez-vous ajouter : « limitée et régionale » ? Le premier terme exclut le second. Après avoir isolé, mis en lumière le caractère original, unique, du concept patrie, vous retournez aux considérations habituelles sur l’adhérence de l’individu au lieu, à la région, au pays. Vous ne parvenez pas à séparer utilement la patrie-contrat de la patrie-local. La première a une dignité, un prix, une réalité qu’il serait vain de demander à la seconde. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire a démonté avec facilité, et un sourire de circonstance, l’espèce d’idole à rabais que constitue la patrie-local. Celle-ci n’est qu’illusion.
Illusion acceptée sans doute, illusion meurtrière certainement, illusion qu’il appartient à l’homme libre de rectifier, au profit de l’autre patrie, celle que ne restreint aucun impératif géographique, celle que ne pollue aucun orgueil impérialiste, cette terre camarade où l’idée se repose entre deux tentations.
P.-S. : J’ai écrit ces lignes avant d’avoir lu le remarquable article de M. Henri Nadel : « La Nation contre la Patrie » que publie la revue Europe dans son numéro du 15 avril. Sans me rallier entièrement à la position doctrinale de M. Nadel, je ne peux m’empêcher de relever les nombreux points qui nous rapprochent. Il dit, par exemple : « plus un homme est cultivé, moins il compte de compatriotes… Elle est faite (la patrie) de morceaux, parfois très éloignés les uns des autres, et que chacun juxtapose selon ses goûts, selon les hasards de la vie… La patrie est une création continuelle. Elle n’a de frontières ni dans le temps, ni dans l’espace. » Voilà quelques propositions auxquelles je souscris d’autant plus volontiers qu’elles ont servi de point de départ à mes réflexions.
Le Rappel à l’ordure, 1935
Hiroshima, mon souci
(1963)
On vient d’apprendre qu’avant le lancement de la première bombe atomique sur le Japon, quelques savants ont manifesté leur trouble. Il y avait tout de même de quoi !
Dix-huit ans après la démonstration fulgurante que l’on sait, les archives ultrasecrètes de l’histoire nucléaire américaine ont laissé filtrer certains détails sur l’offensive de scrupule qui précéda l’offensive tout court. Car il fallait qu’il y eût scrupule pour que le champignon soit légitime. Qu’est-ce qu’un crime sans scrupule préalable sinon un mauvais fait divers dont nul enquêteur ne voudrait ?
Nous sommes en mai 1945. La bombe est prête. Il ne s’agit plus que d’en faire usage. L’Allemagne a déjà capitulé. Le Japon résiste encore. Mais point n’est besoin d’avoir accès aux chancelleries ou aux états- majors pour comprendre que la guerre touche à son terme. Les Japonais s’accrochent toujours au terrain. C’est le dernier baroud. Ainsi le veut leur tradition de l’honneur. À Washington cependant, Truman s’affaire. Il consulte ses conseillers militaires, les experts, les savants. Il s’apprête à prendre, en effet, ce que l’on appelle aujourd’hui une grande décision morale. Le général Marshall, rendons-lui cet hommage, n’était pas très chaud pour la bombe atomique. On sent bien que 1’objet lui répugne. Il voudrait que l’on instruise l’adversaire des vertus de la bombe en faisant sauter un objectif purement militaire, un arsenal ou une base de la flotte nippone. Les savants, eux, sont partagés. Sept d’entre eux groupés autour de James Franck, prix Nobel de physique, sont hostiles à l’emploi de la bombe. Le physicien hongrois Leo Szilard insiste pour qu’un avertissement solennel soit adressé au Japon avant tout recours à l’arme absolue. Il écrit dans ce sens à Truman, mais celui-ci ne recevra jamais sa supplique. Trop de gens importants encadrent le président et jouent les Ponce Pilate en se lavant les mains à l’eau lourde. Chose curieuse, Oppenheimer dont on a fait, par la suite, un humaniste sensible à la tragédie nucléaire se sépare de ses collègues les plus hésitants et ne voit aucune objection à en finir avec Hiroshima.
C’est comme cela qu’un matin du mois d’août Truman appuya sur le bouton. Il ne fut pas jugé à Nuremberg car les vainqueurs ne passent jamais en jugement. Il désirait, paraît-il, hâter la fin des hostilités, épargner des vies américaines. C’est un alibi qui peut figurer dans tous les dossiers. En vérité, si Truman souhaitait abréger l’effusion de sang, il disposait d’un moyen fort simple et peu coûteux pour atteindre son but. Un contact diplomatique pris à Stockholm ou à Berne avec les représentants du Japon eût permis d’obtenir — moyennant quelques télégrammes chiffrés — une paix qui n’aurait pas été un lendemain d’apocalypse.
Ce qui intrigue le plus dans ce déballage de remords radioactifs, c’est que l’on pose toujours la question Hiroshima et jamais la question Nagasaki. À supposer que le lancement de la première bombe ait répondu à une nécessité impérieuse, que faut-il penser de la seconde. Rien apparemment, puisque personne n’en parle. C’est donc qu’elle est entrée dans les mœurs. L’essentiel est de ne pas nous persuader qu’elle en soit sortie.
Notre époque est vulnérable moins parce qu’elle accepte la guerre que parce qu’elle s’enivre du mythe du savant. Elle croit pouvoir réconcilier dans le savant l’homme de savoir et l’homme de sagesse. Profonde erreur. Le savant aujourd’hui est un employé comme les autres. Un chef de bureau de la terreur. Assis sur ses équations, il administre ses neutrons et ses protons avec des soins de vieil avare. Bien sûr, de temps à autre on nous informe que le savant est inquiet. Et le monde aussitôt de s’attendrir. Songez donc, ce beau savant qui lit à travers les mystères de la création veut bien s’offrir le luxe d’un moment d’inquiétude. Mais il convient de ramener le phénomène à de plus justes proportions. L’inquiétude du savant, c’est quelque chose comme la crampe de l’écrivain ou le hoquet de l’alcoolique. Un des tics du monde moderne.
Ce dont on aimerait s’assurer ce n’est pas que le physicien nucléaire soit la conscience de l’atome. C’est qu’il ait un atome de conscience.
Jeune Afrique, août 1963
Sarajevo a cinquante ans
(1964)
Sarajevo, on ne connaît plus très bien ça. Une ville paisible recroquevillée dans l’oubli. Avec un nom qui fait penser à des tremblements de terre. Et, de fait, le monde a tremblé. « Vieilles mosquées », précise le petit Larousse, sans que l’on sache s’il faut prendre cette indication dans le sens péjoratif ou comme un gage de pittoresque. Les vieilles mosquées ont survécu. Mais, à Sarajevo, le 28 juin 1914, le cœur de l’Europe a cessé de battre.
Ce jour-là, un étudiant serbe abattait au pistolet l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Imaginons le processus inverse : l’archiduc tue l’étudiant. Rien ne se produit, nous avons un fait divers et point d’événement. Mais François-Ferdinand était l’héritier de la plus ancienne dynastie européenne, le porteur de la légende des Habsbourg. Notre époque a de grosses semelles et elle les emploie à piétiner les légendes. La monarchie habsbourgeoise régnait sur un Etat multinational où voisinaient toutes les souches et toutes les races : Allemands et Magyars, Serbes, Bosniaques, Slovènes, enclaves italiennes et minorités slaves, cet Empire était une école de coexistence. L’attentat de Sarajevo fit voler en éclats cette belle mosaïque. L’Europe des grandes familles cédait la place à l’Europe des nationalités qui, une guerre plus tard, devenait l’Europe des idéologies. Des trois, il est difficile de dire laquelle est la bonne. En 1914, les pères se sont battus pour unifier (ou pour venger) des patries ; en 1939-45, les fils se sont battus pour unifier le monde. Mais le monde est désuni et les patries sont maussades. La prochaine fois, on se battra pour les abolir. Car l’histoire a besoin de cimetières.
Sur la dépouille de François-Ferdinand, les ultimatums chutaient comme des feuilles arrachées par l’orage. Le Tsar voulait affranchir les Slaves. La France tenait à récupérer les Alsaciens. L’Allemagne était à l’étroit. L’Angleterre confondait la liberté des mers avec sa passion du commerce. Le Monténégro trépignait sur son rocher. Les peuples hurlaient à la mort, chacun se représentant la mort comme une promenade sur le cadavre de l’autre. Jamais peut-être plus grave désordre mental ne s’empara d’un continent entier. Les fanfares amplifiaient la voix des foules. Les cloches portaient l’appel au suicide jusque dans les villages les plus reculés. On assassinait Jaurès au nom de Barrés, mais la gauche et la droite n’étaient déjà plus que des flèches sur les cartes des états- majors. Dans ce concert insensé, les responsables de l’Europe continuaient à s’écrire d’étranges billets et à se traiter de « cher cousin ». Certes, ils s’adressaient des reproches mutuels, mais ont eût cru qu’ils discutaient d’une excursion manquée ou d’une tasse de thé renversée sur le tapis. Nicolas II terminait ses messages au Kaiser par la formule langoureuse : « Ton Nikky qui t’aime. » Ces messieurs rendaient la vie impossible à leurs tailleurs car ils avaient de très sérieux problèmes d’uniformes. Ils étaient, en réalité, victimes d’un malentendu tragique. La tête perdue dans le XVIIIe siècle, ils ne savaient pas que leurs pieds foulaient le XXe. Erreur funeste : ils pensaient combattre selon l’usage d’un temps raffiné et ils s’avançaient en pleine barbarie.
Dans son livre La Fin des aventures, l’historien Guglielmo Ferrero considère non sans raison le code de la guerre au XVIIIe siècle comme l’une des conquêtes de la civilisation.
« La limitation de la guerre, écrit-il, s’organise en un système de règles précises à ce moment-là. La guerre est définitivement conçue comme une lutte entre armées en champ clos à laquelle les civils assistent en spectateurs. Le maréchal de Saxe disait qu’une armée de quarante-deux mille hommes devait suffire à un bon général pour résoudre tous les problèmes politiques que son gouvernement lui proposait. » Et Ferrero de citer la parole de Joly de Maizeroy : « La science de la guerre ne consiste pas seulement à savoir combattre mais encore plus à éviter le combat, de manière qu’on arrive à son but sans se compromettre. »
De nos jours, on définit une opération militaire comme un « risque calculé ». Jadis, la guerre passait pour un calcul risqué. L’important était de mener à bien une campagne sans introduire dans le conflit les notions inflammatoires de justice et de droit. « Malheureux, s’écrie Ferrero, les belligérants qui prennent les armes convaincus de se battre pour la justice et le droit ! Ils se battront jusqu’à l’épuisement et la guerre deviendra interminable. Il faut aller à la guerre en admettant que la cause de son adversaire est aussi juste que la sienne. »
La guerre des nations a balayé ces préceptes honorables. Les seules consignes qui prévalent sont celles de l’acharnement et de la fureur. La phrase célèbre « reddition sans conditions » eût semblé aberrante et grotesque à des stratèges d’il y a deux siècles ou même d’il y a cent ans. Et le moins qu’on puisse dire à cet égard est que cette phrase appartient à un autre âge, celui d’Attila ou de Tamerlan.
Sarajevo a donc sonné le glas de la guerre tranquille. À l’extrémité de la course au paroxysme guerrier, nous trouvons Hiroshima. Deux villes à jumeler devant l’Histoire : vieilles mosquées d’un côté, jardins radioactifs de l’autre. Il n’est pourtant pas impossible que, parvenue au comble de l’outrance, l’humanité cherche à redécouvrir des modes d’affrontement moins rageurs et plus rationnels. Nous ne recommandons pas ici le retour à une « guerre conventionnelle » dont on ne connaît que trop les ravages et l’aveuglement qu’elle peut provoquer. Mais on se féliciterait d’apprendre que l’esprit du maréchal de Saxe est revenu au goût du Pentagone et du Kremlin. Aucune objection à ce que la guerre de demain soit une épreuve entre membres de clubs rivaux, une querelle entre spécialistes qui se viderait sur le champ de tir. Il existe encore des îlots déserts sur lesquels chacun pourrait exercer ses vertus balistiques. Et la victoire couronnerait non pas la cause de la justice, mais le tireur qui viserait le plus juste.
Jeune Afrique, juin 1964
Quelques bonnes raisons pour faire la guerre
(1965)
Quarante guerres en vingt ans, cela représente un bilan tout à fait honorable. D’autres époques ont peut-être connu mieux ; mais elles n’avaient ni l’ONU, ni les casques bleus, ni la colombe de Picasso, ni les poèmes de Neruda. Tous ces ingrédients de paix n’ayant rendu que de modestes services, il faudrait se demander s’il n’existe pas une vocation guerrière profondément enracinée (et souvent camouflée) dans le tréfonds de l’être humain. Portons-nous vraiment sous la peau des galons intérieurs qui n’attendent que l’occasion d’émerger au grand soleil des batailles ? Cette hypothèse n’est qu’à moitié vérifiable. En fait, la guerre n’a pas à se justifier ; elle justifie trop de gens et trop d’activités pour avoir elle-même besoin d’alibis.
Si l’on excepte du tableau les guerres de libération nationale — Indochine, Algérie, Angola, campagne de Castro contre le régime de Batista, etc. — on reste en présence d’un nombre assez impressionnant d’opérations martiales qui suggèrent les réflexions suivantes :
1- Les petites guerres sont un moyen d’écouler au rabais la ferraille des conflits sérieux : chars démodés, avions asthmatiques, destroyers rouillés, etc.
2- La guerre est, dans le contexte du monde politique actuel, un terrain de promotion accélérée en même temps qu’une école du pouvoir. La partie se joue de deux façons : en cas de défaite, les militaires annoncent qu’ils ont été trahis par des gouvernements équivoques ou veules, ce qui leur permet de chasser ces derniers et de transformer l’État en caserne privée ; en cas de victoire, ils réclament la récompense naturelle qui leur est due et qui consiste à en finir avec le régime des civils.
3- La guerre est la ressource nationale des pays pauvres. Ceux-ci, découragés par les perspectives d’un développement aussi lent qu’incertain, inclinent volontiers à croire que s’ils ne faisaient pas un peu la guerre, ils ne sauraient rien faire d’autre. Le raisonnement semble spécieux mais il est parfois payant. Un petit pays qui commence une guerre compte que les grands pays lui donneront de l’argent pour y renoncer. Avec cet argent, on double la mise : on achète des armes en vue d’un second épisode plus risqué que le premier. Dès que le canon tonne de nouveau, on prépare l’addition que l’on invitera les États les plus fortunés à régler sous forme de crédits, financements de toutes sortes, etc.
4- En dernier lieu, la guerre présente un intérêt éducatif sur lequel on met rarement l’accent : elle sert à informer certaines populations demeurées en marge du progrès que leurs pays contiennent, ou pourraient contenir, du pétrole, du manganèse, du cobalt, de l’uranium et bien d’autres choses indispensables à la production industrielle des puissances vraiment modernes. Ces révélations ne compensent-elles pas l’émotion que peut susciter un débarquement imprévu sur un littoral tranquille ou un lancer de parachutistes dans un jardin potager ?
Comment veut-on que la guerre prenne fin quand il y a tant de bonnes raisons pour qu’elle se perpétue à l’infini ?…
Jeune Afrique, octobre 1965
***
Poussé par ses besoins
Poussé par ses besoins, ses désirs et surtout par ses rêves, l’homme, depuis la découverte du feu, s’est toujours efforcé de transformer le visage du monde.
La lutte n’a jamais cessé entre les jeunes Prométhée, foyers des rêves incendiaires, et les pères chez qui le feu des rêves s’est éteint et qui sont devenus les défenseurs et les gardiens de l’existant.
Nous qualifions de complices, donc de criminels, tous ceux chez qui le visage actuel du monde – de plus en plus atroce – ne provoque pas la plus farouche des révoltes.
À la tête de ces criminels se trouvent tous ces odieux pères (spirituels ou non), tous ces chefs (politiques ou non), qui ne font, par leur dynamisme ou par leur poids, que confirmer sinon renforcer les lignes maîtresses de l’ordre patriarcal existant, même lorsqu’ils professent des principes dits révolutionnaires.
Par la nature même de leurs fonctions, les pères et les chefs sont en général des éléments intrinsèquement suspects.
Vis-à-vis des pouvoirs, héritiers du sinistre état du monde présent, le premier pas valable, c’est l’INSUBORDINATION CIVILE – sur toutes les lignes, surtout cette ligne la plus ignoble et la plus mortelle, la voie de la guerre… La guerre qui tue les fils au profit des pères privilégiés de cette exécrable société…
Jeunes de tous les pays : scandalisez vos pères ! Crachez au visage des militaires !…
Ramsès Younan
Paris, 1949
