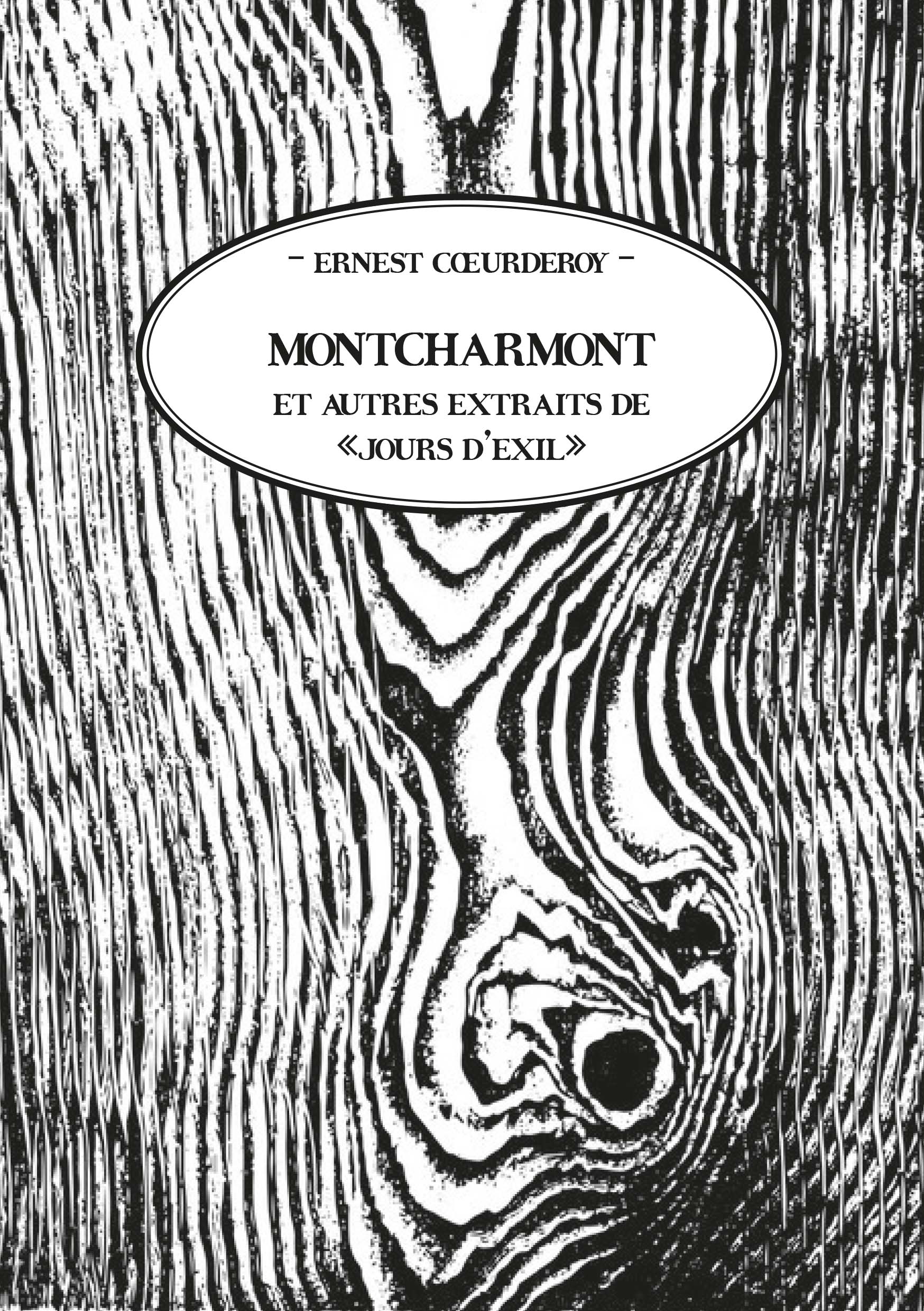
Alors, s’écrieront les bourgeois, notre ordre social est donc à la merci du premier misérable venu ?… Et si ce premier misérable venu est à la merci, lui, de votre ordre social, de votre sécurité et de votre propriété ? Et si votre ordre social, votre sécurité, votre propriété exigent que ce misérable soit dépouillé de sa part des biens communs, de ses droits naturels, de la vie même, il faut donc qu’il respecte tout cela ? Allons donc !
Oui, bourgeois, la lutte est engagée dans ces termes entre la société et l’individu. Oui, tout condamné a le droit de fusiller le premier juge venu, car tous les membres du très-illustre corps de la magistrature sont solidaires dans les conséquences de l’homicide légal. Nous faisons de la barbarie, vous faites de la civilisation ; je ne sais où est la plus grande cruauté, chez vous ou chez nous. Puisque vous voulez conserver vos privilèges, résignez-vous à la guerre et au duel dans lesquels les chances de mort sont égales pour les deux adversaires.
Pour télécharger la brochure: Montcharmont et autres extraits de Jours d’Exil – Ernest Cœurderoy- A5 page-par-page
Ci-dessous, le texte de la brochure:
Les jours de la haine
Dans l’affrontement contre la réalité, aucun livre, aucune œuvre humaine ne marque un point définitif à son avantage. La réalité a toujours quelques pas d’avance. Un résidu religieux nous pousse à voir, dans les grandes analyses et les grandes expériences, notre « guide », et à rassembler et numéroter ces analyses et ces expériences dans de courtes listes capables, selon nous, de nous indiquer la route. Mais la réalité n’accepte pas les imitations bibliques.
Sanctifier un texte peut être utile pour de nombreuses raisons, toutes fonctionnelles à la construction du pouvoir. Même s’il s’agit d’un « nouveau » pouvoir, cela revient au même. Pendant des années, nous avons juré sur Marx. Cherchons à éviter, désormais, de jurer sur quelqu’un d’autre.
Ceux qui contribuent à sanctifier les textes, ce sont bel et bien les exégètes, les préfaciers, les chercheurs, ceux qui les systématisent. « Mon Dieu ! – s’exclamait Cœurderoy – délivrez-moi du mal, je veux dire des faiseurs de préfaces ». Jusqu’à aujourd’hui, le sort lui en a peu donné. Gross et Nettlau furent les premiers. S’apprêtant à résumer les Jours d’Exil, le premier, inquiet, en considérait la grande valeur littéraire et artistique ; le second immergeait le tout dans sa célèbre érudition. C’était justement le danger entrevu par Cœurderoy : un long, un exténuant effort introductif, qui rend compte de tous les mouvements, de tous les événements, de toutes les affaires privées de l’auteur, ou de toutes les prétendues qualités esthétiques d’un langage et d’un art considérés comme des instruments externes à leur contenu ; tout ça pour finalement ne rendre compte de rien, et livrer le lecteur au contact brutal avec le texte, le livrant à la sagacité interprétative, véritable et solitaire. Une césure entre les temps révolutionnaires de la lecture et le texte, et celui qui fait crisser le verrou de cette serrure à double tour, c’est justement l’autorité indiscutée de l’érudition du bon Nettlau.
Vient ensuite l’exhumation situationniste. Les cimetières sont souvent plus animés qu’on ne le pense. Vaneigem n’est évidemment pas Nettlau. Mais, d’un autre côté, son travail introductif se reflète une nouvelle fois dans les préoccupations de Cœurderoy : ce qui intéresse le théoricien situationniste c’est d’accréditer les anticipations et les suggestions analytiques de l’Internationale situationniste, plus que l’évaluation de la réalité révolutionnaire et du rapport qu’entretient – aujourd’hui – cette réalité, celle dans laquelle nous vivons, avec les expériences consignées plus d’un siècle auparavant par l’anarchiste Cœurderoy.
Une belle analyse, sans aucun doute, que celle de Vaneigem, mais à sens unique. Une analyse qui, contre le parti et contre l’orthodoxie, finit par retrouver un parti et une orthodoxie au-delà du cercle stalinien. Il n’y a pas que les staliniens qui peuvent être staliniens. Les libertaires courent aussi ce risque, avec la circonstance aggravante que, quand ils s’y trouvent entraînés, ils ne s’en rendent pas comptent, car ils ont l’alibi de la liberté à tout prix.
Cœurderoy est un anarchiste. Solitaire dans ses idées. Non pas un anarchiste de salon, ni un philosophe, bien que tranchant et conséquent jusqu’au bout, comme Stirner. Un anarchiste et un révolutionnaire. Il a fait la révolution de 1848 à Paris, il a vu le sang rougir la Seine, et les nouveaux jacobins recueillir l’héritage de Babeuf. Médecin, il a vu les misères et les grandeurs de l’homme, du corps de l’homme, dans la joie de la vie et sur la table d’autopsie. Conspirateur et agitateur, il a vécu les mesquineries et les petitesses des organisations pleines de grandes paroles, de slogans et de drapeaux, mais aussi de petits délires de grandeur et d’arrivisme. Exilé, il a vécu la vie inconsistante des mouvements révolutionnaires à l’étranger, les trames de la police, les contrôles étouffants, la lutte contre la faim, le désir de retourner au pays. Écrivain, il a revécu toutes ces expériences, avec une pénétration magistrale, sans pudeurs, sans rien cacher, sans peur de blesser telle ou telle personne, telle ou telle organisation révolutionnaire. Humain, seul devant lui-même, il a décidé de se tuer, et il l’a fait. La logique révolutionnaire n’admet pas de bond en arrière.
« Pour faire passer la révolution, comme un fer rouge, à travers ce siècle, une seule chose est à faire : démolir l’Autorité ».
Ce concept est global, c’est-à-dire qu’il présuppose la destruction de la totalité du pouvoir, une dimension révolutionnaire globale. Comme le lecteur le verra facilement, les concepts développés par Cœurderoy ne sont jamais des concepts stratégiques, mais des concepts qui comptent se référer à la totalité révolutionnaire. La conception de la « révolution » dans le sens courant, c’est-à-dire dans le sens du dépérissement et du remplacement des vieilles institutions, lui est absolument étrangère. Et, en fin de compte, c’est justement cette dernière conception de la révolution qui peut être liée au temps, au concept du « temps qui passe », au principe stratégique de l’historisation. L’autre conception, celle globalisante, n’a qu’un raccord synchronique avec le temps. Des faits lointains dans le temps deviennent présents, ils reviennent dans la dimension de « ce qui survient », parce qu’ils sont liés à « ce qui subsiste », qui est une des caractéristiques du même processus temporel. Si l’histoire du monde est l’histoire de la lutte des classes, c’est-à-dire l’histoire de l’exploitation, le sens de l’évolution historique ne peut pas mettre au second plan le sens de la totalité du monde et de l’élément qui la caractérise : « ce qui subsiste » – à l’intérieur des diverses modifications – de l’exploitation. Donc, quand le révolutionnaire, au nom de son organisation, développe (justement) une analyse stratégique, il tient compte, sans doute, de cet ennemi qui lui fait face, mais il est amené à l’identifier dans ses connotations historiques précises, dans les formes qu’il prend au cours du temps ; l’autre élément, celui global, s’il ne lui échappe pas, passe au second plan. Au contraire, le révolutionnaire doit aussi penser le « tout », c’est-à-dire qu’il doit évaluer les éléments de la permanence à l’intérieur de la modification, s’il ne veut pas remettre ses efforts dans les mains de ceux qui font de la permanence de l’autorité le but de leur action.
Tout cela, pour Cœurderoy, est considérablement facilité. Sa lecture de la réalité est celle d’un poète, son instrument linguistique, celui d’un artiste, mais son expérience est celle d’un révolutionnaire. Le caractère contradictoire du conflit social se présente à lui d’un trait, éblouissant. Pour lui, bien au-delà de la rationalité de la connaissance, c’est la catégorie essentielle de l’agir qui conditionne et codifie le modèle économiciste de la révolution autoritaire. Mais ce « sens de la lutte » ne lui vient pas d’une superposition arithmétique. Une analyse des unités qui, additionnées, composent la totalité. Le concept d’ « élément » de la totalité, et le concept de « système » de la totalité ou de « totalité systématique » lui sont étrangers. Ses analyses visent progressivement à détruire cette illusion. L’homme peut imposer sa prédominance sur l’évolution contradictoire du conflit de classe, à la seule condition qu’il admette le caractère contradictoire des moyens pratiques mêmes, qui lui rendent la prédominance possible. Dans le cas contraire, il restera à la merci des événements, rêvant de réformes impossibles, et autant d’impossibles dominations absolues.
Donnons un exemple. Tous se rappellent des passages où Marx se lance contre le sous-prolétariat, l’amalgamant aux voleurs et aux prostitués, et unissant dans la même condamnation ces derniers à tous ceux qui ne font pas partie de la « classe ouvrière ». Les raisons de cette condamnation sont vite dites. La révolution est possible – selon Marx – à la seule condition que se développe une grande classe ouvrière, capable d’abattre la classe bourgeoise. Tout retard dans le développement de la classe prolétarienne est un poids pour la révolution. Et, de cette manière, les sous-prolétaires, les chômeurs, les ghettoïsés et les criminalisés, sont vus comme un poids contre-révolutionnaire. C’est facile de comprendre comment, dans cette voie, on va droit vers le stalinisme et comment tous ceux qui ne pensent pas comme l’autorité en charge deviennent des « poids pour la révolution ». Mais voyons, à l’inverse, les affirmations de Cœurderoy :
« Garde-toi, surtout, Prolétaire ! de marquer du stigmate de l’infamie ceux de tes frères qu’ils appellent les Voleurs, les Assassins, les Prostituées, les Révolutionnaires, les Galériens, les Infâmes. Cesse de les poursuivre de tes malédictions, ne les couvre plus de boue, écarte de leur tête le couperet fatal. Ne vois-tu pas que le soldat t’approuve, que le magistrat t’appelle en témoignage, que l’usurier te sourit, que le prêtre bat des mains, que le sergent de ville t’excite ? Insensé, insensé ! ne sais-tu pas qu’avant d’abattre le taureau menaçant, le matador sait faire briller dans le cirque les derniers efforts de sa rage ? Et qu’ils se jouent de toi, comme on se joue du taureau, jusqu’à la mort ? Réhabilite les criminels, te dis-je, et tu te réhabiliteras. Sais-tu si demain l’insatiable cupidité des riches ne te forcera pas à dérober le morceau de pain sans lequel il faudrait mourir ? Je te le dis en vérité : tous ceux que les puissants condamnent, sont victimes de l’iniquité des puissants. Quand un homme tue ou dérobe, on peut dire à coup sûr que la société dirige son bras. Si le prolétaire ne veut pas mourir de misère ou de faim, il faut : ou qu’il devienne la chose d’autrui, supplice mille fois plus affreux que la mort ; – ou qu’il s’insurge avec ses frères ; – ou bien enfin, qu’il s’insurge seul, si les autres refusent de partager sa résolution sublime. Et cette insurrection, ils l’appellent Crime ! Toi, son frère, qui le condamnes, dis-moi : vis-tu jamais la mort d’assez près pour jeter la pierre au pauvre, parce que, sentant l’horrible étreinte, il déroba, ou plongea le fer dans le ventre du riche qui l’empêchait de vivre ? La société ! la société ! voilà la criminelle, chargée d’ans et d’homicides, qu’il faut exécuter sans pitié, sans retard ».
L’ennemi est vu dans la société, non pas parce que tous les éléments de celle-ci sont également responsables (interclassisme banal), mais parce qu’elle est elle-même le produit de cette partie plus forte, qui a en main la domination. Si, dans le futur, la partie qui est aujourd’hui la plus faible, devait conquérir le pouvoir, et exercer à son compte cette domination que pendant si longtemps elle a supportée, il n’y aurait pas de différences radicales. L’histoire aurait marqué le passage d’une contradiction du conflit à une autre, différente de la première si l’on veut, même profondément différente, mais il n’y aurait pas eu l’élimination des contradictions et la naissance d’une société nouvelle. L’ennemi serait encore la société, dans son ensemble, parce que celle-ci, tout en modifiant tant de choses, a laissé intact au fond l’esprit contradictoire par excellence : l’esprit du pouvoir et de l’exploitation.
Le défi philosophique de Stirner est réaffirmé par Cœurderoy, avec la force de l’expérience qui provient des désillusions souffertes sur le terrain même du conflit révolutionnaire. C’est une des raisons pour laquelle deux auteurs si semblables ont eu un sort si différent. Sur le « philosophe » Stirner on a déversé des tonnes de papier, les analyses ont succédé aux analyses, souvent trompeuses et sans conclusion, mais, néanmoins, il y en a eu. Sur Cœurderoy : le silence uniquement. « Je vous offre ce livre, prolétaires ! et j’en impose le scandale aux bourgeois, ces chiffonniers parvenus dont je suis sorti. Que les ré-vol-ut-ionnaires-bornes tempêtent ; que leurs Jupiters me foudroient ; il n’est pas besoin d’être géant pour affronter la colère des Dieux modernes. Je le sais, les partis se déchaîneront contre moi, le silence et l’isolement s’étendront comme un crêpe autour de mon âme aimante ». Certes, c’était moins engageant de se confronter à Stirner, en s’asseyant confortablement sur les restes de l’analyse de Marx, et dissimulant son inquiétant intérêt derrière l’alibi de la philosophie. S’occuper de Cœurderoy est moins commode. Être continuellement en train de réfléchir sur les responsabilités des « fausses consciences ». Surtout, quand quelqu’un s’est construit sa fausse conscience avec tant d’efforts, il lui est vraiment désagréable que quelqu’un d’autre la lui secoue, en en fêlant la fermeté obtuse. Et personne n’est plus ferme et plus obtus que celui qui a trouvé dans un parti « révolutionnaire » le port final à ses inquiétudes. Gare à ceux qui le suivent jusqu’à la rade de ce port : tout ce que l’on peut y attendre, quand ce ne sont pas les injures et les calomnies, c’est le silence méprisant. « Mes contemporains ne me comprendront pas. Je n’ai pas la prétention d’allonger la vue des myopes. Les civilisés ne vivent que dans le présent, ils sont incomplets. Je ne vis que dans l’avenir, je suis incomplet aussi. Je ne saisis que les grandes lignes du tableau social ; ils n’en comprennent que les détails infiniment petits. Nous différons, et l’humanité ne s’est pas encore complétée par l’accord de ses contrastes. Il n’est pas d’entente possible entre ce siècle et moi ».
De même que pour Stirner, on pose aussi pour Cœurderoy le faux problème de l’individualisme. La lecture superficielle de certains extraits de son œuvre peut conduire à des conclusions erronées. Il n’y a qu’une réalité : son détachement des intérêts de partis, intérêts qui se placent à l’intérieur d’une arche de parti ou de mouvement et qui répondent à des interprétations organisativo-stratégiques. Tout cet ensemble d’intérêt n’est pas identifiable dans ses réflexions. Comme révolutionnaire, se voyant élément d’un tout qui se déroule sous ses yeux, d’un tout qui se structure sous forme d’attaque contre l’autorité, sans besoin d’avoir recours aux traditionnels rangements de la scolastique révolutionnaire, Cœurderoy rend son être individuel gigantesque. Mais il le fait avec la conscience de ses capacités.
« L’orgueil ne m’aveugle pas, j’ai confiance en moi-même ». Et ailleurs : « La Révolution m’a donné la fièvre ; je ne m’en plains pas, et je ne prie personne de m’en plaindre. Mais je ne puis pas exiger non plus que tout le monde ait la fièvre. Vouloir que les civilisés se passionnent pour la révolution sociale, c’est présenter de l’eau à des chiens hydrophobes ». Sa lutte, ne l’oublions pas, est marquée par les expériences brutales, les déceptions, par la connaissance directe des mesquineries et des petitesses de tant de prétendus « grands hommes ». C’est pour ça que dans ses pages, l’humanité du doute côtoie la grandeur du défi. Ce qui, chez Stirner, est la lame froide du raisonnement, est remplacé ici par le parcours tordu de la passion et de l’anxiété, du désir et de la déception. Pour Cœurderoy, conscient de ces limites et de ces obstacles, la tâche est beaucoup plus difficile que pour Stirner. Le philosophe allemand se trace un parcours, il l’achève jusqu’au bout avec la froide détermination teutonique, son livre est unique, tout comme son expérience intellectuelle. Après lui, le déluge. L’écrivain français amène avec lui ses expériences, sa vie, ses amours. Il ne parvient pas à se détacher de son corps, avec l’inquiétude passionnée des Latins, il vit jusqu’au bout les contradictions qui y sont liées. Pourtant, le philosophe et le poète se rencontrent dans la conclusion logique de sa vie et de sa théorie. Ce n’est que quand la vie est véritablement vécue (et non laissée vivre), qu’elle est alors, elle-même, théorie, et la plus grande construction théorique (du philosophe, du poète, comme du militant révolutionnaire) est sa vie même. Dans la fracture entre vie et théorie, émerge toujours le philistin, même derrière les cris et les imprécations, les déclarations enflammées et les « détruisons le monde ».
« Première des qualités, aimable confiance en soi, ne m’abandonne pas ! Noirs découragements, restez sous mes pieds ! Je ne veux plus entendre la voix du désespoir. Je veux savoir ce que l’organisation de l’homme peut supporter de travail, de fièvre et de déceptions. Je m’avancerai dans le domaine de la Pensée, jusqu’au sombre empire de la Folie ; je sonderai le gouffre de la Révolte, jusqu’au rocher glissant où trône le Crime ; je boirai tout ce que contient d’écume et de lie la coupe de fiel. Alors seulement, je pourrai dire qui est fou, criminel et traître dans les Babylones qui croulent ».
L’exaltation du moi, chez Cœurderoy, est un cri désespéré, c’était une déduction logique de prémisses considérées suffisamment solides. L’humanité de l’aventure intellectuelle de Stirner est cachée entre les lignes d’un style philosophique. L’humanité de Cœurderoy explose poétiquement par vagues successives, bouleversant le lecteur. Dans l’atmosphère de l’Unique, on peut aussi s’y abandonner à la thèse de l’auteur, suspendre son jugement, laisser faire. Dans l’atmosphère des écrits de Cœurderoy, on s’y trouve impliqué dès le début. Ou bien on abandonne la lecture, ou bien on est obligé de prendre parti, de partager ses idées ou de les repousser. La cohérence logique est soumise au sentiment, la dilacération de la volonté prédomine sur la netteté des résultats, la raison dogmatique perd le contrôle devant l’émergence de la raison du cœur qui, elle seule, possède plus de raisons que ne peut en contenir la première.
L’individualisme de Cœurderoy est donc le produit d’une expérience vaste et contradictoire. Le laboratoire des idées lui est étranger, ce laboratoire où chaque chose est à sa place, les étagères pleines des présences littéraires du passé et les instruments luisants de la logique en bon ordre. « Il est dans la nature de l’homme de se considérer comme le centre du mouvement universel et de rapporter tout à lui. L’histoire, c’est lui ; l’art, c’est lui ; la poésie, c’est lui. Tout est dans lui ; il est dans tout. L’égoïsme est le salut de tout être. L’amour de soi régit l’humanité ». Mais, un peu après, il écrit : « Les feuilles d’automne couvrent la terre d’un manteau de pourpre ; c’est leur parure et leur sang que les arbres abandonnent. Et voilà que mes années s’envolent comme les feuilles desséchées ; voilà que j’en suis à compter mes jours. Mon entreprise n’avance pas comme je le voudrais ; c’est toujours d’un pied tardif que l’exécution suit les désirs aux ailes rapides. Oh ! quelles angoisses je souffre, quand je sens la terre trembler sous mes pieds, et que le tonnerre parcourt le ciel en grondant ! »
La révolution est-elle un fait progressif ? Une affaire de conquêtes partielles qui s’additionnent les unes aux autres et se développent dans le temps ? La révolution est aussi cela. Mais pas uniquement. Après la plus grande des révolutions, la France a su, à d’autres occasions, retourner sur les barricades. Cœurderoy a vécu les journées de 1848. Pour lui, celles-ci furent le dernier cri de la révolution jacobine. Après ce sursaut, plus aucune autre illusion n’est possible. Ou bien la prochaine révolution sera la révolution sociale, ou bien ce ne sera nullement une révolution ; ou bien ce sera la révolution des cosaques qui détruiront cette civilisation, ou bien ce sera un bain de sang inutile de plus. « [1848] n’était pas une émeute de boutiquiers ; c’était une révolte d’anges rebelles qui, depuis, ne se relevèrent plus. Tout ce que le prolétariat de Paris renfermait d’invincible énergie et de poésie sublime tomba dans ces jours néfastes, étouffé par la réaction bourgeoise, comme le froment par l’herbe stérile ».
Les esprits candides, comme le bon Nettlau, peuvent sortir de la lecture de Cœurderoy effrayés, et chercher désespérément à sauver ce qui peut être sauvé, car, dans leur naïveté, ils pensent que la fameuse théorie des « cosaques », doit être comprise comme la théorie du « pire c’est mieux c’est ». Dans l’introduction du second volume des éditions Stock, Nettlau ne sait pas à quel saint se vouer pour trouver une échappatoire. « Cette idée a été évidemment inspirée à Cœurderoy par l’attitude de la presse réactionnaire de Paris qui, à cette époque de l’écrasement de la révolution hongroise par la Russie, ne cessait de faire appel au tsar Nicolas, dans lequel elle voyait le sauveur de l’ordre. À ces bruits d’invasion qui étaient dans l’air, Cœurderoy appliqua sa méthode trompeuse de l’analogie, et, comparant la civilisation romaine de la décadence et celle de son temps, le christianisme et le socialisme, les barbares germains d’alors et les Slaves d’aujourd’hui, il conclut que, comme alors, de même de nos jours le progrès de l’humanité se ferait par une mêlée générale comme celle qui mit fin à l’Empire romain. Voilà donc cette fameuse théorie des Cosaques de Cœurderoy, théorie qui a tant contribué à le faire paraître comme un simple excentrique qu’on ne saurait prendre au sérieux ». Ô sainte naïveté. C’était précisément ce genre de dangers que Cœurderoy annonçait quand il écrivait : « Mon Dieu ! délivrez-moi du mal, je veux dire des faiseurs de préfaces ».
En réalité, tout son effort vise à séparer deux conceptions de la révolution, opposées l’une l’autre et cependant toutes deux complémentaires. La première se drape dans l’illusion du quantitatif. Son but immédiat est la croissance numérique des adeptes, tous les efforts qu’elle accomplit visent à faire de la propagande (de toutes les manières) pour arithmétiser les gens. La seconde, bien que tenant compte de l’importance du nombre dans les aspects militaires du conflit, insiste sur l’affirmation que la révolution sociale est une question plus large et plus complexe qu’une simple croissance quantitative, et que souvent, cette croissance ne correspond pas à la réalisation des conditions révolutionnaires mais, aussi étrange que cela puisse paraître, en constitue un poids et un obstacle.
Les révolutionnaires du premier type sont ceux autoritaires, mais, et c’est là que réside le plus grand danger, ils comptent aussi des libertaires qui se font piéger par cette méthode politique. Pour les partis soi-disant révolutionnaires cela est légitime. Pour les anarchistes et les libertaires c’est absurde. La dimension de lutte de ces derniers est sociale, la révolution qu’ils doivent pouvoir réaliser est sociale, le mouvement révolutionnaire dont se préoccuper est le mouvement qui naît chez les exploités, et qui ne s’emprisonnent ni dans un sigle, ni dans une expression géographique. C’est le concept de ce que Bakounine appelait : « le mouvement anarchiste des populations ». Et c’est aussi la négation des partis et de toute autre organisation quantifiante. C’est aussi la négation de la méthode politique.
Les compagnons sont souvent préoccupés par le fait qu’une action donnée ne procure pas une « croissance » politique chez les masses, qu’elle n’ait pas comme conséquence la politisation de couches d’exploités qu’ils considèrent – plus ou moins à juste titre – comme disponibles pour la révolution. Les expériences les plus récentes [1981], particulièrement en Italie, nous ont enseignés, entre autres, qu’il n’est pas possible d’établir un rapport spécifique, déterminable a priori, entre une action révolutionnaire, programmée et réalisée par la minorité, et les conséquences « politiques » que cette action développe dans la masse des exploités. Pendant des années, on a suivi un modèle de travail politique, emprunté aux staliniens, insistant dans la tentative d’imposer à la masse la portée analytique et pratique d’une minorité, à travers une communication de différentes sortes (présences physiques et élaborations littéraires). Il a fallu presque une décennie pour se rendre compte de l’erreur. Mais, puisque l’on sortait d’une période de quasi-paix sociale, faire ces expériences est presque justifié. Ce qui l’est moins, c’est que l’on en revienne, aujourd’hui, à insister sur les mêmes erreurs du passé, en ne voyant pas, ou en faisant semblant de ne pas voir, où se situe la cause de ces erreurs.
Notre projet révolutionnaire est social, il considère la politisation des exploités comme un des éléments pour intervenir dans la réalité des luttes, un des éléments qui conditionnent la stratégie dans sa disposition globale, mais qui ne constitue pas le but exclusif de l’intervention. Il est évident qu’une situation de politisation précise rend possible une certaine intervention, ou, au moins, rend possible une intervention à l’intérieur d’une partie des exploités plutôt qu’une autre. Mais rien de plus.
Dans le sens contraire, en mettant de côté le simple calcul arithmétique, il est absolument impossible d’évaluer les conséquences politiques d’une action. Cela reviendrait à suivre servilement les masses, et non pas à développer cette fonction de stimulation que les anarchistes ont comme tâche première, et à l’assumer à l’intérieur des masses. À l’inverse, on peut évaluer les conséquences sociales et révolutionnaires de l’action, en allant au-delà de ce qu’est, objectivement parlant, la situation politique dans laquelle les masses se trouvent. Dans le cas contraire, quel sens cela aurait de tant parler de l’initiative révolutionnaire comme tâche historique des anarchistes ?
« Je travaille comme le semeur, au gré du temps, au gré du ciel. Quand il fait beau je chante, et quand il pleut, je crie ; rien ne me ferait parler si la langue ne me démange pas. […] Soyez un peu moins violent ! me chantent dans l’oreille droite des gens très comme il faut ; nous vous trouverons un éditeur. — Soyez plus Français et plus démocrate ! me soufflent dans l’oreille gauche des gens moins comme il faut déjà ; notre approbation vous est acquise. — Laisse de côté la philosophie, la diction biblique, la forme nuageuse ; fais-nous de la bonne polémique, de la brochure, du terre à terre ; assomme, brûle, renverse tout ; rends-nous Marat et Camille ! me hurlent à bouche portante des gens comme il ne faut pas ; et tu peux compter sur notre appui ». Les attraits sont différents. Chaque tendance du quantitatif a ses nécessités de propagande et incite à l’analyse. Tout révolutionnaire qui saisit la juste importance de la théorie, se préoccupe de tirer les enseignements de la réalité du conflit de classe. Mais ces enseignements peuvent être utilisés dans les deux façons citées ci-dessus. D’un côté, pour pousser à l’augmentation des forces révolutionnaires visant la conquête du pouvoir ; de l’autre, pour rendre intelligible la composition du front de classe, afin de travailler dans le sens de la révolution sociale. Alors, si cette tendance veut être définitivement libératoire, et ne veut pas être leurrée par la substitution du vieux pouvoir par un nouveau, elle doit partir de l’auto-organisation des luttes des exploités. Cette auto-organisation est déjà en acte, elle constitue, à elle seule, la proposition théorique la plus intéressante que ces dernières années de luttes nous ont fournie. Il incombe à la minorité révolutionnaire anarchiste de ne pas tenter – une nouvelle fois – d’imposer à ce processus de structuration auto-organisative, des formes organisatives qui lui sont étrangères.
Dans ce sens, les expériences du passé, en particulier les expériences dramatiques comme celles vécues par Cœurderoy, doivent servir d’enseignements.
Cessons avec les discussions inutiles sur l’individualisme et sur son opposition aux anarchistes organisateurs. Une théorie du genre n’est pas seulement dépassée, elle est aussi contraire au développement des luttes. Ça ne sera sûrement pas le nouveau « parti » anarchiste qui résoudra le problème de la révolution sociale, mais les exploités auto-organisés, avec la présence des anarchistes, comme porteurs, dans un sens précis, de théories concrètes et les plus claires, à propos des moyens et des possibilités de l’auto-organisation. Cette présence anarchiste ne pourra être fructueuse qu’à condition de ne pas prétendre imposer, de l’extérieur, un modèle d’interprétation de la réalité préordonné, modèle qui, en tant que tel, ne pourra se dire libératoire que par définition verbale.
En brisant le cercle magique de la révolution jacobine et autoritaire, on redonne vie à la capacité auto-organisative des exploités, on abat les mythes de la religiosité du travail, de l’impossibilité de supprimer les leaders, de la moralité de la souffrance, du caractère temporelle de la domination. Le compromis tombe. Face à l’exploité, le mécanisme exploiteur se dessine dans toute sa raréfaction hallucinante. « Non, la destinée de l’homme sur terre n’est pas celle de la bête qu’il conduit au labour. Et les philanthropes qui n’ont à lui montrer à l’horizon que des corps amaigris, des âmes désespérées, des gibets et des tortures, les apôtres du Devoir et du Sacrifice ne parviennent plus même à se faire écouter par les plus simples. Le Bonheur est le but vers lequel tout être s’envole, quand il écoute la grande voix de la nature ». Si le travail est le point de départ pour la distinction de classe, et il ne pouvait pas en être autrement pour Cœurderoy, qui avait face à lui la réalité de la bourgeoisie française dans sa plénitude, il n’est pas vu comme le but suprême de l’homme. Honneur au travailleur, condamnation pour le dépensier fainéant, qui désigne avec justesse le bourgeois s’engraissant sur le dos du producteur. Mais la vie, au-delà du travail, la vie qu’une nouvelle société devra aussi faire éclore, la vie libérée, celle pour laquelle nous luttons, et pour laquelle nos frères sont morts sur les barricades, ne pourra jamais être régulée par l’horloge du temps, par le mécanisme de l’usine, par le lever et le coucher de soleil sur les champs qui exigent la sueur du paysan. La vie doit aussi être Bonheur. « Je l’affirme sur mon âme, le Suicide décimera les hommes tant qu’ils n’auront pas trouvé la voie qui conduit au Bonheur ». Et ailleurs, en approfondissant plus : « Il y aura toujours douleur dans l’humanité, j’en conviens. Mais elle ne sera plus imposée par une classe d’hommes à une autre classe. De cette douleur coupable, véritable péché d’origine, nous nous délivrerons par la science de la justice et de l’harmonie, car cette douleur vient de notre ignorance, de nos discordes, de nos iniquités ».
C’est l’alternative problématique que des expériences récentes, douloureuses et intimes, ont livrée à de nombreux compagnons. Le sacrifice total, même de soi-même, est-il légitime ? Ou bien ce sacrifice, vu ainsi, n’est-il pas autre chose que le refoulement psychologique d’un obstacle réel que l’on ne parvient pas à déplacer autrement, c’est-à-dire l’obstacle du conflit de classe duquel, au moins jusqu’à aujourd’hui, les exploiteurs sortent vainqueurs ? La question n’est pas négligeable. L’histoire a souvent connu des vagues successives d’enthousiasmes révolutionnaires et de reflux. Cœurderoy vit le reflux qui suivit l’enthousiasme de 1848, et il le vit jusqu’au bout, jusqu’au suicide. Il le vit en se posant cette question déchirante : le sacrifice de soi-même est-il légitime ? Est-il légitime de pousser l’action largement au-delà du niveau réel du conflit de classe, même si l’on est seul, à tel point que l’on est contraint de conclure le défi à un niveau personnel, dans la seule conclusion possible, à savoir le suicide ?
Il est clair que toutes ces questions comptent ouvrir la réflexion sur un sujet, et non pas suggérer des réponses forcées, dans un sens ou dans l’autre. Au moment présent du conflit, il serait trop facile de fournir des réponses préétablies qui, même si elles étaient justes, n’aideraient en rien à sortir du dilemme : la vie vaut-elle ou non la peine d’être vécue ? Le révolutionnaire conscient, qui lutte pour la libération, le révolutionnaire anarchiste, ne crie jamais « vive la mort ». Il sait parfaitement que la première valeur est la vie, la vie pour tous, et aussi pour lui-même, la vie véritablement vécue. Et il sait aussi que la lutte est menée pour la vivre cette vie, et pour abolir ces simulacres de vie qui ne sont rien d’autre que la mort. « Et l’Homme affranchi, le Dieu futur, sera beau, robuste, intelligent, bon et heureux. Il n’aura plus d’intérêt à faire le mal, plus de préjugés, plus de craintes paralysantes ; il développera, dans leur plénitude, ses facultés et ses passions sublimes, il rayonnera par l’activité de sa force et l’essor de son génie sur la nature vaincue. Et privé de sa clef de voûte céleste, le noir édifice de l’esclavage tombera. Et de sa chute retentira l’Enfer ».
Mais pour l’heure, la lutte au couteau continue. Le pouvoir est en sécurité sur ses bases, les patrons s’engraissent, les exploités supportent le poids de la répression. La lutte, dans ces conditions, est une lutte terrible, qui entraîne la violence, l’unique instrument avec lequel on peut tenter de freiner le pouvoir extrême de la répression. L’usage même de la violence est déjà quelque chose que le révolutionnaire accomplit à contrecœur. Au fond, cela ne plaît à aucun d’entre nous d’être contraints de tirer sur des criminels en toges, sur des journalistes au service des patrons, sur les patrons eux-mêmes, et d’être contraints d’attaquer et de détruire ces richesses produites par les travailleurs qui, d’un autre point de vue, pourraient être distribuées à ces derniers. Il est clair que tout cela laisse un goût amer. Entre ce sentiment initial, et la nécessité que nous sentons insister à l’intérieur de nous, celle de transférer sur les autres notre insatisfaction, il n’y a qu’un pas. Alors, nous devenons inflexibles avec nous-mêmes et avec nos compagnons. Nous amalgamons, sous la même loi de la faute et de la condamnation, les exploités et les exploiteurs. Nous insistons afin que nos organisations, chargées de mettre en pratique la justice prolétarienne, se renforcent militairement pour être en mesure de réaliser les objectifs qu’elles suivent. Nous perdons de vue les dangers que tout cela comporte, les conséquences qu’imprudemment seulement nous considérons marginales. Petit à petit, nous nous transformons en robots, nous écrasons notre humanité, notre caractère problématique, nous prenons notre courage à deux mains, nous éteignons le dégoût en nous. Plus tôt nous faisons cela, plus nous nous trouvons bons. Plus tôt nos compagnons font la même chose, plus nous les trouvons bons et efficaces. Tout cela a une trop forte odeur de cimetière. « Rien n’est plus dangereux que la ruse chronique. En révolution, les plus habiles diplomates reçoivent des leçons des ouvriers ; en duel, les plus brillants tireurs se font tuer par des apprentis. N’aiguisez pas la lame du stylet, n’élevez pas de loups, ne caressez pas d’aspics, ne plongez pas la main dans le feu ; ne jouez pas à la police avec les mouchards ».
Le jeu alterné de la vengeance et du guide est un jeu dangereux. La vengeance est une route droite, facile à accomplir : elle n’a qu’un seul défaut. Au bout de la route, nous trouvons toujours une indication obligatoire : le vengeur s’est transformé en un nouveau tyran. Maintenant il prétend être récompensé pour les sacrifices effectués et pour les résultats atteints. Il ne tolère aucune discussion. Quand notre vie coûte peu, cela a finalement peu d’importance si au bout de la course radieuse et vengeresse nous trouvons l’obstacle du vengeur transformé en guide permanent. Dans le vide imposé par les lois du capitalisme, nous sommes habitués à vivre au jour le jour, nous sommes donc déjà contents de la course, les résultats finaux passent en second plan. Mais nous ne pouvons pas continuer ainsi. La logique rigide de la révolution finit par nous transformer en robots, révolutionnaires mais toujours robots. La fuite de l’aliénation se conclut dans le règne d’une nouvelle aliénation. « Quand mon présent est sec et vide comme l’enveloppe d’une noisette dévorée par l’insecte térébrant, y demeurerai-je, moi ? Quand je ne trouve plus dans mon passé que des souvenirs de douleur, quand l’avenir m’apparaît sous le voile de la nuit, me résignerai-je à ne jamais les découvrir d’un autre point de vue ? Non. Car si je reste ainsi, j’ai la certitude d’être malheureux, inutile, à charge à moi-même et aux autres. Car le mal détruira mes facultés. Je languirai, je mourrai tous les jours sans jamais être mort ».
L’inutilité de l’existence que le capital nous impose alimente les légions de la vengeance, tout autant et peut-être plus que la pénurie et la misère. Que faire alors ? Il est impossible de dénoncer clairement l’équivoque qui se cache derrière la vengeance, l’unilatéralité de ce sentiment, les dangers de la froide rationalité qui l’anime. Dénoncer cela est impossible, parce que les masses opprimées éprouvant le besoin, la nécessité impérieuse de se venger n’accepteraient aucun doute à ce propos ; elles considéreraient comme contre-révolutionnaires tous ceux qui porteraient ces doutes publiquement. Les résidus religieux qui persistent chez les exploités rendent possible l’instrumentalisation du sentiment de la vengeance de la part de n’importe quel démagogue de bas étage. Les autoritaires et leurs théories n’auraient aucun espace dans ce résidu religieux. Il n’est pas important de préciser que l’origine de ce sentiment de vengeance est à chercher dans l’exploitation même, et qu’elle se révélerait donc légitimée. Ce n’est pas la vengeance en soi qui nous préoccupe, ce n’est pas l’assassinat des patrons et des flics de tout horizon qui nous inquiète. Qu’ils meurent une bonne fois pour toutes, qu’ils paient le prix de leurs crimes ; ce qui nous préoccupe c’est le caractère instrumental de ce sentiment, et la difficulté objective d’en dénoncer les dangers sans courir le risque d’être mal compris. [C’est sur d’autres bases qu’il faudrait reprendre le discours sur la vengeance. Une fois les dimensions du calcul récupérateur rompues, elle doit pouvoir s’ouvrir à l’excès, au dépassement de la limite d’équilibre, lié à la simple remise en place des choses.]
La révolution rationnelle, celle du doit et de l’avoir, celle de l’arithméticien, est vouée par avance à l’échec. Les comptables, après avoir compté les cadavres, en viendront à compter les propriétés et les richesses ; et ceux qui sont chargés de l’administration (des cadavres ou des richesses) savent comment faire augmenter, pour leurs profits, les uns et les autres. Le fanatisme et la méchanceté, l’un comme l’autre ignorants, se confinent pacifiquement. Comment sera-t-il possible de construire la société du futur, libre et juste, si nos attaques contre la situation présente, contre les responsables de l’exploitation actuelle, sont menées au nom d’une religiosité bornée empêchant de voir les limites et les possibilités objectives de ces mêmes attaques, grossissant, devant nos yeux, les résultats et les impasses de ces derniers ? Nous ne résolvons rien en nous autotrompant. Les communiqués qui revendiquent nos actions ressemblent à des communiqués de guerre, ils ont l’odeur des sentences des tribunaux. Quand nous mettons fin à la vie d’une charogne de patron, de flic, de juge ou de politicien, nous nous sentons investis du rôle de bourreau. Qui sait si l’abject frisson que doit quand même sentir le massacreur autorisé du gouvernement ne nous parcourt pas le dos. Je me le demande. Quand nous exécutons une de ces charognes, sommes-nous personnellement et directement convaincus de ce que nous faisons ? Ou bien nous éliminons notre geste avec le mythe de l’organisation ? Ou alors nous l’attribuons, dans son ensemble, à la « révolution », en chargeant cet être abstrait de la responsabilité de notre décision ? Et, en agissant de cette manière, ne faisons-nous pas la même chose – bien que pour des raisons opposées – que ce que fait le bourreau quand il se croit autorisé à tuer le condamné à mort pour la simple raison qu’un juge imbécile en a donné l’ordre ?
Si c’est cela la révolution, nous sommes devant une équivoque. La rationalité réside seulement dans l’organisation, dans le résidu de religiosité des attitudes de la masse, dans la délégation de ma vie. Non. Cela n’est pas autre chose qu’une fantaisie religieuse, transformée en pseudo-rationalité. Nous ne nous apercevons pas que, de cette manière, nous mimons les attitudes du pouvoir, ses tribunaux, ses déclarations de guerre, ses proclamations, ses exécutions, sa religiosité, sa rationalité. Il faut donc se battre pour une révolution illogique.
Il faut expliquer, clarifier, faire tous les efforts possibles pour que les équivoques s’effondrent. Il faut parler et d’agir de manière claire. Il faut que les exploités comprennent que les longues souffrances, les morts sur les trottoirs et sur les lieux de travail, la violence séculaire exercée par les patrons, l’esclavage des usines et des campagnes, et, pour finir, la terreur de la criminalisation, des ghettos, du chômage, de la faim ; tout cela constitue le fondement moral, l’autorisation à hériter du monde. Les bourgeois ont perdu toute possibilité de survivre en tant que tels. La société est en train de changer. Mais il faut tout faire pour que leurs principes – ultime poison – ne pénètrent pas dans la nouvelle société, comme une ultime revanche.
La nôtre n’est donc pas une vengeance, mais un acte de justice. Pas un acte typique des patrons, qui est toujours vengeance, mais un acte de justice prolétarienne. Les charognes qui tombent sous le feu prolétaire, le flic, le juge, le journaliste, le politicien, ne tombent pas parce qu’ils doivent « payer » pour ce qu’ils ont fait, ils ne tombent pas parce que nous les avons inscrits dans le carnet de comptes. Ils tombent parce qu’ils constituent objectivement un obstacle sur la route vers la libération définitive. Quand nous faisons feu sur eux, quand nous attaquons les sources de la richesse bourgeoise, nous ne comptons pas donner corps aux instincts religieux qu’il reste dans la masse. Cela, c’est la préoccupation du parti communiste, nourrissant le charisme. Nous, nous voulons seulement faire un pas vers la libération. Ainsi, quand nous réalisons une action du genre, quand nous participons à une action de masse de type insurrectionnelle (par exemple, une expropriation prolétarienne), nous ne cherchons à « venger » personne. C’est une théorie étrange, et une manière de faire plus étrange encore, que de mettre au premier rang les noms des camarades tombés. Comme si les prolétaires avaient besoin de justifier avec la présence de leurs martyrs l’action qu’ils accomplissent. Les camarades tombés sont dans nos cœurs, ils nous indiquent le chemin, mais nous ne pouvons pas les inscrire dans la comptabilité, ils ne constituent pas notre crédit, utilisable quand nous le souhaitons. Nous devons refuser d’utiliser nos morts pour solliciter les instincts religieux dans la masse. Même si cela peut sembler la voie la plus courte et la plus simple, la voie la plus efficace pour pousser les exploités à la révolte, c’est une voie qui mène directement au danger du leader et du charisme. Il n’est pas nécessaire de tenir compte de nos morts quand nous tirons sur le flic, sur le juge, sur l’homme politique. Si nous tirons, c’est parce que nous voulons avancer, parce que nous voulons libérer la société du futur des lacets qui l’emprisonnent dans un présent plein d’équivoques et de confusion.
Cela vaut aussi pour nous-mêmes. Même pour les décisions que nous prenons concernant ce que nous voulons faire de nous-mêmes, de comment nous voulons disposer de notre personne. Le pouvoir nous offre perpétuellement un mode d’emploi de nous-mêmes. Dès que nous le refusons, nous dépassons un seuil qui nous amène à l’intérieur d’une dimension différente. Nous devons savoir, avec clarté, pourquoi nous sommes entrés dans cette nouvelle dimension, qui n’est pas la dimension de tous, qui n’est pas la même que celle de ceux qui passent la soirée devant la télévision, qui suivent passionnément les chroniques sportives et qui sont stupéfiés par l’augmentation de la violence, espérant dans leur for intérieur que l’État parvienne rapidement à jeter en prison ces perturbateurs de l’ordre, avant que quelqu’un ne vienne frapper à leurs portes, les perturbant alors qu’ils regardent la télévision. Pourquoi avons-nous fait ce pas ? Parce que nous devons venger quelqu’un ? Parce que les ouvriers meurent dans les usines et que les patrons s’enrichissent sur eux ? Aussi pour cela, mais pas seulement : nous n’étions pas bien dans cette autre dimension, parce que comme ça, ça ne nous va pas ; alors, cherchons à clarifier et à ne pas instrumentaliser un élément qui, s’il fait partie du problème, et est un des éléments les plus évidents, n’est cependant pas l’élément le plus important. Habituons-nous à la clarté. Ne cherchons pas le chemin du moindre effort. Les résultats immédiats et apparents ne sont pas toujours les plus durables.
Alors, si nous sommes responsables de nous-mêmes, si nous ne devons rapporter les décisions que nous avons prises et que nous prendrons qu’à notre conscience de révolutionnaires, pourquoi devrions-nous faire assumer la charge de nos actions à l’organisation ? Pourquoi, quand nous décidons de vivre différemment, nous seuls décidons, alors que, quand nous pressons sur la détente du fusil pour tuer une charogne d’exploiteur, c’est l’organisation qui nous dit de tirer ? Peut-être parce que l’organisation a toujours raison, ou au moins, a plus raison que l’individu ? Non, cela n’est pas convaincant.
« Je me suis engagé dans ma route, sachant où elle me conduirait ; mais je me suis dit : que traîner ma vie dans l’oisiveté de mon exil, c’était mourir chaque jour plus péniblement encore, et avec moins de courage. Donc, je marcherai sans crainte. Jusqu’aux ateliers où l’homme souffre, jusqu’aux repaires où la vierge se prostitue, jusqu’aux bagnes où l’on martyrise les pauvres enfants… j’irai. Je poursuivrai les gouvernements dans leur prestige, les partis dans leur hypocrisie, les privilégiés dans leur vol, les juges et les bourreaux dans leur crime légal, la famille dans sa prostitution, les nations dans leur isolement, les hommes dans leur servilité. Tant que ma voix pourra se faire entendre, j’oserai ; tant que mon énergie vivra, j’oserai ; tant que dureront mes forces, j’oserai toujours ».
C’est justement là qu’est le drame. Quand j’avance, poussée par ma décision, tout va bien, c’est moi qui décide et je suis conscient de décider. Quand les obstacles surgissent, quand je suis contraint de combattre la violence et le terrorisme de l’État avec les armes de la violence, chose qui répugne à tous, parce que tuer est une chose répugnante, j’ai alors besoin de quelque chose qui soutienne davantage ma décision, et je me protège derrière l’organisation, la religiosité, la vengeance, le mythe. Quand, face à moi-même, je prends la décision suprême, j’agis parce que c’est moi qui décide, mais en plus d’avoir besoin d’un alibi vis-à-vis des autres, j’en ai aussi besoin vis-à-vis de moi. Mon sacrifice ne peut pas apparaître comme le seul fruit de ma décision, il faut qu’il soit considéré comme un fait dont tous les autres sont responsables. Cela ne me suffit pas que ce soit un pas en avant vers la libération, j’ai aussi besoin que ça le soit pour les autres, pour l’organisation, pour l’opinion couramment répandue, au moins à l’intérieur de la dimension nouvelle dans laquelle je me retrouve. Quand je dispose de moi-même, je ne le fais pas parce que je veux accomplir une vengeance, même si cent mille ou cent millions de camarades reconnaissent le bien-fondé de cette vengeance. Je le fais parce que j’estime faire avancer la lutte pour la libération, celle qui doit faire un pas en avant. Je ne peux pas me sacrifier pour libérer les autres si ce sacrifice n’est pas, pour moi, une libération d’un état de souffrance qui était bien pire que le sacrifice même. « Pour me détourner du suicide, ne me dites pas que je suis chargé d’une mission, celle de vivre, et que je dois l’accomplir jusqu’au bout. Car charge veut dire peine, et devoir, esclavage. Car je ne fais que ce qui me plaît, à moins de force majeure ; et j’ai du moins pour consolation, dans cette vie, la certitude de pouvoir m’en débarrasser quand je le jugerai convenable. Puis je vous demanderais : qui donc avait mission de m’imposer cette mission-là ? À qui donc en ai-je reconnu le droit ? Quand et comment ? »
Mais il ne faut pas penser que, quand nous cherchons à fonder notre attitude sur le résidu de religiosité des exploités, quand devant eux nous agitons le drapeau rouge de la vengeance, quand nous montons sur l’estrade pour y faire nos discours enflammés, capables de secouer les masses ; il ne faut pas penser que nous le faisons seulement parce que nous sommes des agitateurs professionnels, parce que nous avons besoin de compter et d’évaluer la croissance quantitative de ceux qui considèrent nécessaire et inajournable de se battre pour détruire la domination des exploiteurs. C’est, à n’en pas douter, une des raisons. Mais il y en a une autre, pas moins importante. Nous avons besoin de baser notre opinion sur les autres, nous avons la nécessité de ne pas nous sentir seuls. Même si nous avons décidé de rentrer dans une dimension différente de celle imposée par le pouvoir, nous avons besoin que d’autres compagnons s’y trouvent. La présence des compagnons nous est indispensable, nous rend plus forts, plus convaincus, plus fermes dans nos décisions. Quels autres motifs auraient les réunions périodiques, les rencontres, les congrès, les débats publics, sinon celui de se voir, de parler ensemble, d’« être ensemble » ? Discuter des idées théoriques et prendre des décisions est souvent un motif vraiment secondaire, à côté de celui principal, qui est de se sentir unis et ensemble.
Et quand les masses sont aussi avec nous, la force que cette multitude nous insuffle est véritablement incroyable. Combien de concessions ne sommes-nous pas prêts à faire pour la sentir à nos côtés, ou bien pour nous sentir à l’intérieur d’elle, partie prenante d’un mouvement unitaire d’action, à l’intérieur d’une force collective en mouvement vers un objectif que nous voyons, confusément, comme libératoire. Souvent ces concessions sont graves, mais nous ne nous en apercevons pas, nous passons outre, attirés par la chaleur humaine, par le moment collectif, par la force des grandes manifestations de masse, par l’espoir que survienne soudain un saut qualitatif, une colossale prise de conscience de classe. Mais ces concessions pèsent, elles deviennent des chaînes, elles causent de graves conséquences. Nous l’avons vu en Espagne, nous pourrions le voir une fois encore à court terme. Nous n’y prêtons pas attention. Nous sommes même prêts à donner un petit coup de pouce au résidu de religiosité des masses, à supporter l’immersion des petits leaders, à laisser de l’espace à de pâles personnalismes. Nous espérons que tout s’arrangera, que l’union nous rendra forts, immunisés contre les dangers de la contagion. Nous ne nous rendons pas compte qu’il y a certaines maladies dont on ne guérit pas.
Bien sûr, c’est beau d’être entre compagnons, de se sentir partie prenante d’une affinité élective qui rassemble tous le monde dans un même panier, c’est si bon d’être dans une dimension si différente de celle à laquelle la gestion capitaliste nous a habitué, celle de l’un contre l’autre, de l’antagonisme. La solidarité et l’affection réciproque remplacent la concurrence impitoyable et nous font nous sentir bien, physiquement bien. Mais il ne faut pas oublier, même dans ces situations optimales, que nous devons avant tout être bien avec nous-mêmes, que si nous avons des doutes ou des hésitations, des approximations ou des compromis, ce n’est certainement pas la présence de compagnons qui les fera disparaître. Nous nous ferions une pieuse illusion. La fermeté de nos idées pourra se fortifier par la présence des compagnons, mais elle ne naîtra jamais de rien, sans aucun effort de notre part. Si nous ne sommes pas personnellement convaincus de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, nous finirons par nous faire entraîner par la situation, et c’est justement pour ça, que nous prétendons que l’ensemble des compagnons, cette collectivité dont émanait tant de force humaine du simple fait de se trouver ensemble, se transformera en un organisme officiel, en une organisation capable d’assumer ces responsabilités qu’en tant qu’individus, nous ne savons pas ou nous refusons d’assumer.
C’est précisément là que le pouvoir nous attend. Il sait attendre autant qu’il le faut pour nous prendre seuls, il sait agir pour nous isoler, il sait manigancer pour nous montrer sous un mauvais jour aux yeux des exploités, il sait nous dresser les uns contre les autres. Une fois isolés, il a le choix entre deux possibilités : nous criminaliser en nous enfermant en prison, ou nous discréditer en décrétant que nous sommes fous. Entre ces deux institutionnalisations totales, le pouvoir moderne a tendance à choisir la seconde. Les fous ne se rebellent pas : ils sont fous et c’est tout. Nous devons être préparés à la solitude, à l’isolement, à la folie. Si nos seules forces consistaient dans l’organisation, dans le fait de se sentir ensemble, alors, quand cela ne sera plus possible, le pouvoir nous détruira facilement.
Cœurderoy, qui manifeste tellement de force à diverses occasions, a des mots de peur et de consternation face à cette éventualité : « Fou ! Ce mot-là m’effraie ; je ne veux pas le devenir. Ah ! mille morts plutôt qu’une parole de pitié méprisante, plutôt que la dictature matérielle des médecins ou les divagations psychiques des savants ! Non, je ne laisserai pas mon âme à cette dissection torturante ! À vingt ans j’étais interne à la Salpêtrière, et j’y traitais des folles : on m’appelait philosophe. Aujourd’hui, si l’on me renfermait à Bicêtre, on m’appellerait fou. Travaillez donc dix ans de votre vie pour arriver à ce résultat ! »
Ces peurs sont aussi dans nos cœurs, et nous ne pouvons pas les exorciser en renvoyant la responsabilité de notre agir sur l’organisation, en nous déguisant avec le costume du vengeur. Le pouvoir nous frappe parce que nous voulons nous libérer et, pour cela, nous voulons le détruire en libérant toute l’humanité. Voilà le sens de la révolution qui, subvertissant les conditions de la rationalité ayant rendu possible l’exploitation, est une véritable révolution illogique.
Le principe de la révolution qui procède rythmiquement, scandée par les événements de la dialectique marxienne, a disparu de manière sanglante face à la réalité des faits. L’alliance avec Bismarck est née des concessions faites par les théoriciens marxistes aux délires de grandeur du parti social-démocrate allemand. Le stalinisme et les camps de travail sont sortis des perspectives de conquête du pouvoir de Lénine. Le peuple russe est passé du despotisme du tsar au despotisme des fonctionnaires du parti communiste. À chaque fois, l’ombre du socialisme n’est apparue que dans l’initiative du peuple, dans les luttes et dans les organisations spontanées des exploités. Mais elle a été immédiatement repoussée par des fonctionnaires et des hommes du pouvoir, acclamant la rationalité et la science, l’ordre et la dictature du prolétariat. Tant de choses ont été faites au nom des exploités ! Les anciens despotes tués au nom de Dieu et du Peuple, les despotes modernes, exerçant la dictature au nom du prolétariat, tuent en se cachant derrière le drapeau rouge. Chacun se déguise du mieux qu’il peut. Tout se déroule sous le signe de la rationalité, de l’efficacité et de la science.
Le vieux Marx avait amoureusement sollicité une idylle avec le vieux Bismarck, dans l’illusion que, par effet dialectique, on obtiendrait de la croissance de la bourgeoisie allemande la croissance du prolétariat allemand. Rien à faire. Les questions de la logique sont toujours liées à des choses quantitatives. Le pouvoir, qui s’y connaît en arithmétique, y met toujours les mains. Le renforcement de l’État est toujours un fait négatif pour les exploités, disait Bakounine. Cela semble une vérité si évidente qu’il n’y aurait presque pas besoin de la remettre en question. Mais les sophistes allemands, dignes disciples de l’auguste père Hegel, ne sont pas de cet avis. En 1872 Bakounine écrivait : « Il n’y a, à l’heure qu’il est, que deux forces capables de renverser ce monde corrompu de l’Occident politique et bourgeois. Ce sont les barbares du dehors, les Slaves peut-être, dirigés par les Russes, et suivant la voie que leur auront préparée et montrée les Allemands prussifiés ; ou bien les barbares de l’intérieur, le prolétariat. Si ce sont les barbares slaves, qui sont destinés à rendre ce dernier service au vieux monde de l’Europe, comme les barbares germains l’avaient rendu ; il y a quinze siècles, au monde Gréco-romain, il est certain que la civilisation humaine rétrogradera de quelques centaines d’années, au moins. Ce sera un fait naturel, comme le fut l’invasion conquérante des Germains, mais en même temps un immense malheur, pour les conquérants non moins que pour les peuples conquis.
Donc, dans l’intérêt de l’humanité, de la civilisation et de l’émancipation universelle, nous devons tendre tous nos efforts à ce que le renversement inévitable du monde politique et bourgeois soit accompli non par une invasion de Slaves, mais par le soulèvement du prolétariat, que la première qui ne peut manquer de se déverser sur l’Occident, si le second n’arrive pas ou arrive trop tard, soit prévenue par ce dernier. Autant cette œuvre de destruction, si elle était achevée par l’invasion des barbares du dehors serait funeste à l’humaine civilisation, autant elle lui sera salutaire quand elle sera accomplie par les barbares du dedans, par le prolétariat de l’Occident lui-même ». (Aux Compagnons de la Fédération des Sections internationales de Jura)
C’est à peu de chose près la théorie de Cœurderoy, que Bakounine n’a pas rencontré, mais dont il entendit sûrement parler par Herzen, qui était rentré en contact avec l’anarchiste français. La référence aux barbares est dans deux livres de Cœurderoy : De la Révolution dans l’Homme et dans la Société, qui date de 1852, et Hurrah !!! Ou La révolution par les Cosaques, de 1854. Mais le thème de la destruction de notre civilisation, que les barbares réaliseront, est prolongé dans les Jours d’Exil. « Je n’ai ni système, ni conclusions à présenter ; je ne le puis pas, je ne le veux pas : je ne veux rien. Et quand je voudrais établir quelque gouvernement de Lycurgue ou d’Icarie, ou quelque organisation du travail, — ce qui est bien facile, — je ne le pourrais pas. Voyez plutôt ce que sont devenus les magnifiques plans de réédification de MM. Owen, Étienne Cabet et Louis Blanc ! Il ne reste de Fourier que ses justes critiques, ses analogies universelles et ses grandes prédictions. C’est qu’il n’est qu’une chose au pouvoir de celui qui s’occupe de science sociale : marquer au crayon rouge tous les édifices qui doivent disparaître. L’homme est trop borné pour saisir l’ensemble des objets et des siècles qui concourent à la reconstruction des sociétés. L’humanité tout entière peut reconstruire, éternelle qu’elle est et maîtresse de son action dans tous les milieux ».
Et la science ? Le grand mythe de la rationalité qui régit la domination des puissants ? N’est-il pas facile de tomber dans l’équivoque, de construire la révolution sur le modèle de la raison dogmatique et omniprésente, ou dans celle de la raison dialectique qui peut tout absorber, y compris elle-même ? N’est-il pas facile de jeter la pierre à ceux qui n’acceptent pas les ordres « scientifiques », qui avancent des doutes et qui ont le courage de mettre en discussion les opinions des savants ?
« J’ai mordu, plein d’avidité, dans le fruit de la science, et je me suis brisé les dents. Les docteurs riront, eux qui dépouillent les fruits savoureux avec des couteaux de vermeil, et laissent les noyaux à leurs secrétaires ». « Homme, garde-toi de l’analyse. Le chagrin est au bout de tout examen trop approfondi de soi-même, comme la lie dans le fond de la liqueur pure. Ce vautour s’acharne à l’homme, il glace son ardeur et boit son sang ». « L’Avenir reniera la Science d’aujourd’hui ! — La Science sciante, pédante, énervante, paralysante, abrutissante ! La Science diplômée par le Privilège, jalouse de ses prérogatives, facile aux grands, dure aux petits ! La Science hydropique, pléthorique, titubante, livide, qui répand sur le monde le délirant bavardage, les ténèbres, la cécité, la cataracte, la myopie et le regard louche ! La Science qui s’enferme à double tour dans l’infect sanctuaire où elle empile cornues, chaînes, poisons, cadavres et malades ! La Vieille aux cheveux rares qui se traîne, honteuse, à la remorque de la jeune Découverte aux tresses parfumées ! L’ennuyeuse, l’entêtée, l’endormie qui radote ! L’ignorante, la superbe, qui cache son impuissance sous de longues phrases recueillies dans la défroque des Grecs ! L’Intrigante, l’avare, la voleuse, la fausse monnayeuse, l’usurière, la plagiaire, qui s’approprie les travaux de ses ennemis et les dénature en les traduisant dans son affreux grimoire ! L’antique, l’académique, la monastique, l’étique, l’universitaire, la solitaire, la mauvaise coucheuse, qui sépare sa cause de celle de l’humanité, qui spécialise, étiole, étrangle toutes les questions qu’elle touche en les séparant des grandes questions d’intérêt général ! La Science couarde qui ne manque jamais de donner le coup de pied de l’âne aux victimes abattues de l’injustice sociale ! »
Voilà les conditions du renversement, les conditions de la révolution. Si la science est celle des puissants, elle ne deviendra une science révolutionnaire qu’avec un autre usage et une méthode différente. Elle ne sera pas utile à la révolution, voire indispensable, parce que d’autres personnes l’utiliseront, mais elle le sera à condition que son organisation interne, sa raison d’être, ses perspectives et sa méthodologie soient profondément modifiées. Et c’est une tâche révolutionnaire qui ne pourra jamais venir des savants eux-mêmes, tous occupés à se disputer le fruit de la science qui, à l’heure actuelle, est fruit de pouvoir, capacité d’enrichissement, manière d’exploiter les faibles et ceux sans défense. Cette nouvelle méthodologie devra venir de l’extérieur. Ce sera – selon Cœurderoy – la méthodologie destructive des barbares, celle qui déchaînera la révolution contre la civilisation ayant bâti des cimetières à la place des villes.
C’est la même rationalité du monopole qui a rendu la femme esclave. La rationalité de la famille, premier fondement de l’exploitation. Nous ne pouvons pas faire de cette rationalité la base de la révolution. Le résultat serait épouvantable.
« L’avenir vous punira, vous les hommes, les tyrans qui avez fait cette loi si parfaitement à votre image : sans délicatesse, sans amour et sans justice ; qui l’avez rédigée tout en votre faveur : lâche, oppressive à la femme, infaillible, irrévocable, indiscutable, irrévisible ; insulte à la nature, opprobre à l’humanité ! — Vous ignorants, insensibles, qui par la voix de vos assemblées, de vos conciles, de vos prêtres et de vos discoureurs, avez osé déclarer que la femme, la divine femme, est d’une nature inférieure à la vôtre, d’argile plus grossière, d’essence moins éthérée ! — Vous brutes, qui cherchez à la convaincre qu’elle est mise au monde pour vous soigner avec zèle, vous servir avec obéissance, et vous frictionner avec amour, quand le cœur vous en dit ! — Vous ignobles, cupides, qui la vendez comme votre esclave ou votre domaine ! Vous lâches, qui l’enfermez, l’enchaînez, la déformez, la mutilez, la bâillonnez, l’annihilez, la répudiez, la souffletiez, la battez de mille coups, la lapidez de mille pierres, la torturez de mille tortures !… Vous sages, et savants, et sensés, et galants, et Frrrançais qui la tenez en tutelle à perpétuité ! »
Et la destruction de tout cela ne se fera qu’en renversant la base qui justifie et régit l’exploitation : cette rationalité codifiée par la science bourgeoise. La révolution sera profondément illogique pour la logique des patrons, alors qu’elle apparaîtra clairement logique pour la logique des exploités. La barbarie des destructeurs, de ceux qui héritent du monde, la barbarie de ceux qui ont construit le monde avec leur sueur pour le livrer dans les mains des patrons et qui, justement pour cette raison, peuvent le reconstruire à tout moment, mais sur des bases différentes ; cette barbarie sera le fondement de la nouvelle révolution, de la révolution définitive, de la révolution sociale.
« Révolutionnaires anarchistes, disons-le hautement : nous n’avons d’espoir que dans le déluge humain ; nous n’avons d’avenir que dans le chaos… Le Désordre, c’est le salut, c’est l’Ordre. Que craignez-vous du soulèvement de tous les peuples, du déchaînement de tous les instincts, du choc de toutes les doctrines ?… Est-il, en vérité, désordre plus épouvantable que celui qui vous réduit, vous et vos familles, à un paupérisme sans remède, à une mendicité sans fin ? Est-il confusion d’hommes, d’idées et de passions qui puisse vous être plus funeste que la morale, la science, les lois et les hiérarchies d’aujourd’hui ? Est-il guerre plus cruelle que celle de la concurrence où vous avancez sans armes ? Est-il mort plus atroce que celle par l’inanition qui vous est fatalement réservée ? » « Il n’y aura plus de Révolution tant que les Cosaques ne descendront pas !… Si vous me dites que ce sont des Cosaques, je vous répondrai que ce sont des hommes. Si vous me dites qu’ils sont ignorants, je vous répondrai qu’il vaut mieux ne rien savoir que d’être docteur ou victime des docteurs. Si vous me dites qu’ils sont courbés sous le Despotisme, je vous répondrai qu’ils ont besoin de se redresser. Si vous me dites qu’ils sont barbares, je vous répondrai qu’ils sont plus près que nous du socialisme […] ».
Voilà le sens le plus élevé de l’expérience de Cœurderoy. Dans le changement qui survient dans l’histoire, se niche un danger permanent ; dans la rationalité que le progrès développe, se cache un dangereux élément de pouvoir. Comment peut-on lutter pour le changement révolutionnaire en évitant la cristallisation de l’autorité ? Comment peut-on contrôler les dangers de la rationalité, poussée froidement jusqu’à ses conséquences extrêmes ? Voilà les grands problèmes de Cœurderoy, qui sont d’ailleurs les mêmes que ceux que la vie met devant nous tous les jours, et qui, d’après nos expériences révolutionnaires actuelles, sont décisives pour le sort de la libération.
I- MONTCHARMONT
« Malheur à l’infortunée victime lorsque
la bouche qui a fait la loi prononce
aussi la sentence. »
(Schiller. — Les Brigands.)
« Contre l’ennemi la revendication est
éternelle. »
(Loi des douze tables.)
La société française est plus barbare que la société juive ; la mort du juste la laisse froide ! Les tribunaux actuels sont plus souillés que le tribunal de Pilate ; ils ne se lavent pas les mains ! La croix du Rédempteur est transformée en guillotine ! Pleurez, vous qui avez encore des larmes dans les yeux !
Le chasseur Guillaume Tell mourut au xive siècle, entouré d’une auréole de gloire qui rayonne encore sur nos temps décolorés. Ce ne fut pas ton sort, à toi qui passas sur la terre à travers des générations flétries et qui perdis ta tête sur la machine infâme, héroïque chasseur, Montcharmont !
C’est un sacrilège, crieront-ils, de rapprocher l’ombre d’un meurtrier de celle d’un héros. Et moi, je confondrai ces deux ombres également glorieuses. Comme Tell, Montcharmont mourut pour défendre la Liberté ; comme Tell, il revendiqua seul, parce que tous les hommes qui l’entouraient étaient des lâches, parce que les autorités et les lois d’à présent sont conjurées contre le Droit.
Les balances de la Justice ne sont fausses que dans les prétoires. Devant l’éternelle Équité, les agents français qui interdirent à Montcharmont l’exercice de la chasse sont aussi criminels que l’agent autrichien qui voulut forcer Tell à se découvrir devant son chapeau : ils méritèrent aussi justement la mort. Dans les monts d’Helvétie, une révolution répondit au sifflement de la flèche de Tell ; dans les plaines de la France civi- lisée le coup de fusil tiré par Montcharmont n’éveilla pas d’écho. Voilà toute la différence entre ces deux hommes. Voilà pourquoi l’ombre du chasseur de Saône-et-Loire se traîne aux rivages sombres, chargée d’ignominie, tandis que celle du Libérateur plane brillante sur les générations.
Cynique sarcasme, infâme dérision que l’opinion des hommes ! majorité, violence, impudeur ! Le fait accompli sanctifie tout. Ils font des tragédies, des opéras en l’honneur du Dieu Tell qui, s’il eut échoué, serait un vagabond, un réprouvé !
C’était un réprouvé, un assassin, ce Montcharmont : voilà ce qu’ils répètent à l’envi comme des oies qu’on mène aux pâtures. Et moi qui ne suis autre chose au milieu de vous, moi que vous avez condamné comme criminel, vous voudriez me défendre de glorifier les grands criminels ? Puisque vous m’avez décrété de mort en me laissant la vie, pourquoi donc ne me plairais-je pas dans la société des morts ? pourquoi donc ne réclamerais-je pas la complicité de leurs actes ? Que me reste-t-il de plus qu’à eux ? Une tête, une main et une bouche de fer : je tâcherai de m’en servir.
La société française est plus barbare que la société juive ; la mort du juste la laisse froide ! Les tribunaux actuels sont plus souillés que le tribunal de Pilate ; ils ne se lavent pas les mains ! La croix du Rédempteur est transformée en guillotine ! Pleurez, vous qui avez encore des larmes dans les yeux !
***
Mémoire d’un homme fier ! pour te réhabiliter, pour le glorifier, nulle voix ne s’est encore élevée du sein de l’esclavage social. La mienne ne te fera point défaut. Je ne gémirai point, je ne lèverai point les bras au ciel, je n’emprunterai ni l’accent pleureur des avocats, ni le teint des femmes qui s’évanouissent, ni le voile de l’anonyme. Je ne chercherai pas à rendre le public pitoyable, à attendrir les magistrats, à impressionner cette figure de cire qu’on appelle l’empereur des Français ! Pathos, couardise, temps perdu que toutes ces lamentations de Jérémie ! Que les corbeaux du palais de justice, que les poètes élégiaques qui chantent les derniers jours des condamnés, hurlent sur ces motifs ! La foule, les juges et les rois sont des machines qui fonctionnent pour qu’on les graisse, et que l’on graisse pour qu’elles fonctionnent.
Tu ne te cachas pas derrière un buisson pour tuer ces deux chiens galonnés qu’un procureur du roi lançait à ta poursuite ; tu ne fus pas lâche comme lui qui, du fond de son cabinet, les excitait, les relevait du défaut, les remettait toujours sur tes traces, les malheureux ! et leur promettait ta tête pour curée. C’est ce chacal à cravate blanche qui vous a tués tous trois. On laisse cependant ces hyènes démuselées courir la société, on ne met pas ces gens-là en jugement ; on dit même en France que la magistrature est honorable ! Adorez des tigres et des jaguars, s’il vous faut des Dieux ; au moins ces bêtes-là sont gracieuses. Mais respecter un procureur général, un fournisseur des pompes funèbres, c’est dégradant !
Je resterai digne de toi, Montcharmont ! Haute et ferme sera ma parole, comme la détonation de ta carabine de combat. C’est ta glorification qu’il me faut ; c’est une accusation criminelle que j’intente à toute une société ; c’est une sentence de mort que je tiens suspendue sur sa tête, et qui s’exécutera tôt ou tard ; — plus tôt qu’on ne le pense. Cette solennelle déification de ton nom, je la fais contre tous les gens de justice, d’ordre, de gouvernement, de police, de corde, de rubans d’honneur et de potence ; je la fais contre la civilisation qui les paie ; je la fais contre tout ce qui condamne et exécute, contre tout ce qui laisse condamner et exécuter.
Ils jettent de la boue sanglante contre le bourreau et ses valets ; ils les appellent les hommes rouges, les buveurs de sang, M. Samson, M. Charlot, M. Mardi. Sur leur passage, ils vocifèrent des menaces de mort ; ils condamnent leurs fils à hériter de leur charge, leurs filles au célibat et leurs familles à l’ignominie. Eh ! qu’ils laissent donc le bourreau pour ce qu’il vaut, et qu’ils ne regardent pas de si près la poutre qui est sous ses pieds. Le bourreau fait son travail ; ceux qui l’insultent et le laissent faire sont plus lâches que lui, et leur pain ne leur coûte pas aussi cher à gagner !
Je le déclare nettement, je souhaiterais de bon cœur, que tous les civilisés fussent obligés de tirer tour à tour le cordon de M. Samson, et qu’il ne leur fût pas loisible de se racheter de cette corvée comme du service militaire. Je serais vraiment curieux de savoir si un seul oserait s’y refuser. Vous verriez qu’ils prétendraient qu’il n’y a pas de sot métier, et qu’ils sont des bourreaux très distingués. Je souligne cette expression, elle me réjouit dans un temps où toutes les intelligences se confondent dans le plus bas servilisme !
Tous ceux qui laissèrent mourir Montcharmont sont coupables au même titre que le bourreau. Lavez vos mains, esclaves, mieux que cela, encore mieux ; savonnez, frottez, usez, brûlez votre épiderme ; déchirez vos chairs avec un crucifix rouge ! La tache de sang est bon-teint, elle est vivace. elle revient et grandit ; elle vous aveugle, vous assourdit, vous étouffe et vous donne le délire ; vous la portez à votre boutonnière, dans vos parures, dans vos cheveux ; lèpre mortelle, elle va toujours s’élargissant, s’élargissant… Vous dégouttez le sang, vous faites horreur !
Je vous défends de toucher à ce mort. Depuis tantôt trois ans qu’il est couché sous la terre lourde, vous ne lui avez porté ni couronnes de lauriers, ni fleurs, ni larmes ; pas même une branche de cyprès ; vous n’avez pas consolé sa famille, vous l’avez laissé déchirer, lui, par les enfants, et la populace et les chats-huants du journalisme, comme un assassin vulgaire. On a couvert d’immondices l’herbe sous laquelle on suppose qu’il gît. Car vous ne savez pas même où l’ont enfoui les exécuteurs des hautes œuvres. Et quand, au jour de la justice éternelle, il se relèvera, vous refuserez de le reconnaître dans un tronc rogné qui portera par la bouche une tête sanglante !
Ô la plus bourgeoise, la plus odieuse, la plus misérablement poltronne de toutes les sociétés ! Si tu touchais à ce mort, tu le souillerais. Cette race-là parle de dévouement, de vaillance et de gloire ! Et elle a laissé dépecer, déchiqueter, hachetter par trois bourreaux le plus vaillant des hommes ! sacrifiez donc à ce monde-là vos travaux, vos veilles et votre existence : il ira se divertir à votre exécution… C’est monstrueusement hideux !… Bourgeois, vous êtes des meurt-de-faim, des mendiants ! !
Je veux partager cette infamie glorieuse. Aussi bien, cet assassinat juridique pèse à ma conscience. J’aurais pu me rendre en France le jour où il fut commis ; peut-être le désespoir m’eut bien inspiré ? Je m’accuse d’une faute sur la gravité de laquelle je n’avais pas réfléchi dans ce temps là. C’est un remords, une main glacée sur ma respiration ; je sens sur tout mon corps le sac humide dans lequel on enveloppe les exécutés. Je secouerai ce sac, j’en ferai jaillir sur tous les fronts la froide souillure ; j’agiterai le grelot des vengeances. J’opposerai tribunal à tribunal, homme à société, verdict à verdict. De même que Montcharmont s’est fait juge ; je me ferai procureur général. Ce sera peut-être la première fois qu’une magistrature terrestre ne mentira pas.
Justice des hommes, opinion bavarde ! que tu es tardive pour ceux qui devancent leur âge ! Puisque le scandale te fait hâter, j’enverrai à ta rencontre le Scandale au pas retentissant. Dans ce temps d’hypocrite douceur où l’on cache l’homicide à la barrière Saint-Jacques, la misère à l’hôpital et la maladie en prison ; dans un pareil temps, il faut déchirer, mordre, à toutes griffes et à toutes dents ; il faut lancer le pamphlet aux yeux et le crier dans les oreilles pour savoir enfin si l’on peut secouer cette interminable léthargie. — Heureux celui par qui le scandale arrive !
Je veux présenter aux rêves des civilisés cette tête mâchée par trois couperets, effrayante, pendant par un lambeau, cette tête qui se redresse sur la bascule. Les cheveux sont hérissés, les poings sont fermés, les yeux vous fixent et vous forcent à regarder. Montcharmont vous demande compte de sa vie qui ne vous appartenait pas. Moi je veux vous donner le frisson, bourgeois de France, je veux que vous pâlissiez, que vous maigrissiez, que vous ayiez des attaques de nerfs, que vous en mouriez.
La société française est plus barbare que la société juive ; la mort du juste la laisse froide ! les tribunaux actuels sont plus hideux que le tribunal de Pilate ; ils ne se lavent point les mains ! La croix du Rédempteur est transformée en guillotine ! Pleurez, vous qui avez encore des larmes dans les yeux !
***
Ce crâne à la main, je demande à la société et aux cannibales qui prétendent qu’ils la représentent :
Lorsqu’un homme n’a encouru aucune condamnation, où trouvez-vous dans vos codes un article qui vous autorise à lui refuser l’autorisation de chasser ? Je vous défie de me faire voir un pareil article.
Et si vous violez aussi impudemment la loi écrite au préjudice de cet homme, n’est-ce point lui qui défend votre misérable loi contre vous-mêmes lorsque, pour la faire respecter, il a recours à tous les moyens que légitime la justice, que conseille le désespoir, et que la nécessité fournit ?
Mais je ne m’occupe pas de vos lois ; vous les avez faites à votre image, iniques, oppressives. Je demande à votre autorité et à vos juges.
Lorsqu’un homme tient le droit de vivre de l’universelle puissance, et lorsqu’il lui convient d’exercer ce droit en chassant, quelle raison équitable pouvez-vous alléguer pour le priver de la chasse ? Si telle est sa passion dominante, vous le tuez tout aussi bien ainsi qu’en allant l’attendre au coin d’un bois pour l’assassiner.
Vous, société, qui punissez les assassins, pourquoi donc prétendez-vous à l’impunité lorsque vous vous rendez coupable d’assassinat ? Est-ce parce que la majorité, le pouvoir, la loi, les gendarmes, la prison et la guillotine, que vous avez faits, sont forts ? Mais force n’est pas droit, et demain la force peut tourner contre vous. Et si l’on substitue la violence à l’équité, il n’y a plus une tête solidement fixée sur le corps qui la supporte.
J’entends hurler en chœur que la chasse est un divertissement, que ce n’est pas un droit ; et qu’alors même que ce serait un droit, on ne passe pas pour l’exercer sur le corps de deux hommes revêtus d’une autorité publique. Ce sont les moins criminalistes qui s’expriment ainsi.
Je leur réponds : qu’il n’y a pas d’échelle d’importance pour les différents droits, que la valeur de chacun d’eux dépend des attractions de chacun de nous. Je leur réponds encore qu’il n’y a pas de droit contre le droit ; que le tricorne peut bien élever le gendarme au-dessus de la taille moyenne, mais qu’il ne le rend pas supérieur aux autres hommes ; et qu’enfin, quand un gendarme barre le chemin au droit, ledit gendarme doit s’attendre à être tué comme un chien, s’il trouve devant lui un homme libre.
Et puis, mes maîtres ! qui donc vous donne sur les champs, les eaux, les forêts et les animaux qui les peuplent, le monopole d’absolue jouissance ? Je vous dis, moi, que ce privilège est le plus irritant, le plus scandaleux, le plus féodal de tous ceux qui subsistent, et que, pour beaucoup d’hommes, et des plus fiers, le besoin qu’il foule aux pieds est le plus impérieux de tous. Si vous avez des cœurs de chiens de meute, et que vous vous contentiez de donner de la voix quand un valet d’écurie vous le permet, vous ne pouviez naître plus heureusement que parmi les civilisés.
Mais à nous, hommes libres, il faut l’air des collines, les futaies, les ravins et les clairières, quand l’idée nous en prend. Il faut les chevaux hennissants, les haut-pieds hurleurs, la musique des fanfares, le chevreuil bondissant, le dix-cors aux abois, le sanglier furieux. Nous ne faisons pas de rêves d’épiciers quand nous avons fatigué tout le jour ou nos jambes ou nos têtes.
Quand les révolutions éclatent, allez dans les royales forêts de Fontainebleau et de Compiègne. Là vous vous convaincrez que la chasse est chère aux âmes indépendantes, et que ceux qui la suivent avec le plus d’ardeur ne se bouchaient pas les oreilles quand la fusillade grondait à Paris. C’est bien dommage, en vérité, que des passions si nobles soient tombées aussi bas, et la vile mob n’aurait jamais dû oublier qu’il y a des existences d’animaux plus précieuses pour vous que des existences d’hommes ! Mais dites-moi, nobles de par le roi, croyez-vous que bonne race de loups ne vaille pas bonne race de chiens, et vous imaginez-vous, d’aventure, que vous ferez toujours sauter nos têtes ainsi que des bouchons de Champagne ? Nous sommes des chasseurs, des Jacques, des loups, entendez-le bien, et nous prétendons chasser ce que bon nous semble, même l’homme, surtout l’homme, quand bon nous semble, où bon nous semble, absolument comme vous. Au plus habile le butin. Nous sommes de ces hommes dont Schiller dit : « Leur mission c’est la loi du talion ; leur vocation, c’est la vengeance. » Nous sommes autant de brigands.
Je n’ai pas besoin de vous dire pourquoi le droit de chasse m’offre plus d’attrait qu’un autre ; il suffit qu’il découle de ma nature d’homme et de mes propensions actives pour que vous n’ayiez rien à dire quand il me convient de le faire valoir. Gardez-vous bien, voyez-vous, de supprimer les permis de chasse. S’il y avait encore un levain de révolte dans le sol de France, c’est ainsi que vous le feriez éclater. Ne savez-vous pas que rien n’est plus outrageant pour notre dignité qu’une défense, et faut-il vous apprendre que d’homme à homme toute défense est injuste — et inutile… Mais je deviens inintelligible pour des valets.
La société française est plus barbare que la société juive ; la mort du juste la laisse froide ! Les tribunaux actuels sont plus souillés que le tribunal de Pilate ; ils ne se lavent pas les mains ! La croix du Rédempteur est transformée en guillotine ! Pleurez, vous qui avez encore des larmes dans les yeux !
***
Ils disent qu’à travers les peuples et les âges, escortée par les philosophies et par les législations les plus sublimes, la peine de mort a tracé son sillon infléchi ; ils disent que l’universel consentement la justifie ; que la société doit sauvegarder la sécurité, la propriété, le travail et la vie de ses membres ; qu’elle a le droit et le devoir de se défendre quand elle est menacée ; et qu’enfin il n’est pas de moyen plus sûr d’empêcher les malfaiteurs de nuire que de les raccourcir de la tête. Les réquisitoires des procureurs du roi sont gonflés de ces éloquentes tirades, lieux communs attendrissants, élégies doucereuses, moralités de parquet, masques de vertu jetés sur l’horrible face d’assassins impunis, lâchetés de tradition, déclamations patelines qui font dresser les cheveux des honnêtes jurés. Et là dessus, les tribunaux mettent l’humanité en coupe réglée ; le sang leur monte au cerveau ; ils agitent leurs manches noires ; ils frappent du poing la tribune judiciaire ; ils divaguent, rugissent et étalent un cynique courage pour secouer la tête d’un homme sur ses épaules. Puis on attèle des chevaux noirs à une voiture de deuil, un homme rouge à une machine garance, et l’on encadre la tête du coupable dans un collier de fer qui la maintient sous le couperet. Ils appellent cela satisfaire la justice des hommes ! Justice bien calme, en vérité, que celle qui est toujours soûle de sang !
La société est souvent attaquée, c’est vrai. Mais vous êtes-vous jamais demandé si ceux qui l’attaquent sont coupables ? Vous qu’on paie pour faire des interrogatoires, comment donc ne découvrez-vous pas, avec votre perspicacité ordinaire, que cette société est le plus souvent provocatrice, qu’elle force la main à l’individu, et le pousse par les épaules dans l’abîme de l’infamie ? Vous qui cherchez les plus profondes racines du crime, comment ignorez-vous que l’ordre civilisé est un inextricable désordre ; comment peut-il vous échapper que beaucoup n’ont pas assez de pain, et beaucoup d’autres trop d’or ? Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que le Crime est entré dans le monde à la suite de la Faim et de l’Oisiveté ?
Ah! c’est qu’il n’y a pires sourds et pires aveugles que ceux qui ne veulent ni voir ni entendre ; c’est que vous êtes accusateurs, juges et parties dans votre cause ; c’est que vous êtes les plus cyniques de cette société de chiens ; c’est qu’elle vous met en avant pour défendre ses actes les plus lâches, les plus criminels !
***
On vous a appris, dans les écoles, que l’homme n’avait pas de droits, mais seulement des devoirs ; — que l’individu ne devait jamais avoir raison contre la société, ni la minorité contre la majorité ; — que la Liberté était un mot, et l’ordre, un dogme ; — que l’autorité était nécessaire pour maintenir l’ordre, et la violence et la peine de mort indispensables pour maintenir l’autorité. On vous a répété à satiété que le gouvernement était le boulevard de la société ; que force et raison doivent toujours rester au pouvoir. Vous croyez fermement que l’individu est dans tous les cas fautif, mauvais, impuissant, injuste, et que toujours la société est infaillible, bonne, toute-puissante et toute juste. D’où vous concluez que l’individu a toujours tort contre la société, et qu’il faut qu’il meure quand, justement ou injustement, la majorité à mille têtes réclame la sienne. Et vous ne sentez pas même combien est lâche cette majorité qui suce le sang d’un seul homme ! Vous êtes de la race de ceux qui condamnèrent Christ, Galilée, Jean Hus et Campanella, tous les plus grands noms dont l’humanité s’honore. Vous êtes de ces meurtriers impunis qui, appliquant des pénalités injustes et cruelles, forcent les oppositions à des revendications injustes et barbares aussi. Vous êtes les serviles exécuteurs de formules vieillies ; nous sommes les libres penseurs d’un monde nouveau. Nous nous appartenons ; vous êtes les instruments de vos maîtres.
Sinistres coupe-toujours, corbeaux blanchis en fouillant des cadavres, procureurs-généraux, pourvoyeurs de potence qui vous essuyez la main, et venez me la tendre, et croyez me faire honneur :… gardez cette main pour caresser vos femmes, et rapportez-leur sous vos ongles des lambeaux de chair de pendus. Vous me faites horreur, vous, vos femmes et vos filles, et tout ce qui subsiste du prix du sang !
*
Quand la maladie est dans l’homme, quand la guerre est dans la société, tous les organes sont dérangés et tous les partis coupables. Dès que nous avons perdu la notion de justice absolue, naturelle, que nous avons tous au fond de la conscience, tous nos actes ne peuvent être que des délits ou des crimes. Nos justices temporelles sont déviées ; elles oscillent de chaque côté de l’éternelle notion du vrai, tantôt au bénéfice d’un parti, tantôt au bénéfice de l’autre ; mais elles ne s’arrêtent jamais dans la ligne unique et inflexible. Elles ne peuvent que compenser l’iniquité par l’iniquité, l’assassinat par l’assassinat. De quelque pompe, de quelques solennités qu’elles s’entourent, elles ne font que de la vengeance. Elles sont irrévocablement engagées dans le labyrinthe de l’arbitraire où la passion les guide de forfaiture en forfaiture.
Alors tout devient doute, tâtonnement, délire d’assassinat, marche forcée dans le sang, angoisse, remords, fièvre, provocation, fureur. La santé et la justice sont perdues à jamais. Alors le malaise engendre le malaise ; le crime est père du crime, la vengeance allaite la vengeance, l’échafaud repousse de l’échafaud, le sang appelle le sang. Alors, ô malheur ! nous voyons l’humanité cheminer, le front bas, foulant sous ses pieds ivres des têtes coupées, sifflant et déclamant parce qu’elle a peur, parce qu’elle ne sait plus guère ce qu’elle fait, et qu’elle redoute de réfléchir et de rougir de honte !
Hélas ! l’histoire en deuil est une longue nomenclature des représailles que les hommes exercent les uns sur les autres ; elle redit d’une voix fatiguée les dispositions des codes contre les codes ; elle nous apprend que l’épouvantable malentendu ne cessera pas tant que les mots de justice et de liberté n’auront qu’une valeur relative, tant qu’il y aura des partis, et que ceux-ci élèveront au pouvoir des monstres tels que Caligula, Louis XI, Ezzelino, Fouquet, Fouquier-Tinville et Maximilien de Robespierre, la sèche momie des républicains de la veille.
L’histoire des sociétés n’est que l’histoire des luttes des majorités et des minorités. Ces deux partis sont nés jumeaux ; dès l’origine du monde nous les trouvons en face, puis ils se développent parallèlement à travers les temps et se reproduisent sans cesse l’un par l’autre, sans que nous puissions dire que l’un soit plutôt la cause que l’effet de son congénère. Gouvernement ou opposition, chacun d’eux a sa tradition à développer, son droit à faire valoir, ses vengeances à suivre. L’un tend de plus en plus vers l’autorité et l’esclavage ; l’autre se rapproche sans relâche de l’anarchie et de la liberté. À chaque légende, à chaque principe, à chaque vengeance que l’un proclame. L’autre répond par une autre légende, un autre principe, une autre vengeance. Si l’un répand une goutte de sang, l’autre la recouvre avec une autre goutte avant que la première ait eu le temps de sécher. Henri IV est tué par les jésuites, et les jésuites sont tués par la Révolution française ; — la Saint-Barthélémy est vengée par le protectorat de Cromwell ; — Louis XVIII venge Louis XVI ; — Washington et Bolivar vengent les Girondins et Marat ; — les sergents de 1848 vengent les sergents de La Rochelle. Comme les juges auraient peur de l’histoire, s’ils savaient la lire !
***
Vous avez tué Montcharmont parce qu’il avait tué vos gendarmes ; son crime a provoqué le vôtre, c’est vrai, mais il ne vous absout point. Car si nous suivons le jet de sang jusqu’à la blessure première, que trouverons-nous ? Votre main qui fait saigner la colère d’un homme en lui niant son droit. Avant ce déni de justice, tout se passait régulièrement entre Montcharmont et vous, et vous auriez pu vivre longtemps côte à côte. Mais dès que l’arbitraire est déchaîné, les conséquences les plus effroyables deviennent possibles. Le vol d’un morceau de pain mène à la prison ; la prison aux travaux forcés, et les travaux forcés à la guillotine. Voilà le programme de la marche funèbre : c’est l’échelle de Caïn qui descend à l’enfer !
Qu’arriverait-il maintenant, si un parent de Montcharmont lui ressemblait, et puis un autre, et puis un ami, et puis d’autres amis ? Où s’arrêterait la série des vendettas atroces que vous auriez suscitées entre la majorité sociale et la minorité qui voudrait venger l’homme retranché par vous ? En supposant cela cependant, je ne fais autre chose que retracer l’origine des gouvernements et des oppositions. Le premier prêtre fut Abel, le premier meurtrier Caïn. Mais pourquoi la postérité de Caïn fut-elle maudite dans son père ? pourquoi reste-t-elle esclave ? Qui fut l’agresseur ? Qui rompit l’alliance entre les hommes ? Voilà ce que vous ne voulez pas approfondir. Car si vous remontiez à la couche où reposait la Mort, vous verriez qu’elle a été éveillée par l’Injustice matinale, et que la première injustice jaillit de votre cerveau, cuirassée d’un triple code pénal.
Dans cette lente évolution du crime, la majorité s’est toujours montrée plus lâche, plus cruelle, plus hypocrite, plus agressive que la minorité. — Plus lâche, parce qu’elle n’expose jamais sa vie pour satisfaire sa vengeance : — plus cruelle, parce qu’elle tue par le tribunal, par la Grève, par le déshonneur, — trois fois : — plus hypocrite, parce qu’elle éternise cette mort et cet opprobre dans les familles, parce qu’à la faveur de la violence, elle fait peser sur tous une responsabilité qui ne revient qu’à elle : — plus agressive enfin, parce que la faiblesse et la peur peuvent seules retenir les hommes sur la pente des vengeances, et qu’on reconnaît difficilement ses faiblesses et ses craintes.
Nous en sommes tous là. Seule, la peur nous paralyse quand il s’agit de l’intérêt de nos personnes. Montcharmont au pouvoir eût fait plus hardiment et plus ouvertement que Louis Bonaparte ce que l’on nomme un Coup-d’État, car c’était ce qu’on appelle un homme d’action. Bien-heureusement pour sa mémoire, son courage fut employé dans une juste défense, et non pas dans une boucherie que rien n’avait provoquée, que rien ne motivait, qu’une ambition borgne. Mais c’est salir Montcharmont que de le comparer à l’homme de décembre. Sois honni, Louis-Napoléon ! Et puisque la France te supporte, que les Cosaques viennent bientôt traîner ton corps à La Villette. Car tout se classe mieux sous la terre que sur la terre, et la gangrène n’échappe point aux vers qui grouillent dans les charniers.
***
Je veux vous accorder, pègre judiciaire, que vous ayiez le droit de prononcer la peine de mort. Mais avant de faire tomber une tête, il vaut la peine qu’on y réfléchisse. Savez-vous ce qu’est la Vie, d’où elle vient, où elle retourne, qui la donne et qui la retire ? Savez-vous ce qu’est la Mort ? Savez-vous ce que souffrent, dans le passage de vie à trépas, la tête et le tronc que vous séparez ? Avez-vous compté les angoisses et les battements d’artères de l’homme attendu par l’échafaud ? Êtes-vous bien certains de définir justement le Crime et la Vertu ? N’avez-vous jamais décapité d’innocents ? L’ombre de Lesurques ne troubla-t-elle jamais vos fêtes ?
C’est quelque chose que la tête d’un homme. Cela médite, compare et juge, et travaille et invente ; cela contient une intelligence et une âme ; cela suppose une destinée, un avenir. Savez-vous ce que l’homm
