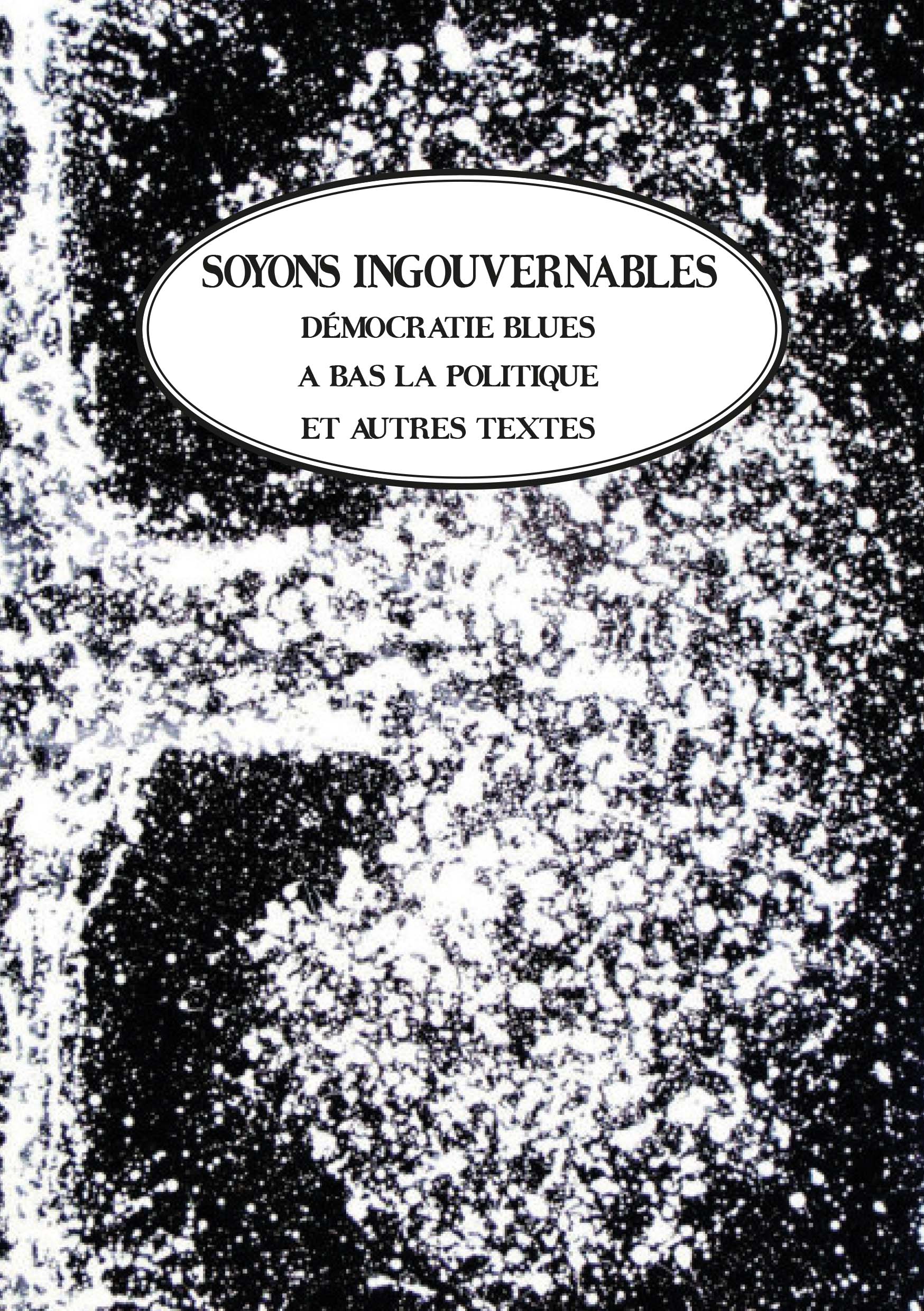 Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? Tout individu qui se sent en profond désaccord avec l’existant et s’y affronte en cherchant une vie loin de la misère quotidienne, devra probablement un jour se poser ces questions. Le constat que nous vivons une époque pauvre en analyses, que nos pensées s’enlisent dans un marécage de mots, s’impose alors rapidement. Des mots qui ne nous appartiennent plus, mais qui doivent être redéfinis à chaque fois : dans les communiqués de presse des instances gouvernementales, lors des conférences de spécialistes, dans les articles engagés de journalistes, dans les coups de pub des entreprises, lors des campagnes électorales de politiciens. Des mots qui sont tellement et partout utilisés que nous ne savons à peine plus ce qu’ils signifient. La guerre, c’est la paix ; le travail, c’est la vie ; avoir de l’argent, c’est avoir des possibilités de choix ; la catastrophe nucléaire, c’est l’avenir radieux ; le contrôle, c’est la liberté… Il s’agit de ne pas se retrouver enlisé dans ce raz-de-marée de mots. Nous devons nous réapproprier le sens des mots afin de pouvoir partager nos idées et nos actes avec d’autres individus enragés, avec d’autres indésirables. Des idées et des actes en conflit avec ce monde. Des idées et des actes qui parlent en fait d’eux-mêmes, mais donnent très souvent lieu à de la confusion. La multiplication des mots sans signification, l’expropriation des pensées, voilà une des principales tâches de la démocratie. Au marché capitaliste des produits, la démocratie ajoute celui des mots. Attaquer tout ce qui cherche à limiter ou à détruire notre désir de liberté signifie, en plus du conflit avec les rouages du capitalisme, un affrontement avec ceux de la démocratie.
Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? Tout individu qui se sent en profond désaccord avec l’existant et s’y affronte en cherchant une vie loin de la misère quotidienne, devra probablement un jour se poser ces questions. Le constat que nous vivons une époque pauvre en analyses, que nos pensées s’enlisent dans un marécage de mots, s’impose alors rapidement. Des mots qui ne nous appartiennent plus, mais qui doivent être redéfinis à chaque fois : dans les communiqués de presse des instances gouvernementales, lors des conférences de spécialistes, dans les articles engagés de journalistes, dans les coups de pub des entreprises, lors des campagnes électorales de politiciens. Des mots qui sont tellement et partout utilisés que nous ne savons à peine plus ce qu’ils signifient. La guerre, c’est la paix ; le travail, c’est la vie ; avoir de l’argent, c’est avoir des possibilités de choix ; la catastrophe nucléaire, c’est l’avenir radieux ; le contrôle, c’est la liberté… Il s’agit de ne pas se retrouver enlisé dans ce raz-de-marée de mots. Nous devons nous réapproprier le sens des mots afin de pouvoir partager nos idées et nos actes avec d’autres individus enragés, avec d’autres indésirables. Des idées et des actes en conflit avec ce monde. Des idées et des actes qui parlent en fait d’eux-mêmes, mais donnent très souvent lieu à de la confusion. La multiplication des mots sans signification, l’expropriation des pensées, voilà une des principales tâches de la démocratie. Au marché capitaliste des produits, la démocratie ajoute celui des mots. Attaquer tout ce qui cherche à limiter ou à détruire notre désir de liberté signifie, en plus du conflit avec les rouages du capitalisme, un affrontement avec ceux de la démocratie.
Pour télécharger la brochure: Soyons ingouvernables, Démocratie blues, A bas la politique, et autres textes A5 page-par-page
Ci-dessous, le texte de la brochure:
Soyons ingouvernables
Politique adj. et n. m. – 1361 ; lat. politicus adj., du gr. politikos « de la cité (polis) » 1. Art et pratique du gouvernement des sociétés humaines (Etat, nation). « La politique, art de tromper les hommes » (d’Alembert). « Quant à la politique ? […] – Ah ! c’est l’art de créer des faits, de dominer, en se jouant, les événements et les hommes » (Beaumarchais). « La politique consiste dans la volonté de conquête et de conservation du pouvoir » (Valéry).
Le Petit Robert, février 2001, p. 1929
La critique de la politique n’est pas chose aisée, tant règne en maître une confusion intéressée autour de ce mot. Au premier abord, on peut souvent entendre des lieux communs du genre « quoi, vous prônez donc l’apolitisme, le désintérêt et l’indifférence face à un monde pourtant pétri d’injustices ? », ou bien encore « mais si la politique ne vous plaît pas, présentez-vous donc aux élections pour la changer », avec parfois sa variante new look, « même en dehors des institutions actuelles, il est important de défendre le bien commun/les services publics/les droits de l’homme/les intérêts du peuple, etc. » Pourtant, qu’on la prenne par le haut, par le bas ou même en biais, la politique reste l’art de gouverner la société avec ses droits et ses devoirs, ses lois et ses normes, c’est-à-dire à la fois la science de la domination et ses différentes pratiques : répression et contrôle, récupération et médiation, intégration et séparation. C’est tout ce qui permet d’administrer une masse d’humains en l’enfermant dans un présent perpétuel au sein duquel les rapports directs et horizontaux entre individus sont réduits au strict minimum, ceux nécessaires au maintien de l’existant (y compris en tolérant au besoin des explosions sociales en guise de régulation collective). C’est tout ce qui prétend réduire les individus à une masse, les singularités à un ensemble, l’unicité de chacun et l’hétérogénéité qui s’en suit à du collectif et de l’uniformisation. A ce titre, aucun projet alternatif qui entend modifier le système actuel en continuant à se baser sur la masse –qu’elle se nomme par exemple peuple, communauté de croyants ou classe ouvrière- ne peut se passer de la politique, malgré ce que peuvent en dire tous leurs beaux programmes émancipateurs ? Même parés des oripeaux de la radicalité, ces projets seront inéluctablement confrontés à des mécanismes de gestion quantitative où la délégation se transformera rapidement en hiérarchie et en bureaucratie, où l’autorité redorera son blason grâce à une légitimité venue d’en bas, où le moins pire collectif s’érigera rapidement en mieux individuel, et où la vie même –cette exubérance qui échappe si facilement à tout calcul- redeviendra la cible privilégiée des nouveaux pouvoirs.
Pour gouverner, c’est-à-dire pour diriger le navire collectif (de cette étymologie perdure le mot gouvernail), il faut que chacun reste volontairement à bord, et sinon qu’il soit enrôlé de gré ou de force, par la grâce du chant des sirènes ou par le fouet du maître. Que ce navire soit ensuite de bois ou de fer, placé sous le commandement d’un seul, de quelques-uns ou de tous, divisé en compartiments séparés ou doté d’une vaste cabine commune change certainement les conditions du voyage, mais pas le fait que ce dernier soit organisé malgré nous. Sous le règne de la politique, la vie n’est plus une aventure passionnante qui pousse à s’abandonner sans contrepartie, mais une succession de non-choix dans une prison sociale aux barreaux plus ou moins palpables. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas pour rien que les capitaines de tous bords sont parvenus à faire croire à la plupart des passagers que leur traversée est désormais placée sous le signe de l’individualisme rampant, alors qu’elle se conjugue en réalité entre massification et atomisation.
A l’opposé de cette conception autoritaire de l’existence, l’anarchie n’est pas une idéologie politique, parce que c’est justement la possibilité d’une vie pleine débarrassée de toutes les séparations, dont celle entre la pensée et l’agir n’est pas des moindres, activités qui une fois morcelées à l’infini et cloisonnées dans des sphères isolées, peuvent justement devenir la proie de la politique. C’est une idée qui part de l’individu et de son unicité, de la réciprocité et de l’auto-organisation. C’est une tension où la liberté des uns étend celle des autres à l’infini, où les conflits comme les accords se règlent de manière directe, sans aucune médiation (morale ou étatique). C’est le « rêve non réalisé mais non pas irréalisable » comme le disait Déjacque, l’hypothèse d’un monde littéralement inimaginable parce que jamais encore vécu. Un monde sans gouvernement où personne ne commande parce que personne n’obéit.
Dans le « moins pire » des systèmes actuel, pourtant ravagé par le terrorisme d’Etat, la démocratie marchande et le totalitarisme technologique, la politique emprunte parfois des visages inattendus. Alors que son petit personnel traditionnel est toujours plus discrédité, elle se renouvelle bien sûr ici ou là sous forme de leaders populistes, mais elle assoit surtout son empreinte de l’autre côté de la barricade. Même en laissant de côté tous ceux qui sont animés par une « volonté de conquérir ou de conserver le pouvoir », on ne peut qu’être frappé par les mécanismes assembléaires qui jalonnent les luttes de ces dernières années, du CPE au mouvement des retraites, de Valognes au Val Susa, des Indignés à Notre-Dame-des-Landes. L’Etat et son exécutif, le Parti et son comité central, le syndicat et ses délégués, le collectif de lutte formel et ses porte-paroles peuvent facilement être identifiés et reconnus comme des parties qui prétendent représenter le tout. A l’inverse, on considère souvent l’assemblée, qui est (ou devrait être) l’espace commun ouvert à tous, comme la forme par excellence de la confrontation directe et horizontale qui garantirait la liberté de chacun.
Pourtant, même lorsqu’elle n’est pas décisionnelle (écrasant les dissidents du poids de sa majorité), même lorsqu’elle ne s’aligne pas sur un plus petit dénominateur commun nommé consensus (écrasant toute fantaisie et toute cohérence personnelle), elle demeure un des instruments privilégiés de la politique. Depuis la Grèce antique et ses joutes de tribuns qui produisaient une égalité de spectateurs au sein de l’agora, jusqu’aux formes contemporaines où les beaux parleurs les plus habiles livrent bataille épaulés par leur faction pour gagner l’hégémonie de l’assemblée, cette dernière n’est en effet souvent que le théâtre d’un mini-parlement où le dialogue et la confrontation sont mimés, où des idées opposées se transforment en simples opinions divergentes.
Dans une assemblée, il n’y a pas de réciprocité possible parce qu’il est impossible de discuter tous ensemble. Certes, on est assis ou debout côte à côte, certes on dresse l’oreille en même temps, attentivement ou pas, mais seul un petit nombre d’individus peut de fait y intervenir, tentant alors de vendre sa soupe (agora signifiait d’ailleurs à la fois place et marché) pour la faire passer comme la raison collective. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Comment peut-on discuter tous ensemble à plusieurs centaines ou milliers de personnes comme sur la place de la Catalogne à Barcelone, place Tahir au Caire, place Maïdan à Kiev ou encore en Val Susa ? Comment trouver de possibles complices dans un espace central régi par les mécanismes politiques de la délégation (de parole), de la représentation (d’idées) et du calcul (emporter le morceau) ?
Par contre, si dialoguer en masse de façon réciproque et donc sans médiation est impossible, cela n’empêche bien sûr pas d’imaginer des formes ponctuelles de coordination, c’est-à-dire des prises d’accords techniques élargies sur la base de propositions concrètes. Mais dans ce cas, cela suppose que les discussions ont pour leur part déjà été menées en dehors de l’assemblée, à des échelles plus réduites, multiples, riches et fluides, au sein d’espaces d’informalité qui laissent toute leur place aux jeux de compositions et de recompositions permanentes entre individus et groupes affinitaires. Si on souhaite pousser la critique de la politique jusqu’au bout, c’est-à-dire y compris dans nos manières de lutter, c’est notamment en expérimentant d’autres formes que les assemblées que nous pourrons à la fois trouver de nouveaux complices (le dialogue en réciprocité étant une des bases de la libre action) et utiliser des moyens anti-autoritaires cohérents avec nos fins. S’il est logique que ceux qui aiment l’odeur des troupeaux et que les aspirants bergers de tous poils privilégient des formes politiques en défendant des instruments comme les assemblées, l’auto-gestion ou la démocratie directe –réintroduisant par la fenêtre ce qu’ils prétendaient parfois chasser par la porte-, à nous de trouver d’autres formes d’auto-organisation (comme la proposition de nourrir des espaces d’informalité). Des formes qui puissent partir de l’idée de libres expérimentations et associations entre individus comme base de nouveaux rapports, rendant possible un bouleversement social complet.
Ce n’est qu’en abandonnant toute idée de centre ou de concentration qu’on pourra s’aventurer sur les chemins de la liberté. Et c’est de là aussi que part la proposition de l’attaque diffuse en groupes affinitaires, qui n’est pas un simple expédient tactique, mais une méthode de lutte qui laisse déjà entrevoir la vie pour laquelle nous nous battons, celle d’un monde différent, à travers une reprise en main de nos propres vies face à la dépossession généralisée.
Enfin, un dernier aspect que nous souhaiterions esquisser brièvement dans ce panorama incomplet –aspect qui se manifeste également ici ou là des deux côtés de la barricade-, est la question de la représentation, avec l’illusion entretenue par une partie du mouvement qu’il est possible de transmettre un contenu subversif à travers le spectacle de la politique. Vanités personnelles mises à part, comment expliquer autrement le fait qu’un critique radical de la démocratie aille présenter son ouvrage sur les ondes d’une radio d’Etat, ou que des groupes anarchistes qui mènent des attaques en règle contre la domination utilisent non seulement un sigle répétitif, mais envoient également parfois leurs communiqués aux porte-paroles du pouvoir ?
Le spectacle est pourtant l’exact inverse de la communication directe et de la recherche d’affinités. Non content de participer à la réification fragmentée de tout et de tous, de transformer les idées en opinions ou de s’ériger comme la médiation par excellence entre la vie et sa perception, il prétend en plus incarner l’ensemble de la réalité. Face à ce totalitarisme moderne, la tension vers l’autonomie et la volonté de briser les règles du jeu ne nous semble pas un aspect secondaire de la question révolutionnaire. La participation opportuniste à ces mécanismes –justifiée au nom de l’efficacité ou de la tactique- est non seulement contradictoire et dangereuse en tant que telle (parce qu’elle renforce leur légitimité), mais relève également d’une carotte théorique : la forme n’influerait pas sur le contenu, et il existerait des instruments plus ou moins neutres de la domination…
En réalité, seul le dialogue des révoltés entre eux dans un espace de lutte où les mots et leur sens ne sont pas mutilés par les besoins de contrôle et de consensus du pouvoir pourra dépasser la confusion organisée. C’est là, loin de toute représentation, que les idées sans maîtres ni propriétaires qui nous animent pourront alors enfin appartenir à tous ceux qui s’y reconnaissent.
Brutus
Démocratie Blues
« Le capitalisme moderne est sage. Il se sait plus prospère quand il fonctionne avec des institutions « démocratiques », qu’il envoie le peuple élire ses propres représentants sur les bancs des assemblées législatives et qu’il le fait même voter […]. Les dirigeants capitalistes ne se soucient ni du fonctionnement, ni du résultats des élections, peu leur importe […] qui l’emporte. Quelle différence à leurs yeux ? Quel que soit celui que tu éliras, il agira de toute façon en faveur de « l’ordre public », pour maintenir le système en l’état. Le principal souci des autorités en place est que le peuple continue de faire confiance au système existant et de le soutenir. »
Alexander Berkman
L’abstention n’est qu’un signe
De la télévision à la radio en passant par quelques journalistes tous azimuts, on s’est plu dans les mois précédant les dernières élections (présidentielles et législatives), à raconter encore que la « démocratie est malade ». Chaque tête de gondole politique et médiatique y est allée de son petit mot pour en expliquer les raisons et tenter de proposer son remède. Sa maladie, c’est son désaveux. Cette abstention qui « s’invite » et grandit. Le sermon du politicien, de concours avec le prof d’E.C.J.S et le présentateur télé pourrait se résumer à quelque chose comme « Votez ! Votez ! Il en sortira toujours quelque chose ». S’il y a une chose qui réconcilie tout le spectre politique, des plus gauchistes aux plus fascistes, c’est l’idée qu’il faudrait l’en « guérir » à tout prix. Mais pourquoi ferait-on une chose pareille ?
Tordons aussi le cou à cette « tradition libertaire » périmée qui consiste à présenter l’abstention (le simple fait de ne pas aller voter) comme le geste suprême de la négativité radicale en termes de démocratie et d’élections. Ne pas aller voter est une attitude aussi passive et résignée que d’aller voter, et n’exprime pas forcément une conviction ou même une réelle opinion. Et les « campagnes abstentionnistes » sont devenus un rituel qui, calquées sur l’agenda du pouvoir, ne ressemblent que trop à toutes les autres campagnes politiques. On devrait plutôt regarder la progression de l’abstention (notamment chez les plus pauvres… car la majorité ne vote pas) comme le signe d’un désintérêt général des exploités pour la mascarade démocratique, et une bonne occasion de s’en réjouir. Du reste, beaucoup de gens s’en vont voter sans grande conviction, avec le même désintérêt et le même vague à l’âme que l’abstentionniste qui guette les résultats avec un air désabusé. Le même mécanisme stérile qui envoie les foules voter pour n’importe quoi pourvu qu’elles votent produit le type d’humain de son époque : replié sur lui-même, ses faux intérêts et ses peurs absurdes, sans rêve et sans passion pour son monde, consommateur compulsif à crédit, exploité endetté et obsédé par une fausse identité de « classe moyenne » à laquelle il n’appartient même pas.
C’est de ce système là dont l’abstention est un signe.
Un signe qu’il ne fonctionne pas, ou de plus en plus mal.
Ni plus, ni moins. L’abstention est plus une conséquence qu’un geste premier. Elle n’est d’ailleurs pas le seul geste possible. De nombreuses façons de s’opposer aux élections en tant que système se sont manifestées depuis quelques années de manière récurrente et croissante ici comme ailleurs. Du graffiti à la graisse fondue dans les urnes ou d’autres sabotages en passant par les divers rassemblements anti-électoraux, voire des manifestations spontanées et départ de grèves sauvages et occupations de facultés ayant suivi l’élection de mai 2007, et de l’expression notoire du rejet du résultat des urnes. C’est d’ailleurs ce rejet en actes de la légitimité représentative qui a constitué pour la bourgeoisie et ses médias le plus insupportable scandale, bien plus que la simple abstention que certains défendent même comme un acte politique, sorte de droit de retrait envisagé de manière purement individuelle et isolée.
De là à une critique de la légitimité de tout système de représentation, il n’y a qu’un pas à franchir…
La grande messe, puis le pèlerinage…
Comme tous les cinq ans désormais, c’est reparti pour un tour. En attendant le suivant.
La grande mascarade démocratique s’est mise en branle à quelques jours des élections présidentielles. Des milliers de fidèles ont été pressés de s’amasser dans les offices, et de rentrer dans le confessionnal de l’isoloir pour en ressortir à destination de l’urne, autel sacré du grand rituel électoral. Mais il y a quelque chose de palpable. 2012 n’était ni 2002 ni 2007, et pourtant le même désintérêt y est palpable. La démocratie semble ne plus mobiliser autant qu’autrefois, ou plus de la même manière.
L’ambiance de crise que les socio-démocrates ont tant et aussi bien cultivée que les autres, et les révoltes et explosions collectives de rage -contre des conditions de vie toujours plus dégradées- de plus en plus fréquentes en Europe et dans le monde ces dernières années ne sont pas sans perturber le rituel fondamental du pouvoir. Révoltes en Grande Bretagne suite aux meurtres de la police, émeutes géantes et grèves générales suite au vote du plan d’austérité en Grèce, grève générale incendiaire en Espagne, et ainsi de suite depuis déjà quelques années. Et voilà qu’ici chez les plus libéraux, on accuse le sort et on critique les dérives de « la finance », rejoignant ainsi la rhétorique fascisante et populiste traditionnelle, et à gauche, on prétend se réinventer une identité révolutionnaire de bande dessinée avec rassemblements sur la place publique, drapeaux au vent, poings levés et incantations du « peuple ». On ne sait plus trop comment intégrer et récupérer la colère montante et le rejet même de la démocratie. Mais la farce ne prend pas ou peu. Comme d’habitude, nulle part la masse n’est appelée à se comporter autrement que comme une foule de suivistes en colère ou joyeuse, indignée ou enthousiaste mais toujours prête à adorer la première idole venue.
Comment penser une perspective anarchiste, ou même révolutionnaire sans se poser la question de savoir ce qu’est précisément ce système et quelles mécaniques il convoque, quels sentiments il mobilise, et quel sens il s’attribue ?
Qu’est-ce que la démocratie ?
A bien des égards, la démocratie est universellement considérée comme une idée politique sacrée. En fait, il n’est pas exagéré de dire que la démocratie est devenue une religion séculaire. Au delà de la seule révolution française, elle a son mythe originel : les grandes réformes de la Grèce antique qui instituèrent la communauté politique sur la base de la limitation de la propriété, en clair, la naissance d’une forme antique de « bourgeoisie » (même si le terme est anachronique), une classe urbaine aisée composée d’artisans et d’armateurs, intermédiaire à la noblesse et qui lui disputa son monopole dans la propriété, et qui n’était pas encore la classe dominante d’aujourd’hui mais portait déjà en germes la démocratie comme projet politique de domination de classe. Mais cette classe urbaine aisée de la Grèce antique reposait déjà sur le système de la propriété (auquel elle a accédé) et du travail forcé (l’esclavage) auquel elle échappait et duquel elle jouissait du fait de son statut. La démocratie moderne a aujourd’hui sa philosophie, quelques bibles, ses diverses interprétations, ses moments de communion, ses fêtes et ses idoles, ses démons, ses martyrs et même ses croisés. En effet, on part en guerre pour elle (« défendre la démocratie dans le monde »), on s’invente des diables pour la défendre (« le chaos et les terroristes menacent la démocratie ! »). On implore aveuglement sa participation (« peu importe pour qui tu votes, l’important, c’est de voter »). Plus généralement, la remettre en question est presque devenu un tabou. Quiconque critique les principes de la démocratie sera vite comparé à un nazi, ou à un islamiste (même lorsque de nombreux régimes fascistes, théologiques ou autoritaires ont été élus et continuent d’être défendus avec une rhétorique démocratique).
Et cette religion a aussi ses mythes. La démocratie, qui tend à devenir le système politique dominant dans le monde, se fissure partout et semble néanmoins toujours prêt à imploser sous ses contradictions. Le terme même indique par l’oxymore l’absurdité mensongère de sa proposition : comment le « peuple » (demos) peut il se « diriger lui-même » en s’administrant son propre pouvoir (kratia) ? La démocratie ne consiste pas à se « gouverner soi-même » de manière individuelle et collective (c’est à dire décider soi-même du sens de sa vie en libre association avec les autres individus) puisqu’une telle proposition exclut de fait le pouvoir et le principe de « souveraineté ». Elle consiste à déléguer la gestion des affaires « privées et publiques » (individuelles et collectives) au gouvernement, à ses élus, et donc à l’Etat et à ses lois et ses institutions, et conséquemment à justifier la nécessité de gérer un peu tout et rien. Gérer la délégation de pouvoir, de manière institutionnelle ou diffuse, dans la production, au travail, ou dans la vie quotidienne en général.
Cette délégation prend des formes multiples : la gestion des plus petites affaires publiques, la gestion de tous les conflits (par la police et la justice), le moindre « problème social » pris en charge par une administration (même si elle n’y résoudra rien), etc. Son objectif n’est d’ailleurs pas de « régler » les problèmes, mais simplement de les gérer, de les administrer, de les déplacer et conséquemment de créer une dépendance vis-à-vis des institutions démocratiques : en bref, légitimer le contrôle et légitimer l’institution. Les projets de loi et les réformes fonctionnent aussi souvent sur le mode de la « crise » à gérer. On invente, ou on saisit un prétexte tel qu’un fait divers ou une situation nationale ou internationale temporaire ou pérenne pour la transformer en « crise » qui doit être gérée. La « crise » du logement, la « crise » de l’immigration, la « crise » du système des retraites, la « crise » financière, etc…
La démocratie elle-même, en France plus qu’ailleurs sans doute, est le produit d’une contradiction historique dans le cours de la guerre des classes. La bourgeoisie, pour s’instaurer en classe dominante, et se sachant minoritaire, a instauré par la force (la Terreur) son Etat et a développé dans le cours de sa lutte pour défendre et justifier son existence un système qui la légitime. Quel meilleur système de domination en effet pour une minorité que celui qui propose que les élites dirigeantes de la nation soient « librement choisies », c’est-à-dire en invoquant l’assentiment et la participation du plus grand nombre. L’esclavage transformé en salariat (« librement consenti ») et la noblesse antique transformée en un système de domination de classe dont on vente le mythe si moderne de la « mobilité » (« Si tu es un pauvre, tu peux devenir riche ! A condition de travailler plus ! »). La encore plutôt que de prendre directement ce qu’il veut, le citoyen démocratique vend sa force et délègue son pouvoir dans l’espoir de gravir les échelons. La démocratie est par essence délégation de pouvoir (économique, social et politique) et le pouvoir est par essence contrôle. Voilà le postulat démocratique mis à nu : qui contrôle l’assentiment général détient déjà le pouvoir.
Dès lors, l’élaboration d’un tel système consiste à rendre plus acceptable, et plus « civilisé » ce principe finalement très basique en y insérant de l’institution, du constitutionnel, et la prétendue « séparation » des pouvoirs, etc.
L’adhésion et le mythe du consensus
Mais le principe de base ne varie pas pour autant, et sera défendu par la force à toute occasion. En réalité, il est même le principe politique qui justifie l’usage de la force partout dans le monde (rétablissement de l’ordre, ingérence « humanitaire » et « guerre préventive »). Ce principe repose aussi sur le mythe de la « volonté générale » souvent dénoncé comme « tyrannie de la majorité ». Ce mythe est savamment entretenu dans toutes les sphères de la société et au sein même des milieux contestataires. Cette fausse conscience repose sur l’idée que tous les « citoyens », voire même les êtres humains partagent les mêmes intérêts, les mêmes désirs et la même destinée. En réalité ce mythe de la volonté générale et des intérêts communs existe précisément pour invisibiliser les antagonismes de classes, les relations de pouvoir et la violence qu’elles impliquent et brider ainsi l’autonomie individuelle et collective. Et c’est dans ces frictions que le pouvoir tente de récupérer, par essence, le monopole de la gestion jusque dans les luttes, les décisions, les affects, les habitudes sociales, les identités qui prétendent s’y opposer pour les façonner à son image. Et c’est pourquoi il n’y a de perspective révolutionnaire dans la fuite, dans la transgression ou dans le simple fait de « s’abstenir » mais seulement des échappatoires existentielles (même lorsqu’elles peuvent être un signe ou une nécessité ponctuelle). Ce n’est pas par la « performance » ou en théorisant la « transcendance » qu’on menace la domination, c’est en s’y attaquant directement (sans spectacle, et sans médiations) qu’on ouvre les possibilités de la dépasser, et de la détruire.
Le refus purement individuel ou les transgressions (comme la remise en cause permanente de nos comportements) sont nécessaires, mais ne se suffisent pas. Parce que c’est la même logique qui nous ramène au moralisme de la consommation responsable ou du tri des déchets : celle de l’individualisation des problèmes sociaux. On ne s’oppose pas à une lapidation en prétendant seulement qu’on ne jette pas de pierre. La reproduction de la vie quotidienne n’est pas qu’une question de geste, de posture ou de libre association mais aussi de coercition, d’antagonisme et de rapport de force.
C’est là que la révolte prend tout son sens.
Le vote comme processus d’intégration
Le « votant » est par définition un individu perçu comme socialement intègre, voire même intégré.
Et ce n’est pas un hasard si les couches de la population qui votent le plus sont celles qui sont le plus intégrées par la société. Parmi lesquelles principalement les patrons, les propriétaires, les « entrepreneurs », les petits-bourgeois commerçants ou « créatifs », etc. La classe sociale reste déterminante dans le fait d’aller voter. La presse bourgeoise elle-même le reconnaît dans un article récent sobrement intitulé « qui sont les abstentionnistes ? » : le serpent de mer des élections, c’est l’abstention (déjà estimée à 32% cette fois-ci, soit le « parti majoritaire »). Et elle ne peut être expliquée en premier ressort que par des motivations de classe. Soit parce qu’ils ne sont pas dupes, soit parce qu’ils n’en ont rien à faire et n’y croient déjà plus, la majorité des pauvres ne votent pas, et la majorité des abstentionnistes sont des pauvres, majoritairement jeunes. Sociologues, politiciens et autres journalistes, devant l’évidence de cette réalité, se demandent encore et toujours comment « ramener les abstentionnistes dans le droit chemin ».
L’abstention est d’ailleurs décrite comme un phénomène passif (ce qu’elle est effectivement, la plupart du temps puisqu’elle s’y arrête), alors même que c’est cette démocratie si participative qui cultive sans relâche et avec une « sagesse » de curé, la passivité de ses sujets : rentrer dans un rang, choisir sa couleur, suivre les meetings dans le calme ou les ersatz de « débats » devant sa télé, et se traîner servilement en masse au bureau de vote le jour J. Accepter avec résignation le résultat qui ne satisfera qu’une minorité, comme règle du jeu auquel on a été prié de prendre part.
Pour autant donc, ne pas voter ne signifie pas s’opposer au pouvoir. Cela signifie simplement ne pas participer. Mais la « non-participation », ici comme ailleurs, ne peut se résumer qu’à la stratégie du colibri qui pisse sur un feu de forêt. Elle est symptomatique d’un antagonisme social plus général, mais simplement inconséquent parce qu’isolé et non assumé comme tel.
Matérialiser l’antagonisme, donner vie à ce refus, c’est assumer l’attaque, assumer l’antagonisme.
Tout comme une religion ne dépérit pas du simple fait que des croyants deviennent athées ou même de par la seule destruction de ses édifices, mais d’un mouvement grandissant contre son pouvoir et ses mécanismes, la démocratie n’est pas menacée par les abstentionnistes ou par le risque (assez faible) qu’une force inconnue ou minoritaire parvienne à saboter les élections. Elle est en revanche plus clairement menacée par le risque d’un embrasement général comme celui, avorté, qui s’est manifesté dans les journées enflammées suivant les élections de mai 2007. Toute l’erreur a consisté à attribuer le phénomène à la seule personnalité du chef de l’Etat nouvellement élu ou à sa politique. Il s’agit d’un rejet beaucoup plus profond qui implique, même de manière inconsciente, un sursaut de révolte et de rage vis-à-vis d’un système qui ne peut satisfaire les foules qu’il prétend « représenter » (comment un seul individu, ou même groupe en serait-il capable ?) devant une vie toujours de plus en plus dépossédée.
Démocratie, frontières et barbelés
Conformément à sa vision antique comme à celle de « l’utopie des lumières », la démocratie est conçue à la fois comme le meilleur des mondes possibles (qu’il serait inutile et absurde de remettre en cause) et comme un Eldorado à défendre contre vents et marées. Un « pays doré », un monde où tout est moins pire qu’ailleurs et qu’il faut protéger de « l’en dehors : les immigrés, les barbares, les terroristes, la dictature ». « T’es pas content ? Vas vivre en Corée du nord ! ». Concrètement, c’est de cette manière que ce système politique justifie ses clôtures, ses frontières mortelles et ses camps de concentrations pour immigrés, appelés par euphémisme du doux nom de « centres de rétention administrative » (ou autres variations). Aux quatre coins du petit pré carré démocratique européen, chaque année, des centaines d’êtres humains meurent noyés, de soif ou de faim, ou assassinés par la police en tentant de franchir l’impossible frontière. Les survivants sont souvent parqués par milliers dans des complexes pénitentiaires industriels de plus en plus obèses pour des durées de plus en plus longues pour simple délit d’existence. Avec la « citoyenneté » comme miroir de l‘in-humanité légale de tous ces harragas, tous ces réfugiés et sans-papiers, tous ces exilés du grand mensonge démocratique, là où encore une fois l’illusion de « l’Etat de droit » s’arrête. Comme dans toutes prisons spéciales. Comme à Guantanamo. Car tout Etat est policier par définition parce que tout pouvoir, toute coercition est un abus absolu.
Après la démocratie… le déluge ?
Malgré les récentes tentatives pseudo-contestataires du type Démocratie Réelle et autres Indignés pour le refonder, le mythe de la représentation est un petit théâtre qui a de plus en plus de mal à satisfaire son public, comme un commerce qui éprouve de plus en plus de mal à se maintenir dans la mesure où ses « consommateurs » ne se contentent plus vraiment d’aucun divertissement, ni d’aucune marchandise.
La critique de la démocratie doit aussi dépasser le seul rejet des élections et démontrer en quoi elle ne s’oppose pas fondamentalement à la dictature ou même à l’autorité. Elle use de mécanismes simplement moins coercitifs (plus persuasifs) pour obtenir des résultats similaires : passivité et consensus. Lorsqu’elle y échoue, tous les états d’urgence sont permis. C’est dans un cadre parfaitement démocratique que le parlement de la 3e république vote en juillet 40 les pleins pouvoirs à Pétain et à l’Etat français qui collaborera avec les nazis et participera à la déportation et à l’extermination. L’article 16 de la constitution de la cinquième république permet aussi de voter les pleins pouvoirs ou encore l’établissement de tribunaux exceptionnels : en bref la sortie du soi-disant « Etat de droit » est déjà parfaitement prévue par la loi.
La démocratie n’est malheureusement qu’un versant séduisant de l’autorité duquel on pourrait être tenté de s’inspirer. Le problème que cette « inspiration » pose est qu’il est simplement contradictoire de vouloir établir un modèle unique d’auto-organisation ou d’autogestion, et qu’il est simplement périlleux d’en établir un à partir d’un système politique qui tend à devenir le principal mode d’administration du pouvoir.
Les gauchistes de toutes les chapelles nous répètent à la nausée que le dépérissement de la « démocratie » est synonyme d’avènement du fascisme ou de la dictature alors que ce sont les cadres de cette société qui en préparent la militarisation sous une rhétorique plus que jamais démocratique, dans une optique de contre-révolution préventive de plus en plus assumée. Depuis cette perspective, défendre la démocratie signifie simplement stagner ou revenir en arrière. Et précisément, c’est ce que l’école, les médias et le discours du pouvoir en général nous assènent dès l’enfance : tout ce qui succédera à la démocratie sera nécessairement pire. Mais les Cassandre de la démocratie n’ont pas fini de déchanter, tant cette modernisation du mythe de l’apocalypse confine à la paralysie, et que ce mythe n’a que trop duré.
Face à la gauche, face à tous les pouvoirs :
Soyons ingouvernables !
A bas la politique !
« Il est dégoûtant pour le véritable humaniste ayant gardé quelque caractère, quelque honnêteté et quelque conscience au milieu de la corruption actuelle, de considérer le bourbier empoisonné de ce qu’on appelle la politique. Empli de répugnance et d’un mépris sans limite, il doit s’en détourner car la puanteur qui en remonte est trop grande, laissant deviner une pourriture réellement effrayante. Là, aucun rafistolage, aucune amélioration ne sert plus à rien. Le mal doit être complètement supprimé. »
Der Anarchist n°4, St-Louis, 1889
I
Dans la logique de la politique, les individus n’existent, je n’existe, que comme citoyens, comme sujets politiques. Mes décisions, je dois les remettre, les déléguer aux institutions et aux personnes qui établissent le cadre légal dans lequel ma vie a l’autorisation de se dérouler. Je dois pouvoir mener ma vie à l’intérieur de « mes quatre murs », mais je suis prié de payer pour ça, de travailler pour ça et de me faire exploiter. Si tel n’est pas le cas, je peux peut-être toucher des aides sociales, à condition d’être prêt à supporter patiemment l’humiliation des services administratifs. Si je trouve tout cela trop bête, alors je dois au moins rester tranquille, me laisser juger, laisser docilement les fonctionnaires de l’adaptation rentrer chez moi, et me satisfaire d’une existence misérable entre la pauvreté et la taule. C’est mon affaire privée et si cela ne me plaît pas, alors je peux rentrer dans une organisation politique quelconque qui représente « mes intérêts », « exprimer librement » mon opinion, lancer des pétitions ou manifester bien pacifiquement. Bref, j’ai le droit de participer à la politique, oui c’est même souhaitable. Je dois accepter cette logique qui rend impossible toute décision dépassant les limites du « privé » qui m’enferment entre « mes quatre murs ». Je dois accepter l’aliénation entre ma vie et le fait d’en décider, je dois accepter que toutes les choses importantes soient réglées par une structure institutionnalisée et légale et si je veux participer à cette structure, je dois reléguer mon individualité à un « sujet politique ». Si… oui, si… Mais je ne veux absolument pas. Ce que je veux se trouve à des années-lumière de la politique…
II
Je suis contre la politique, mais je ne cesserai pas de me mêler de ce qui nous concerne toutes et tous. Je refuse de ravaler ma rage et de me résigner à ne plus m’occuper de rien. Je veux au contraire m’approprier mon autonomie et attaquer cette réalité, afin de chasser la politique de notre vie à tous. Cela en trouve plus d’un qui pense « Si l’on s’occupe de ce qui se passe dans le monde, c’est qu’on s’intéresse à la politique et on est donc prié d’en faire ». C’est justement parce que je m’en préoccupe beaucoup que je sais que la politique est là pour reproduire la domination, que la manière de procéder politique ne cherche qu’à maintenir l’essentiel, l’ordre étatique. Et cette société, dont les yeux sont rivés sur le spectacle de la politique, est tellement prise dans ses nasses que la logique institutionnelle en est venue à empoisonner chaque relation. Le cirque politique appelé Parlement est un stratagème sournois qui fait preuve de ses effets dévastateurs depuis plus de 150 ans. Certes, le régime parlementaire a dans un premier temps certainement égratigné l’orgueil de quelques monarques, mais cela a été une immense victoire pour le perfectionnement de l’ordre étatique. Car beaucoup de gens qui refusent l’Etat tel qu’il existe, ne sont acceptés comme opposition qu’à condition de suivre les règles du jeu et finissent donc par imiter les politiciens et les parlements (en grand ou en petit). Ce faisant, ils n’hésitent pas à prétendre changer quelque chose. Pourtant, quoi qu’ils changent, ils reproduisent la délégation et l’institutionnalisation des rapports, ils reproduisent la foi dans les lois et le fait de demander la permission, bref la stupide obéissance du sujet soumis/du citoyen.
En effet, toute politique monopolise les décisions sur nos propres affaires dans une structure qui règne sur nos vies. Cette structure décisionnelle peut avoir une forme participative ou pas – de toutes manières ça ne change rien. Car le monopole décisionnel a pour effet que chaque décision autonome, chaque accord ne rentrant pas dans les définitions de la politique et se soustrayant aux institutions devient illégal. La politique s’immisce dans notre vie et croit pouvoir établir des règles et des lois obligatoires pour tout le monde. Peu importe ici si ces décisions sont « bonnes » ou « mauvaises » ou encore qui les prend. Que le maître saisisse un sucre d’orge ou un fouet, son intention reste sans aucun doute la même : nous lier à lui et nous soumettre.
III
C’est là qu’intervient la police. Car la politique ne peut rien sans ses soldats : la police. La proximité des deux mots (Police et Politique) en témoigne déjà. En effet, il faut empêcher les gens – que l’Etat aimerait voir comme ses sujets (citoyens) – de vivre tranquillement leur vie comme ils l’entendent. Ils doivent travailler, payer des impôts, faire le service militaire, respecter les lois etc… Les organes politiques, dont les parlements, ne seraient que de ridicules clubs de discussion que personne n’aurait de raison de prendre au sérieux si leur monopole décisionnel ne s’appuyait pas sur le monopole de la violence. Les citoyens s’enorgueillissent que cet appareil exécutif (flics, fonctionnaires et militaires) soit aujourd’hui séparé du législatif et du judiciaire (juges, scribouillards et autres bureaucrates). Il ne s’agit pourtant que d’une réforme ridicule, qui en cas d’urgence serait d’ailleurs immédiatement supprimée. Je ne vais pas répéter indéfiniment l’hypocrisie de cette séparation. La politique n’est pas séparable de son application, de la police comme de tous les services administratifs, institutions et bureaucrates qui perfectionnent les détails de sa mise en œuvre. Et l’ensemble de l’appareil d’Etat n’est pas séparable de la société capitaliste, de l’exploitation qu’il soutient, des bonzes qu’il protège. Le changement qui m’importe se dirige contre tout cela. Je veux mon autonomie individuelle, je veux décider moi-même de ma vie, tant que perdurent les institutions et que nous devons nous y conformer. Cela n’est pas possible tant que demeure le droit à la propriété selon lequel le monde appartient à quelques nababs, tant que nous nous laissons enfermer à l’intérieur de « nos quatre murs », tant que les individus délèguent leurs affaires et acceptent les limites qu’on leur pose, tant que le règne de la passivité n’est pas brisé !
IV
La politique est menée par tous ceux qui décident des affaires de l’Etat et de la société ou qui ont l’intention de parvenir aux positions nécessaires pour le faire. Tant qu’existeront ces postes-clef –les institutions-, elles nous déposséderont de nos vies. Grands et petits politiciens prendront toujours des décisions sur des choses qui ne les regardent pas –notre vie par exemple-, ou du moins tenteront de le faire. Et même si au quotidien nous n’avons généralement à faire qu’à l’exécutif, aux flics et leurs pendants, et guère aux politiciens –ce qui n’en rend leur prétention à nous représenter que plus ridicule encore-, nous ne devons pas oublier que les politiciens et autres décideurs et institutions, ont des noms et des adresses. En effet, ils prennent et appliquent des décisions, et si nous les laissons faire, ils trouveront toujours quelques idiots pour imposer l’autorité de leur politique, ou ils pourront toujours inventer une version réformée de la police, peut-être déguisée en travailleur social insignifiant. Bref, ils disposeront encore de leurs institutions, dans lesquelles ils pourront se (ré)former afin de consolider leur pouvoir. C’est pourquoi il ne suffit pas de chasser la police de notre vie et de continuer à vivre sans nous soucier des valeurs de la domination. Il nous faut aussi détruire toutes les institutions, même lorsqu’elles prennent l’apparence d’institutions révolutionnaires (ce qui n’existe pas). Je pense ainsi à quelque chose de plus qu’un simple désintérêt pour la politique : ce n’est pas du désintérêt, mais de l’inimitié que nous devons exprimer, une hostilité sans trêve, lorsque des gens arrivent en prétendant nous représenter. Toute représentation est un mensonge que nous ne pouvons réfuter qu’en transformant notre dégoût de la politique en actes.
A la lisière des mots – Pamphlet contre la démocratie
Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? Tout individu qui se sent en profond désaccord avec l’existant et s’y affronte en cherchant une vie loin de la misère quotidienne, devra probablement un jour se poser ces questions. Le constat que nous vivons une époque pauvre en analyses, que nos pensées s’enlisent dans un marécage de mots, s’impose alors rapidement. Des mots qui ne nous appartiennent plus, mais qui doivent être redéfinis à chaque fois : dans les communiqués de presse des instances gouvernementales, lors des conférences de spécialistes, dans les articles engagés de journalistes, dans les coups de pub des entreprises, lors des campagnes électorales de politiciens. Des mots qui sont tellement et partout utilisés que nous ne savons à peine plus ce qu’ils signifient. La guerre, c’est la paix ; le travail, c’est la vie ; avoir de l’argent, c’est avoir des possibilités de choix ; la catastrophe nucléaire, c’est l’avenir radieux ; le contrôle, c’est la liberté… Il s’agit de ne pas se retrouver enlisé dans ce raz-de-marée de mots. Nous devons nous réapproprier le sens des mots afin de pouvoir partager nos idées et nos actes avec d’autres individus enragés, avec d’autres indésirables. Des idées et des actes en conflit avec ce monde. Des idées et des actes qui parlent en fait d’eux-mêmes, mais donnent très souvent lieu à de la confusion. La multiplication des mots sans signification, l’expropriation des pensées, voilà une des principales tâches de la démocratie. Au marché capitaliste des produits, la démocratie ajoute celui des mots. Attaquer tout ce qui cherche à limiter ou à détruire notre désir de liberté signifie, en plus du conflit avec les rouages du capitalisme, un affrontement avec ceux de la démocratie.
Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? Pour la démocratie, pour le suffrage universel, certains sont morts sur les barricades, d’autres ont combattu tout au long de leur vie. Pour pouvoir déposer leur vote dans les urnes, ils ont entrepris de lutter. Etait-ce uniquement pour cela ? Ou était-ce pour avoir la possibilité de prendre en main leur vie, pour couper l’herbe sous le pied des puissants, pour diriger leur rage contre leur oppression et leur exploitation ? Et dans ce cas, le suffrage universel était-il non pas une victoire, mais une étape intermédiaire ou encore une concession faite afin de calmer les esprits ? C’était peut-être le premier pas, à moins que ce ne fut le dernier. Contrairement à ce que prétendent les historiens officiels, l’histoire n’a pas de narrateurs « objectifs », tout comme elle n’a pas d’acteurs « objectifs ». Ce que nous pouvons expérimenter nous-mêmes chaque jour, c’est que la démocratie est un cancer qui refoule le désir de liberté, de vie. Pour reprendre nos vies en main, il faut aussi que la démocratie soit criblée de nos flèches. On peut alors comprendre que par le passé, la démocratie a dompté les insurrections avec des solutions médiées, bien éloignées de la volonté de vie. Car aujourd’hui, sa fonction n’a guère changé. Tout cri de révolte est étouffé dans un bavardage démocratique. En fait, ce marché de mots est surtout un marché de mots facultatifs, sans engagement quelconque, où l’on préfère déléguer son action aux spécialistes de la politique, de la bureaucratie, ou de la charité… Si tu veux vivre le conflit avec l’existant à fond, cette société démocratique se trouve juste au coin de la rue.
La démocratie, c’est le règne de la moyenne. Elle s’est emparée des statistiques comme mécanisme de gestion. Les pensées sont jetées sur un grand tas et soumises à toutes sortes de formules jusqu’à ce qu’on puisse y appliquer des moyennes, des médianes, des fréquences par catégorie préconstruite et autres significations sans contenu. Invariablement, le résultat de cet oracle quantitatif, c’est la morale bourgeoise-citoyenne. C’est la moyenne et vu que la problématique part de là, les réponses ne la dépasseront jamais. On peut refaire les calculs des centaines de fois, le résultat restera toujours le même.
La démocratie est intrinsèquement raciste et sexiste. Elle sépare sur la base de ce que les prédicateurs de la morale désignent comme naturel ou de ce que les sociologues conceptualisent comme groupes sociaux. Dans les deux cas, les séparations semblent toujours aussi indépassables. De là, le besoin de représentants. Pas de contact direct, pas de conflit direct, mais la médiation à travers laquelle se font des compromis afin de partager convenablement le pouvoir, ou à travers laquelle la situation est polarisée afin que l’un puisse dominer l’autre. Dans cet ordre social xénophobe, de nombreux mouvements de libération sont tombés dans le piège démocratique. Ils ont repris les normes bourgeoises-citoyennes et se sont détachés des autres exclus.
La démocratie érige la moyenne en norme. Mieux, elle impose la moyenne à tout le monde. Chaque conflit est liquidé à l’aide d’additions. Les spécialistes (politiciens, sociologues, journalistes) réussissent miraculeusement à résumer toute idée en deux phrases. Et le peuple peut ensuite décider en levant la main. Ces faiseurs d’opinion ont parcouru le chemin le plus long et le plus fructueux à travers les institutions démocratiques et les établissements scolaires, ils sont donc les mieux placés pour reproduire à l’infini les cadres de la pensée dominante. Ce sont les meilleurs chiens de garde de la démocratie, ils en seront les derniers défenseurs. A l’indifférence du jeu politique, ils réagissent indignés. Aux attaques contre l’oppression, ils réagissent par le silence ou en produisant une avalanche de déclarations creuses – ce qui revient au même (sauf que dans le deuxième cas, la confusion peut aussi se répandre parmi les assaillants). Leur réaction est souvent sincère, ils n’arrivent effectivement pas à comprendre ce que signifie ou peut signifier une lutte pour la liberté. Ils sont formés pour gérer ce monde, pas pour le détruire.
Le plus beau au sein de la dictature de la démocratie, c’est que les minorités jouent le jeu sans broncher. Tous se dirigent sagement vers les urnes, choisissent le moins pire et constatent ensuite que la politique a peu à voir avec leur vie. Tout se passe comme si au moment de jeter les dés, tu vidais tes poches et quittais la salle par la porte de derrière. Tu connais les règles du jeu à l’avance, donc pas de mais, mais il se révèle que tu as de nouveau perdu. Vote et ferme ta gueule, c’est ça la démocratie ! La seule possibilité pour une minorité de changer quelque chose, c’est d’adhérer à la majorité et de ne rien changer. Voilà le sort des petits partis d’extrême-gauche. Les révolutionnaires autoproclamés, ceux qui rentrent dans le cadre de la démocratie, sont condamnés à porter le fardeau de rester minoritaires. La seule issue qu’il leur reste, c’est de devenir populistes et réalistes, de singer la majorité, de transformer la révolution en campagne électorale. La minorité, c’est le petit camarade de la majorité qui peut bien être moqué de temps en temps, qui doit faire les sales besognes, mais qui dans la même mesure, peut donner quelques bons conseils voire formuler quelques critiques. Et un jour !… s’il est devenu assez grand, lui aussi pourra monter sur le trône. Ce n’est que quand la minorité ne se reconnaît plus comme minorité et la majorité plus comme majorité que le jeu démocratique est mis en difficulté. Alors, il est temps d’édicter de nouvelles règles du jeu. Alors, on se met à intégrer en abondance et on voit surgir à gauche et à droite des figures d’alibi. Alors, il faut espérer qu’il n’y ait pas trop d’individus qui se jettent par-dessus bord en préférant le large plutôt que la claustrophobie du groupe social.
***
Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? Certains essayent de formuler des réponses en montant à la tribune de l’opinion publique. Ils font un usage servile des médias pour s’adresser aux gens. Mais au final, ils ne font que s’empêtrer dans un exercice de mots.
La question du rapport aux médias, et par conséquent à la masse/opinion publique, revient régulièrement. Hormis le fait que nous n’avons que peu de contrôle sur la façon dont les journalistes font passer le message et que nous ne voulons pas êtres des spindoctors ou des managers en communication, on devrait se poser la question de ce qu’on gagne dans le spectacle médiatique. Avec qui voulons-nous parler et de quelle manière ? Si nous communiquons par le biais des médias, on s’adresse à la masse passive qui regarde, lit et écoute. Il n’y a donc pas directement une accroche, une pensée, une pratique, un intérêt que l’on partagerait. Le discours se déroule sous forme de généralités, adressées aux gens possiblement intéressés (les « opprimés », la « gauche »,…). Il faut en même temps faire concurrence aux autres « opinions » qui s’adressent pareillement à la masse. Bref, on descend alors dans l’arène de l’opinion publique, où l’on se bat pour la sympathie de l’Autre. Mais qu’est-ce que l’opinion publique ? C’est une opinion débarrassée de toute contradiction, de toute irrationalité, de toute individualité… (ou du moins les cache-t-elle). Des opinions sont des thèses simples qui n’exigent que d’être pour ou contre. Ce sont des généralités, des clichés où il n’y a pas de place pour de véritables nuances, ni pour l’unicité de chaque individu avec ses propres idées, et pas non plus pour la solidarité, la combativité et l’autonomie, qui sont des choses uniquement compréhensibles quand on les expérimente soi-même. Des idées creuses, des opinions, doivent faire en sorte que la communication entre les êtres singuliers et la multitude se passe de manière univoque. Sondages, élections, débats publics… – pour la « masse », cela revient toujours à cocher la case qui convient, celle avec laquelle on est d’accord. Une opinion à soi ne consiste alors qu’en une liste d’affirmations qu’on partage ou non. De plus, avoir une opinion ne présume en rien d’agir selon elle. L’opinion publique sépare les mots des actes. Elle est le summum absolu de la liberté d’expression. On peut gueuler tout ce que l’on veut, à condition de n’y attacher aucune conséquence réelle. Par exemple, des manifestations autorisées où l’on peut entendre les slogans les plus radicaux contre les puissants, où l’on réduit l’action directe à du folklore ludique, où la police, en accord avec les organisateurs, est présente au cas où la moindre pierre volerait en direction des vitrines du capital. Ou mieux encore, on y préfère l’autocensure, c’est-à-dire avec ses propres vigiles pour veiller au grain.
L’opinion publique marche fondamentalement main dans la main avec la démocratie. C’est parce que les idées que les individus développent dans leur vie quotidienne sont réduites en « opinions », que la démocratie réussit tout de même à gérer et contrôler un très grand nombre d’entre eux, bien que leurs expériences et leurs sentiments soient très contradictoires. La fiction des gens ou de l’opinion publique est la nouvelle version démocratique du peuple ou de la nation, indissociablement liée à l’Etat. Et de façon aussi peu vraisemblable que l’existence d’un peuple, l’opinion publique est l’espace neutre où les idées de tous les individus sont (potentiellement) présentes. La vocation de l’opinion publique est de reproduire les cadres de la pensée dominante. Une lutte pour la liberté, une lutte pour prendre en main sa vie, est étrangère au domaine de l’opinion publique. Une telle lutte se déroule loin de ce spectacle.
***
Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? Pourquoi est-ce devenu aussi difficile ? Tout est déjà présent dans ce monde afin d’utiliser en abondance nos possibilités, afin que notre individualité s’épanouisse. On le nomme travail. Le travail est le paradis sur terre. C’est du moins ce qu’on voudrait nous faire croire. Mais il suffit, avec les poumons de quelqu’un qui a toujours respiré l’air des forêts, de s’arrêter près des tours en verre de n’importe quelle grande ville pour que sa cage thoracique se comprime. Ces containers sont remplis de bureaux et habités par des gens qui font la navette et entreprennent chaque jour des trajets infernaux afin de pouvoir passer quelques heures dans leur bulle d’air de lotissement (et s’ils ont de la chance, il ne fait pas encore nuit). Ils font crépiter les ordinateurs, ou nettoient toute la poussière humaine que produit une telle activité, ou sont postés à l’entrée pour interdire l’accès aux sans-badges ou… Ils se précipitent ensuite à la maison comme si quelques minutes de gagnées empêchaient que leurs familles et leurs amis ne leur deviennent étrangers. Voilà la réalité du travail. Des tâches répétitives, l’ennui, le stress, des conversations qui ne peuvent que reproduire des clichés car personne n’a ni l’énergie ni le temps de faire ou d’être plus.
Partout c’est pareil, dans les usines, les dépôts, les tours de bureaux, les magasins… Qui croit encore au travail de ses rêves dans lequel on pourrait donner libre cours à sa créativité, coucher sur le papier ses propres pensées, ou développer sa vie sociale ? C’est vrai, il y a la nouvelle élite du travail, eux ont le privilège de mettre en œuvre leur créativité, leur capacité analytique, leur maîtrise des langues. Ils ont le privilège de vendre toutes les caractéristiques qui appartiennent à leur individualité. Tout ce qui fait d’eux ce qu’ils sont, ils peuvent le mettre au service du capital et de l’Etat. Et ce sont aussi eux qui décident jusqu’où s’étendent leurs possibilités, où se situent leurs limites, à quel but ils serviront. Grâce à leur créativité, ils peuvent vendre encore plus de produits nuisibles. Grâce à leur capacité analytique, ils peuvent développer des théories qui seront transformées en mesures politiques encore plus oppressantes. Grâce à leur maîtrise des langues, ils peuvent construire encore plus de réseaux entre personnes qui ignorent toute base d’idées et de pratiques partagées, qui orientent la possibilité d’amitiés en la mettant au service de l’argent et du pouvoir.
On peut heureusement toujours aller tous ensemble le samedi au centre commercial (couvert ou non, en périphérie ou en centre-ville) pour faire nos propres choix personnels, sinon on pourrait commencer à croire que ce monde s’oppose à l’individualité. Produire et consommer, le cercle de la vie est fermé. On peut même choisir d’acheter des produits à un prix juste, avec donc un peu moins d’exploitation. A condition de se faire exploiter plus, car le commerce équitable, ça se paie évidemment. Des produits biologiques (ou macrobiotiques ou que sais-je encore…), durables, artisanaux, issus du commerce équitable… tout pour nous offrir une alternative. Une alternative capitaliste bien sûr, car échapper aux rapports oppressants n’est pas possible. C’est peut-être la raison principale pour laquelle cette alternative est tout sauf libératrice. C’est au contraire l’avant-garde capitaliste qui pénètre dans des territoires sauvages et recrute de nouveaux corps et esprits. Là où il y avait encore une certaine réticence face au jeu capitaliste, le capital a réussi à les faire monter sur le train du progrès avec une pirouette (ou, d’un autre point de vue analytique, par l’intermédiaire du spectacle).
Il en va de même pour les formes autogérées de la production qui remettent au labeur les rétifs. Une usine autogérée doit aussi vendre suffisamment pour pouvoir payer ses ouvriers. Et quand le marché offre moins d’argent en échange de ses produits, l’usine autogérée (ateliers, bureaux,…) doit économiser sur d’autres secteurs. Sans même encore se poser la question de quoi produire et pour qui. L’autogestion de la production à l’intérieur de la société actuelle ne fournit donc pas plus de liberté, elle transforme au contraire les individus concernés en gestionnaires de leur propre misère. La contradiction entre les intérêts des patrons et ceux des travailleurs se dissout partout (par l’alignement de la société avec le marché), et ainsi cette tendance atteint son apogée.
***
Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? Si on veut recueillir beaucoup d’adhésions, il faut exiger plus de démocratie, ou la vraie démocratie, ou mieux encore, la démocratie de base. On voit partout les têtes opiner. A cette nuance près que tout cela ne va pas de soi.
« Les gens sont inconscients », soulève l’activiste.
Ou peut-être le problème est-il est encore plus fondamental. « Ce n’est pas tout le monde qui veut sans cesse se préoccuper de la politique » pérore le philosophe.
D’expérience, le soldat du parti sait : « Il faut une grande organisation. »
« On doit d’abord répandre les valeurs de la société civile, créer le bon citoyen, » scande la partie progressiste de la société.
Rien n’est moins vrai. La démocratie de base est partout et elle rend le mécanisme de gestion plus efficace que jamais. Tout le monde peut en témoigner en allant voir une des nombreuses réunions de quartier qu’organisent les mairies quand elles s’apprêtent à démolir pour « revaloriser le quartier ». Les habitants sont alors en première ligne pour s’assurer que leur place de parking ne disparaîtra pas, qu’ils pourront toujours aussi facilement arriver en voiture jusqu’au pas de leur porte, que leur liberté (ou veulent-ils dire leur isolement ?) soit préservée. Tout le monde peut entrer en conflit avec cette démocratie de base quand un nouveau comité de quartier est créé pour lutter contre quelques jeunes qui se sont appropriés une partie de la rue et l’ont transformée en espace de rencontre à eux. Ou quand des citoyens s’organisent contre un skate-parc ou un terrain de jeu qui produit tout de même beaucoup de « nuisances ». La démocratie de base est bien vivante et forme la meilleure défense pour préserver son petit monde contre toute influence étrangère. Bref, le bon citoyen est partout et c’est le meilleur ami du flic.
Disant cela, nous n’avons pas l’intention de plaider pour la formation de groupes autoritaires. Mais soyons clairs, un mode d’organisation de cette société sous la forme d’une démocratie de base, n’est que la démocratisation du contrôle. Voilà pourquoi il est absurde de proposer, dans une perspective émancipatrice, la démocratie de base comme modèle de société et d’en faire le but de la lutte.
C’est aussi une remarque à propos de tous ces événements dont l’organisation est conçue à partir de l’idée de démocratie de base. Après coup, on peut se vanter que toutes les besognes pratiques et questions accessoires aient été résolues par des décisions collectives de dizaines ou de centaines de personnes. Mais les buts précis de l’événement au-delà de l’organisation, pour ne pas parler des possibilités d’une perspective de lutte, sont à peine discutés de façon critique, s’ils sont déjà présents.
***
Que faire avec ce monde ? Quels chemins emprunter face à cette société démocratique ? « On doit la protéger contre les hordes fascistes ! La lueur de liberté que nous avons obtenue est menacée, donc il faut s’unir aux autres démocrates et progressistes, contre les fascistes ! » A chaque fois quand des tendances fascistes émergent, s’ensuit l’appel au front unitaire. Un front des bons, sinon des moins pires. Tout d’un coup, toutes les forces « démocratiques » devraient s’unir contre le monstre fasciste. Comme si la démocratie et le fascisme étaient des opposés, comme si la démocratie était la vie et le fascisme la mort. Non, le fascisme n’est pas un monstre extraterrestre auquel tous les êtres humains doivent s’opposer. Au contraire, c’est un produit de cette société. Le fascisme a certaines fonctions à l’intérieur de la société autoritaire, tout comme la démocratie. Dans le cas le plus extrême, quand l’ordre existant est fondamentalement menacé, tout pouvoir peut devenir fasciste. A d’autres moments, les groupes fascistes (marginaux) sont le paratonnerre par excellence du pouvoir démocratique. Pendant que tout le monde se focalise sur les méchants grands loups fascistes, les politiciens de tous les partis démocratiques passent toutes sortes de lois dégueulasses et répressives. Mais qui oserait les attaquer, car le « vrai » ennemi est bien ailleurs, non ? La stratégie du front unitaire crée la fausse idée que les tendances fascistes se limitent à quelques groupes, partis et personnages charismatiques. Elle crée la fausse idée que toute personne qui s’oppose à ces groupes défendrait la liberté. En se focalisant uniquement sur certains groupements, on passe outre le fait que dans la société entière, on voit des tendances fascistes. Le fascisme ne se manifeste pas uniquement comme idéologie politique dans la tradition d’Hitler, Mussolini ou Franco. On peut s’y heurter dans les rapports sociaux autour de nous, comme tendance générale visant à soumettre la vie entière au pouvoir. Le fascisme comme totalitarisme autoritaire, comme pénétration de l’autorité dans toutes les fibres de la vie. Cette tendance est présente dans la famille, l’école, l’entreprise, l’église, la mosquée. Les groupes marginaux qui de temps en temps, sont dirigés par des leaders charismatiques, ne peuvent acquérir du pouvoir et réaliser leur programme que parce que les oripeaux du fascisme sont déjà présents. Peut-être pas aussi explicitement, mais juste en-dessous de la surface, en se limitant à leur propre environnement cloisonné. Pourtant, cela reste une réalité oppressante, une réalité qui enlève aux individus jour après jour la possibilité de faire leurs propres choix. Et c’est une réalité qui rend possible le fascisme comme projet de société.
Personne ne se fait d’illusions sur les geôles fascistes, elles sont certes plus brutales que leurs versions démocratiques. Mais soyons honnêtes : est-ce que c’est ça qu’on veut, choisir entre les deux ? Est-ce que nous voulons lutter pour protéger le vieux pouvoir contre le nouveau ? En fin de compte, ce ne sont que deux mécanismes différents de gestion, qui n’ont rien à voir avec la liberté. Dans les geôles démocratiques on respire peut-être un peu plus facilement, mais l’air qui nous rappelle la liberté, y est fortement vicié.
Jetons par-dessus bord toutes ces questions qui nous poursuivent depuis belle lurette. Un premier pas vers un affrontement réel qui dévoile des possibilités de libération, c’est de rompre avec les cadres de la pensée dominante. Refuser le vocabulaire démocratique ne signifie certainement pas s’isoler. De nombreuses personnes vivent ce monde comme quelque chose de misérable et cherchent à s’y opposer de différentes manières. Il s’agit de créer les possibilités pour pouvoir partager ces actes de combat, ou les faire dialoguer. A partir de là, nous pouvons développer l’échange d’idées et l’expérimentation de nouveaux rapports. Des rapports basés sur la réciprocité, orientés vers une vaste lutte ayant comme but la destruction de ce monde. Refusons le dogme quantitatif, qui n’est utile qu’à la démocratie et concentrons-nous sur le qualitatif, c’est-à-dire les idées que portent des individus et les actes qu’ils posent dans des situations concrètes. Laissons le spectacle des médias et de la politique aux acteurs professionnels. C’est dans la rue que nous devons conquérir l’espace et le temps pour expérimenter des rapports entre nous et des formes de lutte que nous opposons à nos ennemis. Pour que la lutte sociale ne soit pas que de la rhétorique, mais une réalité qui devienne une menace pour la démocratie et ses esclaves volontaires. Parce que nous voulons donner une place à la lutte pour la liberté au sein de nos propres vies. Avec détermination. Pas d’une façon hautaine, pas dans une foi aveugle, mais à travers la nécessité (pas comme fatalité, mais comme désir et intention) de rompre ici et maintenant avec la misère quotidienne, et à travers la possibilité d’entamer des rapports et de mener une vie partant du désir de liberté.
NOTES SUR LA DEMOCRATIE
La démocratie est une sacrosainte horreur.
La démocratie est une abomination qu’il faut abattre.
Vous voyez, par ces quelques mots, je viens de me ranger dans votre esprit parmi les ennemis définitifs de l’humanité, parmi ces brutes qui détournent des avions et les jettent contre des tours de bureaux. La démocratie est aujourd’hui une valeur universellement partagée par toutes les idéologies politiques –qu’elles soient de droite ou de gauche- tout simplement parce qu’elle est devenue par la force des choses et les aléas de l’histoire la dernière des vaches sacrées, un synonyme du bien absolu, une cause pour laquelle on peut mobiliser les forces les plus violentes et liberticides au nom du combat contre tout ce qui est antidémocratique (et présenté comme le mal absolu). Impossible de penser hors du doublon démocratie-dictature. Impossible de ne pas accepter les principes de base de la démocratie, à moins d’être irrémédiablement et définitivement repoussé dans la plus obscure des marginalités. Cette impossibilité est d’ailleurs une source profonde d’aliénation, une des raisons pour lesquelles la liberté n’existe pas dans nos belles républiques et monarchies constitutionnelles occidentales.
Ce que je vais dire en choquera plus d’un, mais ce n’est hélas que la plus banale des vérités : il existe une tension inhérente et flagrante entre la démocratie d’une part et de l’autre la liberté des individus d’inventer et de créer leur propre vie selon leur propres choix. La démocratie n’est pas un moyen de libérer les individus, mais une façon particulièrement efficace de les asservir en obtenant leur consentement. La démocratie est la violence et l’oppression institutionnalisées dans leur expression la plus complexe et la plus sophistiquée. La démocratie est une des multiples chaînes qui asservissent l’individu. La démocratie est une hydre à abattre.
« Que faites-vous de tous ces gens qui sont morts pour obtenir les droits démocratiques dont vous jouissez et sur lesquels vous crachez de façon si méprisante ? »
A cela je réponds que le nombre de martyrs ne fait pas la justesse de la cause. Sinon, nous devons payer respect à ceux qui sont morts pour la pureté de la race, la vraie foi, le salut de la nation ou la grandeur de l’empire. Mais ce n’est pas tout : j’ose prétendre que la vaste majorité de ceux qui sont morts historiquement pour la démocratie luttaient bien plus pour leur libération individuelle que pour le privilège d’élire un représentant à l’Assemblée législative. Et malgré ce que vous pensez, il s’agit de deux causes distinctes et même antinomiques.
« Soyez réaliste ! comme le disait Churchill, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. »
Ce n’est pas parce qu’un régime politique est moins mauvais que les autres qu’il mérite d’être défendu, qu’il mérite qu’on meure pour lui. Ce n’est pas parce que le sida tue que je militerai pour l’herpès génital. Si on doit se battre, autant se battre pour sa propre cause plutôt que pour un pis-aller qui finira par se retourner contre nous et nous opprimer. Car l’oppression de l’individu est inhérente au principe étatique…et la démocratie est un mode de gestion de l’Etat.
Churchill l’a dit avant moi. Tout plein de gens vraiment intelligents l’ont dit avant Churchill : la démocratie n’est pas parfaite, elle est même profondément vicieuse. Les défenseurs de la démocratie reconnaissent la plupart des trucs qui m’enragent au sujet de la démocratie et ces tares ont mené au fil des ans au développement de nouvelles formes démocratiques –des modèles nouveaux et améliorés dont le but est surtout de sauver les apparences. Car l’apparence est au cœur de l’exercice démocratique ; en l’apparence réside toute son utilité. En ce qui me concerne, les problèmes de la démocratie m’apparaissent si fondamentaux que personne ne pourrait me convaincre que les systèmes basés sur cette arnaque peuvent être réformés de façon satisfaisante pour permettre l’épanouissement de la liberté individuelle.
Je suis en colère et je crie. Mais je ne crie pas pour plus de démocratie ou une meilleure. Je crie pour son abolition pure et simple.
***
Mais qu’est-ce que la démocratie ? Il s’agit de la théorie politique qui stipule que le gouvernement et les lois qu’il adopte et fait respecter doivent refléter la volonté de la majorité telle que déterminée par un vote direct ou des représentants élus. La plupart du temps, la légitimité d’une démocratie naît avec l’adoption d’une constitution qui établit les règles fondamentales, les principes, les devoirs et les pouvoirs du gouvernement. Cette constitution limite aussi la plupart du temps le pouvoir d’ingérence de l’Etat dans la vie de ses citoyens en établissant une liste de droits qui sont théoriquement protégés de l’ingérence de la majorité démocratique.
***
Un problème important de la démocratie est qu’elle est source institutionnalisée d’aliénation.
La liberté individuelle n’est possible et praticable que lorsque la pensée et l’action sont intimement liées, lorsque les désirs et leur libre réalisation ne sont pas entravés par des forces extérieures à la volonté individuelle. Ce lien qui se brise entre la pensée et l’action, voilà ce qu’est l’aliénation.
Les passions et les désirs n’ont de valeur que s’ils constituent des forces réelles et incarnées dans nos vies. Mais lorsque l’individu est aliéné, les passions et les désirs sont tués dans l’œuf par la simple conscience que les conditions de son existence sont hors de son contrôle. Dans ce contexte, les rêves ne sont que pour les rêveurs, les désirs sont continuellement confrontés à l’impossibilité de l’action, à l’impossibilité de leur réalisation. Cette sinistre condition existentielle fait en sorte que l’individu perd contact avec les désirs et les passions qui devaient être les moteurs de ses actions. Ce contact est extrêmement difficile à rétablir lorsqu’il est perdu et mène pour la plupart d’entre nous à un état de passivité abrutissante. Même le désir de changer les conditions sociales et matérielles qui causent l’aliénation se transforme alors en passivité et en désespoir, ce qui assure la pérennité de l’aliénation.
En tant que force extérieure à l’individu qui sépare sa volonté de son action, la démocratie ne fait rien de moins que d’assurer l’existence du pouvoir aliéné, puisqu’elle exige que les désirs soient séparés du pouvoir d’agir. Toutes les variétés de démocratie ont recours à l’élection comme mode de prise de décision, qui par définition représente un moyen de transférer les pensées, l’autonomie et la liberté de l’individu vers un pouvoir extérieur. Que ce transfert de pouvoir se fasse vers un représentant élu ou une vague majorité n’a en soi que peu d’importance. La réalité est que l’individu démocratique ne s’appartient plus lui-même ; il appartient à la majorité démocratique. Le citoyen est ainsi aliéné de sa capacité à déterminer les conditions de sa propre existence et de choisir librement le type de relations qu’il souhaite entretenir avec ses semblables.
***
En démocratie, les décisions sont aussi aliénées du contexte qui les a motivées et sur lequel elles sont censées agir. C’est ce que j’appelle la décontextualisation. La séparation et l’institutionnalisation inhérentes à la démocratie sont en soi autoritaires parce qu’elles exigent que les décisions soient prises avant même qu’adviennent les circonstances auxquelles elles s’appliquent. Les décisions politiques prennent toujours la forme de règles générales qui doivent être systématiquement appliquées lors de certaines situations, quels que soient le contexte ou les circonstances particulières. La démocratie a donc comme effet d’empêcher les individus ou les groupes d’individus de prendre des décisions adaptées aux multiples situations auxquels ils sont confrontés au moment même où ces situations se présentent.
La démocratie a un autre effet pervers : celui de limiter et de simplifier à l’extrême le spectre des décisions qui peuvent être prises par l’individu, commodément ravalé au rang de citoyen. Pour qu’un vote soit possible, les phénomènes complexes, avec leurs nombreuses causes et ramifications, doivent être réduits à des options limitées, voire carrément binaires : oui ou non, pour ou contre. La démocratie réduit le champ des possibles et étouffe ainsi toute possibilité de changement de façon extrêmement efficace. En cela, la démocratie fonctionne davantage comme un outil de justification du pouvoir étatique que comme un mode efficace de participation des individus aux décisions collectives.
La démocratie accorde une importance singulière à l’opinion. Les électeurs deviennent des spectateurs d’un processus où diverses opinions qui sont l’objet de leurs choix électoraux leur sont présentées, alors que ceux qui produisent ces opinions sont ceux qui détiennent le vrai pouvoir. Tous ceux et celles qui ont vécu une campagne électorale ont été témoins de ce phénomène : les vrais problèmes qui frappent la société sont généralement évacués ou alors réduits à des slogans dénués de sens qui n’ont d’autre qualité que d’être courts et de frapper l’imagination lors de leur diffusion au journal télévisé.
La réduction des idées en opinions a un effet pervers de polarisation. Lorsque le seul mode de participation est la sélection et qu’il n’y a pas d’autre choix que l’option A et l’option B, les partis se rangeant derrière l’une ou l’autre de ces options se repoussent mutuellement en renforçant leur certitude mutuelle d’être l’incarnation du « bien », dans un esprit totalement manichéen. Dans ces conditions, espérer une reconnaissance de la complexité du réel, un sens du compromis ou une collaboration dans la recherche de solutions est rigoureusement illusoire.
***
Evidemment, l’aliénation, la manufacture en série des opinions et la décontextualisation des décisions ne sont pas les seuls problèmes fondamentaux de la démocratie ; la critique doit aussi s’adresser au concept même de majorité. La « majorité » obtient dans une démocratie de tyranniser « la minorité ». En outre, le sens littéral du mot « majorité » est particulièrement relatif dans le concept de la « majorité démocratique ». Dans la plupart des pays où il n’y a pas d’obligation à voter, des pourcentages considérables (20, 30 voire 60 pourcents de l’électorat potentiel) restent à la maison lors de la grand-messe de la démocratie parlementaire. Si on entend alors que le plus grand parti a obtenu par exemple 25 pourcents des votes, cela ne représente en termes absolus de la population pas du tout « la majorité ». Dans le meilleur des cas, la majorité en démocratie est en effet la minorité numériquement la plus grande.
Mais ça ne s’arrête pas là. La justification démocratique s’en fout de l’absentéisme ou des votes pour les opinions minoritaires et des « partis d’opposition ». Face au constat qu’en effet, selon les normes démocratiques, il n’est pas tout à fait correct que les non-votes des non-électeurs renforcent de fait la majorité lors du scrutin, on nous sort l’argument que ne pas participer au scrutin revient à un consentement avec l’opinion majoritaire puisque les non-électeurs auraient pu aller voter pour autre chose. Et les votes minoritaires pour les groupes d’opposition renforcent à leur tour la légitimité de la majorité au pouvoir. On le voit, on n’échappe pas à l’auto-justification du principe démocratique.
Et je ne parle pas du caractère profondément inique du principe « une personne un vote » qui ne tient aucun compte de l’importance de la préférence individuelle. Deux électeurs vaguement intéressés à faire quelque chose peuvent gagner contre mon opposition acharnée et passionnée.
Voilà pourquoi les exercices démocratiques ne menacent jamais l’ordre établi. Comme le disait si bien Errico Malatesta, le fait d’être appuyé par une majorité ne prouve en rien la justesse de sa cause. Les grands bouleversements sociaux, la conquête de la liberté individuelle, les insurrections vaillantes contre l’autorité ont toujours été accomplies par des individus et des minorités ; les majorités sont de par leur nature lentes, conservatrices et soumises aux forces supérieures du pouvoir établi.
***
Il ne faut pas oublier les critiques immanentes de la démocratie. Certaines d’entre elles ont été formulées la première fois à l’époque de Platon et d’Aristote et n’ont pas encore été réfutées de façon satisfaisante ; elles concernent la démagogie, les groupes de pression et la corruption.
La démagogie est la stratégie politique qui consiste à obtenir du pouvoir en ayant recours à une rhétorique qui flatte les préjugés et les réflexes les plus vils, les plus bas et les plus réactionnaires de la population. Toutes les démocraties y succombent un jour ou l’autre, désireuses qu’elles sont de manufacturer le consentement à partir des peurs, des espoirs et des colères confuses des masses citoyennes.
De plus, les démocraties représentatives sont tout spécialement vulnérables à l’action délétère des groupes de pression. Les groupes représentant des intérêts particuliers ont l’habitude d’engager des experts grassement rémunérés qui ont pour mission de courtiser, de harceler, de menacer ou carrément d’acheter les représentants élus pour obtenir une législation qui leur est favorable, des subventions gouvernementales ou toute autre sorte de faveur. Parce que les élus proviennent fréquemment du milieu des affaires ou des classes aisées, la collusion avec ces groupes de pression se fait la plupart du temps tout naturellement, souvent même avant que ledit élu n’ait eu le temps de se saisir du pouvoir.
Ces problèmes sont des symptômes éloquents qui se manifestent lorsque les individus sont réduits à une masse amorphe de spectateurs passifs du processus décisionnel, ou lorsque l’implication de l’individu dans la création de son propre environnement de vie est réduite au simple choix d’opinions. Il est donc inutile de travailler à réformer les institutions démocratiques pour permettre aux politiciens de devenir de meilleurs démagogues et de meilleurs lobbyistes. Le contrôle du financement des partis politiques, la distribution gratuite de temps d’antenne ou la revendication de referendums directs sont inutiles, parce que ces réformes reconnaissent implicitement la légitimité de la manipulation politique.
Depuis le berceau, la corruption ronge la démocratie. Elle en est un aspect inhérent, malgré toutes les mesures, promesses et engagements du monde politique. Un dictateur infâme qui organisait de temps en temps des élections disait : « Ceux qui votent ne décident rien, ceux qui comptent les votes décident tout. »
***
Une des forces de la démocratie est sa faculté à se reproduire, à se fondre dans le statu quo et à assurer sa pérennité. Malgré ce qu’en disent la plupart des démocrates, les démocraties sont loin d’être fragiles ; la plupart des régimes actuels qui sont les plus anciens sont des républiques et des monarchies constitutionnelles basées sur les principes de la démocratie représentative. En ce début de millénaire, les êtres humains vivent soit dans des démocraties, soit dans des pays sous la domination économique et militaire de démocraties. Comment expliquer ce succès ? Comment expliquer cette hégémonie ?
Dans tous les pays démocratiques, l’endoctrinement démocratique commence à la petite école, avec l’élection des présidents de classe, l’éducation civique, les cours qui présentent l’actuel régime démocratique comme le meilleur, la plus haute échelle du progrès humain. Très vite, le citoyen est amené à penser que la démocratie est la condition première et nécessaire à la liberté. Lorsque la démocratie encadre le débat de la sorte et force même ses opposants à discuter selon ses propres termes, toutes les actions entreprises pour changer l’environnement politico-social doivent se dérouler dans le cadre de ses principes, sinon de ses institutions, et réaliser les seules fins qu’elle puisse sanctionner. C’est pourquoi la démocratie réussit à se reproduire en demandant si peu d’effort de la part de l’élite dominante. Un système démocratique basé sur le règne de la majorité convainc les classes exploitées et aliénées qu’elles ont le contrôle des institutions gouvernementales grâce à ses mythes fondateurs (la volonté populaire, le peuple souverain, etc.) même si ce contrôle reste effectivement entre les mains des classes exploiteuses et aliénatrices. Même les contradictions les plus flagrantes passent inaperçues parce que le système a réussi à faire équivaloir son existence à celle de la liberté, se plaçant ainsi à l’extérieur du champ des idées et des principes que l’on peut critiquer et combattre. En se présentant comme un a priori ou comme le premier principe de la liberté individuelle, la démocratie offre un visage de tolérance et se présente comme la source par excellence du bien public, se plaçant ainsi au-delà de toute contestation.
En régime démocratique, les notions d’égalité des électeurs et de règne de la majorité impliquent que le Peuple (avec un gros P majuscule) détient le pouvoir, malgré les innombrables preuves du contraire. En toute logique, si le Peuple n’effectue aucun changement dans l’ordre des choses, c’est qu’il n’a aucune volonté de le faire puisqu’il est souverain. Or, le Peuple croit, en théorie, en la justice et en la liberté puisque selon les mythes fondateurs des démocraties il se retrouve à l’origine même de la création de ces régimes politiques. Puisque le Peuple démocratique aime la liberté, il devrait naturellement agir pour mettre fin à toutes les formes d’oppression, au moment même où elles sont découvertes. Ce qui signifie que si une loi, un règlement ou une pratique gouvernementale ne change pas, c’est qu’elle n’opprime pas le Peuple. Bref : tout ne peut qu’aller bien dans le meilleur des mondes.
Evidemment, un tel raisonnement n’a jamais et ne pourra jamais donner naissance à une société véritablement libre. Mais rejeter cette logique sans adopter une critique générale de la démocratie mène directement à une autre conclusion hautement douteuse, qui est la plupart du temps formulée par les personnes et partis de gauche des démocraties libérales occidentales. Selon eux, si le gouvernement n’est pas à la hauteur des aspirations du Peuple, c’est que les gens sont trop apathiques, trop ignorants, trop stupides ou trop égocentriques pour se servir collectivement du pouvoir qui se trouve à portée de leurs mains. Si les militants progressistes pouvaient seulement réussir à informer, éduquer, organiser et mobiliser les masses, tout finirait par fonctionner à merveille. On assiste alors au spectacle pitoyable d’individus selon toute vraisemblance intelligents qui volontairement se retrouvent pieds et poings liés, se débattant pour réformer un système qui dans ses incarnations les meilleures et les plus efficaces n’a d’autres fonctions que d’opprimer tout le monde de façon égale.
Nous assurons tous et toutes la reproduction de la démocratie avec notre vote et notre acceptation servile et quotidienne aux résultats des élections. Le fait d’aller voter ne sert qu’à réaffirmer et à légitimer le pouvoir de l’Etat, quel que soit votre choix électoral. En votant, il vous arrivera peut-être de participer à la création ou à l’abolition de politiques, et de législations. Vous pourrez même participer au renouvellement de la classe politique. Mais vous n’arriverez jamais à changer le système et ses relations de pouvoir basées
