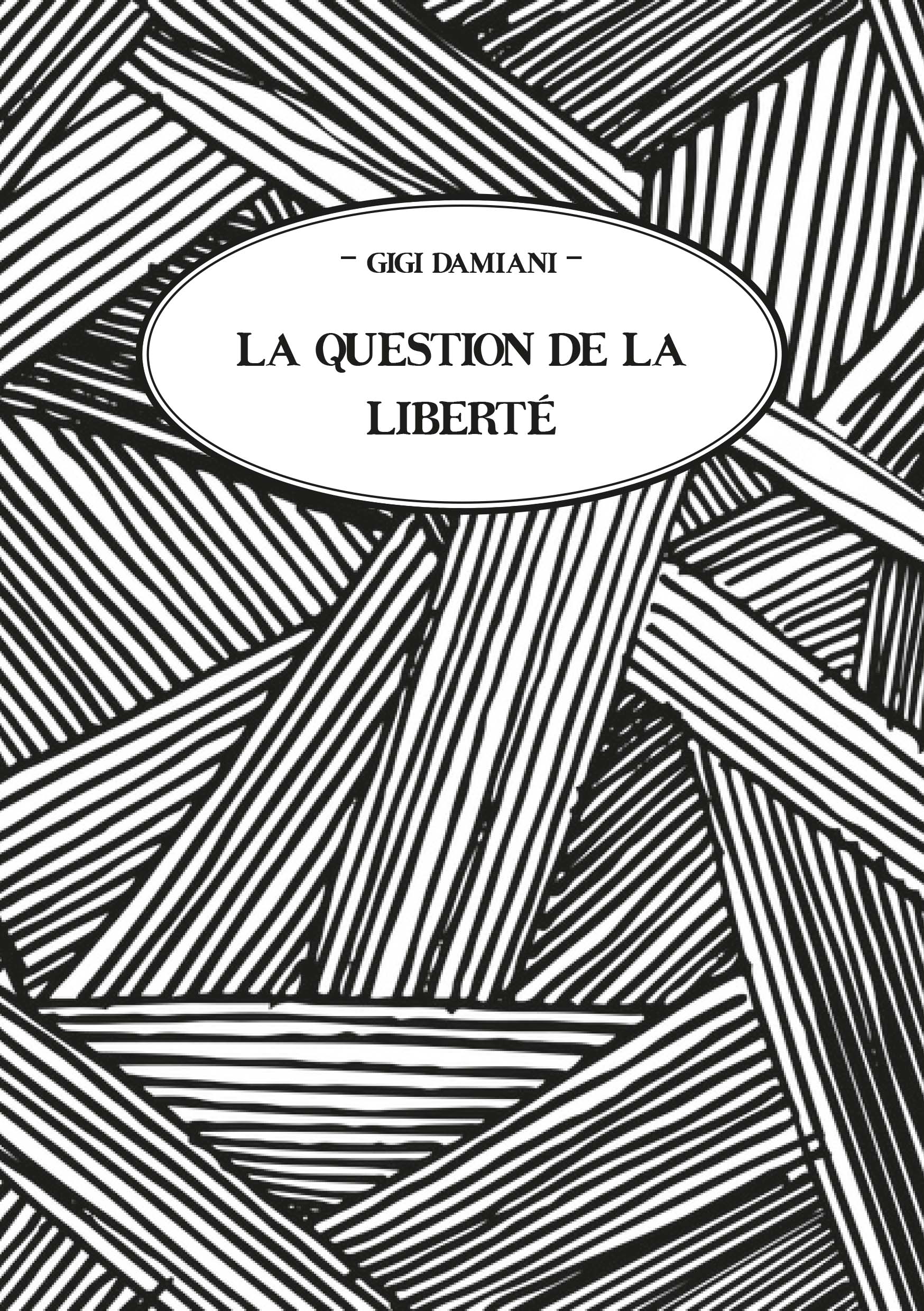 La force des choses pourra secouer des milliers et des milliers de chômeurs, ou de travailleurs brimés par une usure patronale trop avide, elle pourra même soulever un peuple affamé et contraint par la violence à se résigner à sa misère, mais la force des choses ne concédera au soulèvement, à la révolte de tels éléments, qu’un espace assez limité pour se développer, pour s’épuiser. Les affamés s’arrêteront au pillage des dépôts de vivres, les salariés parviendront peut-être à imposer une considération plus juste du labeur, les chômeurs, après s’être égosillés à demander du pain et du travail, seront peut-être casés par lots dans quelques emplois provisoires. Et la force des choses payée par ses… victoires, se reposera, préparant de nouvelles situations qui répéteront les faits déjà advenus, avantageusement aujourd’hui, avec perte demain.
La force des choses pourra secouer des milliers et des milliers de chômeurs, ou de travailleurs brimés par une usure patronale trop avide, elle pourra même soulever un peuple affamé et contraint par la violence à se résigner à sa misère, mais la force des choses ne concédera au soulèvement, à la révolte de tels éléments, qu’un espace assez limité pour se développer, pour s’épuiser. Les affamés s’arrêteront au pillage des dépôts de vivres, les salariés parviendront peut-être à imposer une considération plus juste du labeur, les chômeurs, après s’être égosillés à demander du pain et du travail, seront peut-être casés par lots dans quelques emplois provisoires. Et la force des choses payée par ses… victoires, se reposera, préparant de nouvelles situations qui répéteront les faits déjà advenus, avantageusement aujourd’hui, avec perte demain.
À l’inverse, la force des idées, bien que ne méprisant pas le facteur de la force des choses, veillant même sur elle pour pouvoir l’utiliser à profit, transformera le soulèvement en révolution par un acte de volonté ; et elle livrera bataille non pas pour une fin transitoire et contradictoire, mais pour un idéal de justice et de liberté qui une fois atteint, placera l’homme et l’espèce dans une dimension différente de celle dans laquelle il s’est agité jusqu’à aujourd’hui, et d’où il pourra se mouvoir vers un avenir toujours plus lumineux.
Pour télécharger la brochure: La question de la liberté – Gigi Damiani A5 page-par-page
Ci-dessous, le texte de la brochure:
La question de la liberté
Pourquoi les murs de Jéricho ne s’écroulent pas ?
Le mouvement révolutionnaire, en conséquence de l’après-guerre, s’épuisa dans des actions isolées, rares et de peu d’importances, qui furent une dépense d’énergies, de moyens et d’hommes (dont beaucoup, rescapés des rafles policières, des exils et des coups, furent ensuite vaincus et conduits ailleurs par la désillusion) déplorable, bien que glorieuse, et s’épuisa dans de nombreuses, trop nombreuses manifestations chorégraphiques et dans pas mal d’acclamations festives ; ou, mieux encore, parce que pesait sur les foules l’habitude d’attendre un miracle ; habitude entretenue et élevée avec beaucoup de soin par le réformisme ; habitude qui paralysait l’évolution, la maturation de cette volonté, et qui étouffait tout relent d’initiatives individuelles ou de groupes qui prétendraient accélérer la marche de ce mouvement.
Les masses, bien que s’agitant, et parfois impulsivement, ne savaient pas dépasser la limite de l’agitation inutile parce qu’elles attendaient que la venue d’un Messie le fasse. Un Messie qu’aucune vierge n’avait pu concevoir, parce que le socialisme s’était déjà trop consacré, sinon exclusivement, aux pratiques onanistes du parlementarisme. Le Parti Socialiste Italien n’avait pas voulu épouser la liberté (peut-être parce qu’il avait comme précepteurs des professeurs allemands), il avait même dit clairement, dans les dernières années de sa colossale existence, que certains amours ne convenaient pas à une personne sérieuse comme lui, qu’il devait construire un foyer et remplacer le gouvernement bourgeois par son propre gouvernement.
À cette époque, tous ces socialistes qui se croyaient nés avec la fibre du dirigeant de masse, du chef de ligue à l’élu, de l’organisateur au membre de la direction, du journaliste au propagandiste, tous baladaient leur vanité des préfectures aux ministères, des places aux bureaux, se pavanant de leur hyperpuissance occasionnelle. Et il n’y a pas que l’ennemi qu’ils regardaient de haut en bas, mais aussi le compagnon lambda, le travailleur « quelconque », qui, pour vivre, devait accepter une carte d’adhésion et professer une foi dont ils avaient entendu parler jadis, plus durement encore que comme ils doivent le faire aujourd’hui.
À l’époque, il y avait des armes, et il y avait aussi des hommes qui, grâce à leurs longues expériences, étaient capables de les utiliser… Il y avait aussi dans l’air cette odeur de soulèvement, caractéristique des périodes où un peuple, épuisé et sanglant suite au grand et immense effort accompli, s’aperçoit que tous ces efforts ont été vains.
Mais tous les petits Dieu le père, préoccupés par leur succès crâneur, se limitaient à faire résonner les trompettes de Jéricho sous les murs de la citadelle bourgeoise. Et chaque fois qu’une agitation économique ou politique menaçait de déborder en un mouvement beaucoup plus large et profond, ils se précipitaient pour la canaliser dans la mer morte de l’attente messianique, compensant et endormant les impatiences grâce à quelques conquêtes pratiques immédiates : une diminution des heures de travail, une augmentation des salaires, la reconnaissance d’une commission interne, le paiement des jours de grèves, le limogeage d’un préfet…
Naturellement, ces procédés « énergiques » les valorisaient énormément auprès de l’ennemi qui, afin de ne pas tout perdre, concédait le moins possible, et, ne pouvant pas encore montrer les dents, s’ingéniait à gagner du temps en remerciant, en saluant et en s’inclinant face aux nullités les plus hautaines et ridicules.
Elles en tiraient une profonde satisfaction et se prélassaient dans leur énorme importance sans même s’apercevoir que l’ennemi, feignant l’humilité, préparait, en plus des préparatifs défensifs, ceux de l’attaque.
Malgré la situation propice, pour diverses raisons, à un mouvement profondément révolutionnaire, on continuait à parler d’augmentations de salaires, de compétences annexes, de réductions horaires, de contrôles, de conquêtes de communes et d’heure historique… qui s’avérera par la suite fatale. Le socialisme était entièrement là. Le soleil de l’avenir… réduit à « faire des passes »… à un jeton de présence, une fois bureaucratisé, ne réchauffait pas d’autres espoirs majeurs que les grèves de classes et de catégories. Parce qu’en plus de la classe il y avait aussi la catégorie qui faisait sa lutte non seulement contre le patronat, mis aussi contre sa propre classe.
Voilà ce qui explique pourquoi les masses affluèrent et furent toujours prêtes à répondre quand il y avait une revendication économique à faire valoir, et pourquoi elles désertèrent toujours plus la place quand une grève politique était proposée.
L’idéal qui enseigne et prévoit tous les sacrifices, qui fuit les compromis politiques, brise même la discipline de parti quand ceux qui le dirigent hésitent, marchandent, ou sentent le poids des responsabilités ; l’idéal qui requiert l’audace et non le calcul, était chez très peu de personnes, très très peu. Et même parmi eux, combien ne courraient pas derrière un rêve de pouvoir qu’ils ont ensuite réalisé ailleurs, en frappant les compagnons d’hier ? !…
C’est vrai, on chantait à tue-tête « bandiera rossa », avec tellement de « Vive le Socialisme et la liberté ». Mais la liberté avait plus à voir avec la sonorité du vers qu’autre chose. Figurez-vous que même les fascistes ont mis la liberté dans leurs chants de bataille ; pour la rime.
En conclusion la révolution promise dans les réunions électorales et renvoyée, lors de chaque grève à l’issue bonne ou mauvaise, à la prochaine occasion, on annonçait un remplacement des classes qui aurait eu lieu dès que la bourgeoisie, n’en pouvant plus, aurait démissionné. L’ouvrier voulait devenir patron ; le député rêvait de se réveiller ministre ; le membre de la direction se voyait déjà dictateur ; le chef de la ligue était certain que, à peine « arrivé Lénine », il le ferait commissaire de la province, et pendant ce temps le surveillant du Cercle Œnologique d’Études Sociales paysan se préparait les galons de capitaine, – au minimum ! – de la Garde Rouge. Cependant ce dernier ne se sentait pas non plus de risquer sa peau.
Des centaines de milliers de votes, de nombreux ordres du jour et énormément de « bandiera rossa ».
Un beau matin, les murs de Jéricho, de la Jéricho bourgeoise, s’écrouleraient d’eux-mêmes.
***
Les socialistes ont constamment reproché aux anarchistes une foi excessive dans le miraculisme insurrectionnel. Mais en vérité, plus de cinquante années de politique socialiste n’ont pas été autre chose que cinquante années de propagande miraculiste, d’un miraculisme agaçant qui allait – faisant abstraction de la conception catastrophiste marxiste primitive – du « faites-moi député… et puis vous verrez », à l’ « organisez-vous… et puis vous verrez », à l’ « attendez que les faits mûrissent en décrets-lois et puis nous commanderons ». Et aucune intempérance, aucun utopisme ; des conquêtes pratiques et concrètes ; la consolidation de chaque position occupée. Du sang froid.
Et, quand le moment révolutionnaire est venu, le moment où il fallait charger sans plus penser, en jouant le tout pour le tout, les foules socialistes dans leur quasi-totalité, par habitude, ont gardé le sang froid, … les yeux fixés sur les courbes de l’inflation… en attente du miracle.
Et quand, plutôt que le miracle, les coups et la réaction sont venus ; quand ceux qui avaient appris chez les socialistes l’art d’organiser les classes travailleuses avec la corde au cou, c’est-à-dire avec le « bois ou tu te noies », quand ils eurent une possibilité majeure de renforcer le système, ces classes travailleuses – tout en regrettant le beau temps où l’on gagnait plus – ont changé d’insignes, et sont passées de la Confédération Générale du Travail à la Confédération nationale des corporations syndicales1, le cœur légèrement chargé de regret, mais fuyant la résistance désespérée.
Et tous les avocats, tous les professeurs, tous les déplacés de la bourgeoisie et tous les intellectualoïdes avides de renommée et de salaire, qui auparavant affluaient au Socialisme, parce que le Parti Socialiste était le meilleur bureau de placement… se hâtèrent de retrouver la nation, alors que la vieille agence internationale échouait.
Il y a eu des résistances de la part de minorités ou d’individus, parfois mêmes héroïques, il y en a eu et il y en aura, mais il s’agit de véritables minorités, celles sur lesquelles la levure des idéaux avait déjà fermenté.
La grande masse, celle qui devait partir à l’assaut, et qui au contraire soufflait à en perdre haleine dans les trompettes de Jéricho, s’est immédiatement débandée, dès que les chefs ont démontré qu’ils n’étaient ni des héros, ni des thaumaturges, mais de simples jongleurs politiciens.
Atroces moqueries du miraculisme réformiste et parlementaire : violente farce du déterminisme économique qui fait le marxiste et le bourgeois selon l’occasion et la table dressée.
Pour réussir, et réussir quelque chose de plus et de mieux qu’un coup de pouce pour remplacer une situation autoritaire par une autre, – et même cela, ils n’ont pas eu l’audace de le tenter – il fallait donner aux masses, en leur parlant plus de sacrifice que de cocagne, un viatique de foi, de foi dans la liberté ; il fallait les exhorter à la lutte révolutionnaire et ne pas les épuiser dans les grandes manœuvres grévistes qui fatiguaient un peu tout le monde, et qui en même temps diminuaient la richesse nécessaire pour le lendemain ; il fallait dire aux travailleurs : le salut est en vous et non pas dans l’influence de l’honorable compagnon auprès du ministre des travaux publics ou de celui de l’intérieur.
Quand accidentellement la secousse explosait et prenait l’aspect d’une insurrection, comme à Ancône, ou à Florence, il ne fallait pas se refuser à la généraliser par peur d’être renversés, par peur de ne plus pouvoir la mener avec la laisse du programme du parti, et il ne fallait pas se démener avec des contre-ordres suppliants.
Et il aurait fallu pouvoir compter à temps sur la force des idées. Mais cette force avait été raillée. Le matérialisme historique, sûr de lui-même comme un général allemand d’avant-guerre, l’avait scientifiquement bannie.
Pour aller combattre dans les tranchées de la révolution, prêt à vaincre ou à mourir, il y avait plus que besoin de l’impulsion d’une force morale… qui manqua.
***
On dira : et pour quoi vous autres, anarchistes, n’avez-vous pas fait ce que les socialistes ne faisaient pas ? Nous avons fait quelque chose, bien sûr. Mais nous étions peu, et parmi ce petit nombre, certains parlaient un langage non accessible aux foules, et, trop souvent, divaguaient en tissant des panégyriques à l’absolu philosophique du super Moi, parfois anémiques et scrofuleux. D’autres, plus nombreux, subissaient l’influence du moment ; disons qu’ils pliaient presque sous le poids de l’immense mouvement socialiste, et sans même s’en apercevoir, sacrifiaient à l’imminence d’une révolution de masse, leur insurrectionnalisme des minorités qui entraînent les majorités. Et tout en en ayant la pénible sensation, ils ne voulaient pas se rendre compte d’un fait répugnant : la trahison socialiste mûrissante. Comprenons-nous : non pas la trahison de mercenaires, de vendus, mais celle d’incapables et même d’honnêtes… D’honnêtes, c’est-à-dire de gens qui ne comprirent qu’à ce moment-là l’absence de préparation dans le domaine des idées de la masse… celle qui avait été essentiellement éduquée à mieux digérer, à moins travailler, à gagner plus : c’est-à-dire matériellement éduquée.
Mais une voix crie : Gare à ce que l’ennemi ne vous écoute pas.
Et que nous importe si l’ennemi nous espionne de près et s’arme aussi de nos confessions ? ! La vérité doit être dite toute entière pour que la trahison ne se répète pas ; pour que l’on ne se retrouve pas demain, même si ce demain devait tarder à arriver, paralysés par la même impréparation spirituelle.
Le Socialisme anima un mouvement bouleversant, bien que mouvement minoritaire, tant qu’il était mû, alimenté par des valeurs idéales, spirituelles, morales ; tant qu’il parlait de sacrifice et d’audaces généreuses. Mais à partir du moment où, tout en devenant un mouvement de majorité, il créa des emplois et distribua des salaires, où il établit des classements, alla siéger chez l’ennemi et s’y trouva bien installé, il ne bouleversa plus rien, mais prépara les tourbillons qui devaient le tenailler par les pieds, et souffla sur la vague qui devait l’emporter.
Par conséquent, disons toutes les vérités que l’on peut dire aujourd’hui, pour que les erreurs ne se répètent pas. Peut-être que le jour viendra où nous pourrons ou devrons même en dire d’autres. Et refaire l’histoire honteuse des « fronts uniques » et de nombreuses grèves…
Aujourd’hui… ici…
Aujourd’hui la liberté est sur la croix : la liberté véritable. Et avec elle, les petites libertés démocratiques et de boutiquiers ont elles aussi été crucifiées. Mais nous voulons déclouer celle-là, et ne nous préoccupons pas de ces dernières qui, dans un premier temps, ont aidé à la crucifixion de celle-là. Les mêmes crucifieurs penseront eux à déclouer les petites libertés démocratiques et de boutiquiers, quand ils en auront besoin. Nous, nous voulons déclouer la liberté véritable, la liberté unique, la liberté intégrale.
Les murs de Jéricho ne s’écrouleront pas à cause du vacarme processionnel d’une foule qui ne voulait pas s’en emparer d’une autre manière, parce qu’elle n’était prête ni matériellement, ni, surtout, moralement prête à combattre. Ces murs ne furent même pas assaillis quand derrière eux les assiégés préparés leurs sorties… parce que selon l’avis éclairé des capitaines on ne devait pas risquer, dans une collision décisive, le sort des positions occupées. Ces positions qui furent par la suite, l’une après l’autre, ignominieusement perdues.
Mais si ces murs s’étaient écroulés ?
Que nous auraient donnés les condottieri du peuple élu ; les sacerdoces de la sainte arche marxiste ?
Ils nous auraient donné le renversement de la médaille fasciste : la dictature au nom du prolétariat.
Ils ne le disaient pas ouvertement hier, alors qu’ils en discutaient entre eux en contradictoire ; mas après de nouveaux voyages, après de nouveaux pèlerinages à La Mecque moscovite, l’unité, sinon celle matérielle, impossible avec tant de généraux, du moins celle spirituelle, l’unité est à nouveau entre eux en ce qui concerne le but à atteindre, à imposer, et les différentes tendances ne sont au fond que des prétextes pour masquer les rivalités entre les personnes et les groupes. Mais les uns et les autres veulent l’État.., ouvrier ; État classiste ; c’est-à-dire de la classe… des dirigeants.
Leur idéal est bien d’abattre la situation présente, mais en remplaçant la tyrannie par la tyrannie. C’est-à-dire, de laisser la liberté véritable clouée sur la croix, tout en se servant d’une liberté fantôme pour appeler les gens à faire « bloc ».
Eh bien non. Nous ne devons plus nous prêter à de tels jeux.
Nous devons dire toutes les beautés, toutes ses attitudes austères et généreuses de la liberté véritable. Nous devons la rendre aimée et connue, maintenant justement qu’elle est invoquée par beaucoup, à l’heure du désespoir.
À partir d’aujourd’hui nous devons être contre toutes les dictatures : contre toutes, même si parmi elles il y en a une qui veut nous libérer du présent.
Le travail de Sisyphe
Au fil des siècles, avec une constance non plus admirable mais écœurante, l’homme s’est efforcé de renouveler ses peines en expérimentant et réexpérimentant, après les avoir retouchés, les différents régimes politiques et économiques qui, de tout temps, ont formé son malheur. À plusieurs reprises, il a changé ses dieux, de la même manière, et plus souvent encore, il a changé de maîtres. Il a remplacé le chef de tribu par le grand prêtre, le pape par le condottiere, l’autocrate par le roi constitutionnel, le présumé roi fantoche par le président plus ou moins démocratique d’une république plus ou moins oligarchique ; il s’est donné des dictateurs et a même fait des révolutions pour trouver de braves personnes qui se sacrifieraient pour le gouverner en son nom…
Il a fait, corrigé, défait, et en est revenu à faire ce qu’il avait démoli… Il s’est jeté en avant et a marché à reculons… Mais aujourd’hui comme hier, ou comme avant-hier, une fois fait le bilan de tous ses efforts et de toutes ses expériences, il est obligé d’avouer… à lui-même (par peur d’être arrêté par des gendarmes que lui-même a voulu et que lui-même maintient) que les choses vont très mal, et qu’il est toujours loin d’atteindre cet état de vivre-ensemble qui devait le rendre maître de son existence et ne pas le maintenir éternellement l’esclave de quelques-uns ou de beaucoup.
Si l’on regarde de près tout son « chemin de croix » il faut constater qu’il a relativement progressé : ses recours historiques, il les a effectués en parcourant une spirale. S’il sent plus l’esclavage d’aujourd’hui c’est parce qu’il a oublié celui d’hier. Néanmoins il faut aussi reconnaître que sa progression se fait lentement et en zigzag ; souvent incertaine et contradictoire. Une fois un pas fait en avant, il en parfois fait trois en arrière, pour après reprendre la marche interrompue. Et de temps en temps, il plie sous le poids de la croix et s’effondre, inerte, abruti.
Mais si vous lui conseillez de se libérer justement du poids de cette croix, lui qui croit fermement que la traîner derrière est son destin, il fera un geste de refus, scandalisé. Il se refusera même d’en tenter l’expérience. Cependant si vous insistez il vous écoutera, et si vous le trouvez dans un moment de désespoir aigu, il vous applaudira. Mais il ne sortira pas de là… saisi par la « logique » d’un de ses anciens raisonnements : un raisonnement qui n’est pas le sien, mais que d’autres ont fait pour lui et qu’ils lui ont appris par cœur comme un précepte moral.
– Comment ferais-je alors pour marcher, libérer de ce poids ? Cette croix est pour moi ce que la queue est pour les singes, le gouvernail pour les bateaux : elle équilibre mes gestes et mes efforts, elle me remet sur le droit chemin chaque fois que j’en sors. Les ancêtres de mes ancêtres l’ont fabriquée, et à travers les siècles elle a été plus d’une fois restaurée. Cependant, il y a en elle des superstructures plus ou moins nouvelles et même moi j’y ajouterai quelque chose pour mes descendants. Mais son ossature interne est extrêmement vieille, peut-être toute pourrie, cependant elle est sacrée.
D’ailleurs cette croix a un nom glorieux qui fait baisser la tête de beaucoup de gens superbes : elle s’appelle la croix de la Tradition. Alors, si je me libère de la croix de la Tradition, qu’en sera-t-il de moi ? Je serais comme un enfant ayant perdu sa mère : je redeviendrais comme un enfant qui ignore tout et je devrais tout apprendre à nouveau. Mieux vaut alors, malgré son poids, porter cette croix derrière moi : après tout, elle me donne aussi la connaissance historique de mes maux, ce qui est toujours une consolation…
– Eh bien, si cette connaissance de tes maux est réelle, ne garde que celle-là, et garde-la bien à l’esprit. Mais débarrasse-toi d’un poids qui t’accable et qui s’augmente de superstructures inutiles. Tente une vie nouvelle dans la pleine liberté de tes mouvements. Si tu en avais envie tu pourrais toujours retourner sur tes pas, et courber à nouveau tes épaules sous le poids de la Tradition. Mais es-tu certains que tu en aurais envie ?
L’étourdissement du premier instant passé, après avoir chancelé dans tes nouveaux premiers pas tu éprouverais le plaisir de te sentir patron de tes mouvements : tu connaîtrais la liberté véritable et marcherais rapidement et l’esprit joyeux, en toute insouciance, vers ta perfectibilité.
Mais l’homme ne dit ni oui, ni non. Il voudrait, mais il n’ose pas. C’est que sa volonté ne fonctionne pas comme une force qui peut devenir « cause » après avoir été « effet ». Mille petites peurs et égoïsmes l’obscurcissent, la paralysent.
La liberté question de volonté
Par conséquent, donnons une volonté à l’homme, apprenons-lui à vouloir.
– Mais c’est précisément la mission, la fonction même, du déterminisme économique, qui peut même la remplacer dans ses labeurs, déterminant à sa place une évolution de justice ; suggèrent les marxistes.
Derrière le dédale des mots qui remplace le Père Éternel par le Déterminisme économique, contre le volontarisme qui libère, on discerne, en armes, la Force des choses qui « casuellement » peut aussi libérer.
Parce que la force des choses est une force aveugle. Elle agit, mais se contredit.
Elle prépare une situation, mais ne la résout pas. Et, comme l’horloge, elle oscille entre deux extrêmes et parcourt et reparcourt des routes déjà battues.
Afin que la volonté de l’homme puisse intervenir comme élément directif et résolutif dans le jeu des forces aveugles, il faut l’éduquer spirituellement, l’exhorter avec une idée qui la sublime et la soutient face à tous les sacrifices et à toutes les audaces.
La question de la liberté est surtout une question de volonté.
Les grands mouvements de peuple sont les produits de la force des choses en action, de la lutte entre les nations aux insurrections, aux révolutions qui modifient l’ordre politique et économique d’un pays. N’est-ce pas la force des choses qui a lancé les premiers noyaux humains à la conquête de la Terre ? La tribu nomade ne s’est-elle pas installée sur le sol cultivé en vertu de la force des choses ?…
C’est vrai ; mais si de ces résultats, dans leur aspect générique concret, nous retirons la contribution de l’intelligence, la conscience du geste accompli ou à accomplir, la mure volonté d’agir, l’intuition spontanée ou raisonnée de ce qui devrait être, le désir passionnel que cela soit, l’influx moral persuadant l’effort de s’accomplir dans un certain sens, certes nous aurions toujours le mouvement, le jeu de la force des choses en action, mais les probabilités qu’il en résulte un réel progrès seront réduites à peau de chagrin, et elles devront compter plus sur le hasard que sur une conséquence qui ne peut pas être logique, parce que le raisonnement qui devait la préétablir ou l’orienter logiquement vers une destination entrevue a manqué ou a été limité.
***
La force des choses pourra secouer des milliers et des milliers de chômeurs, ou de travailleurs brimés par une usure patronale trop avide, elle pourra même soulever un peuple affamé et contraint par la violence à se résigner à sa misère, mais la force des choses ne concédera au soulèvement, à la révolte de tels éléments, qu’un espace assez limité pour se développer, pour s’épuiser. Les affamés s’arrêteront au pillage des dépôts de vivres, les salariés parviendront peut-être à imposer une considération plus juste du labeur, les chômeurs, après s’être égosillés à demander du pain et du travail, seront peut-être casés par lots dans quelques emplois provisoires. Et la force des choses payée par ses… victoires, se reposera, préparant de nouvelles situations qui répéteront les faits déjà advenus, avantageusement aujourd’hui, avec perte demain.
À l’inverse, la force des idées, bien que ne méprisant pas le facteur de la force des choses, veillant même sur elle pour pouvoir l’utiliser à profit, transformera le soulèvement en révolution par un acte de volonté ; et elle livrera bataille non pas pour une fin transitoire et contradictoire, mais pour un idéal de justice et de liberté qui une fois atteint, placera l’homme et l’espèce dans une dimension différente de celle dans laquelle il s’est agité jusqu’à aujourd’hui, et d’où il pourra se mouvoir vers un avenir toujours plus lumineux.
***
Les derniers événements, qui en Italie ont fait le bonheur non pas d’un parti, mais de ceux qui ont quitté tous les partis – par avidité de pouvoir, par manque de convictions, par conquêtes d’emplois et de sinécures, fatigués des sacrifices – confirment, avec l’éloquence du fait consommé, que c’est une sottise de ne baser tout un mouvement de masses et de foules que, ou essentiellement, sur l’égoïsme ou l’intérêt de classe, c’est-à-dire sur les nécessités économiques.
Le découragement actuel de la quasi-totalité du prolétariat et sa défaite, ont démontré que là où les forces idéales et morales n’agissent pas, impétueuses et palpitantes, on n’a ni audace pour les conquêtes risquées, ni esprit de sacrifice héroïque pour les défenses désespérées.
Le fascisme lui-même – bien que soutenu par de nombreuses complicités – a ressenti le besoin d’inventer des mythes, et avec ceux-ci, d’enthousiasmer et d’exacerber de vastes troupes de jeunes, qu’autrement il n’aurait pas pu traîner derrière lui dans un premier temps, et pousser devant dans un second temps.
Il faut donc revaloriser les idées et généraliser le plus possible une telle valorisation : il faut réhabiliter les valeurs morales, leur redonnant toute leur importance susceptible de changer le cours de l’histoire.
Et il est urgent de poser la question de la liberté non pas comme une question de classe que la classe – elle et pas d’autres – doit résoudre, mais comme une question humaine qui concerne et doit passionner tout le monde.
Salarié ou exerçant une profession libérale, cultivé ou inculte, fils de la misère ou de l’aisance, venu du bas ou descendu du haut, celui qui s’approchera de l’autel de la liberté pour y sacrifier son offrande de foi et d’espoir, doit y être accepté comme un frère…
Le classer sur la base de son origine, ou le repousser parce qu’il n’est pas apte à traiter des intérêts économiques d’une catégorie, ou à se raidir dans la discipline de parti au lieu de se mouvoir dans celle des idées, n’est une chose ni avisé ni honnête.
Que la force des choses intervienne dans le fait économique et en établisse les conflits ; mais que ceux qui veulent donner à ces conflits une solution qui ne soit pas une succession de répétitions presque stériles des mêmes conflits, éduquent leur volonté et celle de leurs semblables à subordonner ces solutions à la solution de la question de la liberté.
Hors de laquelle il n’y a pas de salut.
Mais le travail de Sisyphe.
Le problème de la liberté et la violence
Pour l’homme qui ne veut ni opprimer ni se sentir opprimer ; pour l’homme qui veut atteindre son bonheur et vivre sa vie dans la paix et dans le bien-être il n’y a qu’une « unique » question sociale, politique et humain à résoudre : c’est-à-dire, celle de la liberté.
Tous les autres problèmes, autour desquels pourtant les hommes se fatiguent tant, ont une importance secondaire, et leur valeur n’est digne d’importance que quand au maximum des problèmes, ou à ce que j’appellerais somme de tous les problèmes de justice, ils se rapprochent et se profitent.
C’est pourquoi il ne peut y avoir de révolutions – la révolution entendue comme elle a généralement toujours été entendue, c’est-à-dire comme un épisode de progrès – qui ne se proposent de résoudre la question de la liberté.
Tous ces mouvements de propagande et de conquête qui écartent cette question (ou renvoient, pour une solution, aux époques successives, ou l’oublient, ou carrément le répudient), usurpent le nom de la révolution et, de fait, ne sont pas des révolutions mais des coups de force ou des coups d’États ; des abus de partis, de castes, de classes et aussi de masses.
Parce qu’il n’est pas dit que là où est la masse, c’est-à-dire la majorité, il y a nécessairement une compréhension claire et précise du devenir social, du perfectionnement des systèmes politiques, du perfectionnement des systèmes politiques de vie collective, de l’exaltation du droit de tout individu, de la finalité libertaire avantageuse pour tous.
Ainsi, quand le fascisme vante sa « révolution » en acte, il se montre, malgré toutes ses compétences, aussi incompétent à évaluer ce que, de tous les peuples, de tout temps et partout, on a entendu par révolution, et voulu. Pour s’insérer dans l’histoire en qualité d’honnête homme, le fascisme fait de la démagogie d’escrocs pure et simple. Il n’a pas accompli une révolution, mais une sorte de coups d’État avec l’accord de l’État.
Et quand les communistes russes parlent d’une révolution efficace, défendue, protégée et propagée par eux, avec la prétention de tous les parvenus, des esclaves faits maîtres, de l’inquisitionné devenu inquisiteur, du voleur fait gardien, de la recrue promue général, ils tentent une fraude digne des jongleurs à deux balles… comme le tentent eux aussi les fascistes, dont ils sont le renversement de la médaille.
Mais les uns et les autres se retrouvent seuls à s’acclamer et à se justifier. Et autour de leur char triomphal, même si le consensus des vaincus et des lâches, des clients bien repus et des prétoriens bien payés fait du boucan, des multitudes s’attroupent elles aussi, dans l’esprit desquelles la haine « brûle cependant en silence ».
La question de la liberté ne peut pas être compris par les partis qui ont un programme à imposer, et qui conspirent ou pactisent pour l’imposer.
La « justice sociale » que l’on veut faire consister « entièrement » dans l’égalité économique atteignable à travers les décrets d’un nouvel État, ne comprend pas, comme on veut le faire croire, la solution à ce problème. Au contraire, une fois en pratique, elle l’éloigne. Et elle l’éloigne en réconciliant l’individu, ou une somme d’individus, avec des systèmes plus injustes économiquement parlant, mais plus tolérant vers des manifestations spirituelles et politiques opposées et différentes ; faisant regretter les temps où la pauvreté n’excluait pas l’usage des libertés les plus communes.
Certains systèmes prétendument communistes, qui prétendent élever l’humanité en l’appâtant par le ventre, font chanter l’individu comme Jacob fit chanter Esaü ; c’est-à-dire qu’ils veulent supprimer la personnalité, en compensant sa perte par un bol de soupe sur laquelle brilleront quelques îles de gras sébacé, coulées par la collectivité suante devenue « libre » de contrôler le parfait fonctionnement de son joug. Une soupe pour tous peut-être, mais la liberté pour personne.
Mais il y aura toujours des hommes, nombreux ou pas, qui se rebelleront contre la mécanisation que l’on voudra faire d’eux ; il y aura toujours des hommes qui conspireront pour la révolution qui devra libérer le corps et l’esprit.
***
L’homme, tout juste élevé d’une marche au-dessus du niveau de son animalité vécue dans le troupeau, ne sent pas d’autre aspiration obsédante que celle de la conquête de son indépendance. Et tous ses efforts, à travers le temps et l’espace, ne tendront qu’à atteindre l’émancipation briguée.
De même que l’individu, les groupes et les peuples aussi.
Il advient cependant assez souvent, sinon toujours, que par d’évidentes erreurs de calcul, chacun – individu, groupe ou nation – appuie la conquête de sa liberté sur les bases vacillantes du tort à autrui ; sur une diminution de la liberté des autres.
C’est une vérité courante aujourd’hui, dans un certain monde, que pour se sentir pleinement libre, c’est-à-dire maître d’elle-même, une nation doit nécessairement écraser ses voisins ou leur peser dessus avec son hégémonie politique et commerciale ; – tout comme un citoyen, pour atteindre sa liberté, doit se conquérir une position financière ou politique qui le place dans une situation de privilégié.
Comme chacun peut aisément le constater, sans même recourir à un travail d’enquête et de critique, il s’agit de prétendues solutions partielles à la question de la liberté, excluant a priori n’importe quel processus de continuité et de développement collectif, universel.
Avec l’imposition et la superposition, on ne peut pas résoudre la question de la liberté, encore moins en y substituant des situations de tyrannie de classes ou de groupes : parce que ceux qui oppriment ne sont pas libres non plus de jouir de ce qu’ils considèrent leur liberté : parce que ceux qui se trouvent dans une situation de privilège, d’exception, de supériorité, ne sont jamais sûrs de la conserver et devront, à tous moments, la sentir martelée par les malédictions et par les coups de tous ceux qu’ils doivent nécessairement opprimer.
Donc : non pas exercice de la liberté, mais la possibilité d’un arbitre ; – non pas jouissance de la liberté, mais orgie de violences provisoirement heureuses ; – non pas droit, justice, sincérité, mais usurpation, abus, tromperie : la tyrannie toujours.
La question de la liberté ne peut pas avoir pour causes des privilèges devant peser sur les autres, mutilant chez ces autres l’usage des droits particuliers, sans réciprocité de sacrifice et d’avantages, .
La question de la liberté n’est pas, et ne peut pas être, une question exclusivement classiste, mais une question humain ; non pas d’église ou de parti, mais universel.
Et quiconque en impose la solution doit nécessairement coordonner la fin aux moyens. Il faut aller à la liberté par la liberté.
Si pour se réaliser, une liberté doit en violer ou en supprimer une autre, imposant (non pas avec le raisonnement ou l’exemple qui persuade, mais par la violence qui plie et enchaîne) son programme – un programme qui ne se discute pas –, il ne s’agit plus de liberté mais de despotisme.
Une liberté qui pour se maintenir a besoin du flic ou de l’inquisiteur, de l’espion et du bourreau, est une escroquerie de charlatans politiciens et ne peut être supportée que par un peuple qui a l’habitude du servage.
Une fois l’imposition écartée il ne peut pas y avoir de liberté qui s’élide, mais diverses libertés qui discutent, s’accordent et s’harmonisent. C’est-à-dire, non pas collision, mais raisonnement.
***
Jusqu’à aujourd’hui, les seuls qui ont osé affronter la discussion autour de la question de la liberté, l’imposant dans son intérêt et démontrant l’urgence, le caractère indispensable et inajournable de sa solution, ont été les anarchistes et ces savants, dont la critique des différents ordres économiques et politiques existants et dépassés, a dû déboucher, par honnêteté intellectuelle dans leurs recherches et leurs déductions, bien que partie de prémisses et promesses opposées, dans la conclusion anarchiste.
Les différentes écoles démocratiques et socialistes ont considéré la liberté ou bien comme le simple droit d’utiliser certaines possibilités communes d’action politique ; ou bien elles l’ont tellement subordonnée au dogme de l’égalité économique absolue, que cela laisse supposer que l’humanité nouvelle ne peut pas se développer autrement que comme un ventre dont les fonctions seraient réglées par un pouvoir central monstrueux, écrasant, un mastodonte.
Et une certaine école socialiste est arrivée encore plus loin : elle est arrivée à bafouer directement le principe de liberté ; à affirmer qu’elle le repousse, le jugeant petit bourgeois, c’est-à-dire réactionnaire.
Ainsi nous avons vu les fascistes et les communistes s’efforcer de se montrer, les uns plus que les autres, liberticides dans les mots et dans les faits.
On pourra observer qu’il n’a pas manqué d’anarchistes qui, face à un tel problème, se sont contredits ou ont fini par divaguer dans le monde de l’absolu philosophique, et que de nombreux fanatiques de la liberté assument parfois des attitudes de bourreau de cette même liberté.
Parfaitement vrai.
Mais cela peut dépendre de la somme des contradictions qui tenaillent l’individu dans un milieu de despotisme, d’états d’esprits particuliers, aussi bien que du fait que de nombreux subversifs et savants, sont arrivés à l’anarchisme avec le dos courbé sous le poids d’un bagage encombrant ; bagage de postulats économiques, de prémisses économiques, de déterminisme économique, de matérialisme historique et de classisme catalogué avec une rigidité absurde.
Ainsi, ceux sur qui pesaient de tels bagages ne virent pas la question de la liberté autrement que comme une question dépendant du facteur économique, et ils hurlèrent que depuis Saint Paul – pourquoi depuis lui précisément ? – ceux qui sont pauvres sont esclaves. Comme si même au temps de Saint Paul il n’y avait pas eu des eunuques richissimes et des esclaves ventrus.
Et d’autres, passés sous la presse de toutes les tyrannies, au nom de la liberté piétinée, battue, niée, finirent, par un excès de réaction, par ne rêver que d’une heure d’allègre vengeance à accomplir sur les tyrans et leurs clients d’hier.
***
Désormais, cela n’est pas bien difficile d’admettre que l’on peut arriver à assurer accidentellement une certaine somme de bien-être bucolique à tous les habitants d’une région donnée, en échange d’une oppression générale et d’une soumission à la volonté de quelques-uns, vraisemblablement honnêtes et animés par les meilleures intentions.
Et cela ne doit pas être bien difficile non plus d’admettre que dans l’histoire, un tyran qui se présente puisse, pendant un certain temps, régaler ses sujets et les étourdir avec des fêtes carnavalesques.
Mais tout cela ne peut durer qu’un moment, éphémère devant l’histoire.
Le bien-être assuré à tous sur un plan d’égalité, et réparti dans les mêmes mesures, n’en contentera que quelques-uns, peut-être pas même ces quelques-uns, et viendra assez vite à manquer – comme bénéfice pour tous – parce que la capacité productive sera grandement diminuée par des « travaux forcés », qui étoufferont toute initiative et abrutiront les membres de la collectivité, avec le nivellement imposé des efforts à accomplir et des nécessités à satisfaire.
Sans compter sur la corruption que les quelques-uns élevés, ou s’étant élevés inconsciemment au statut de chef, assimileront pour la déformation professionnelle de leur potentialité administrative et qui se montrera despotique dès qu’ils devront créer et manœuvrer des classes privilégiées, des catégories spéciales, avec des fonctions permanentes, pour faire exécuter et respecter des prescriptions précises.
Puisque l’abondance est offerte par le tyran et exempte de servitude, elle durera le temps d’une récolte abondante ou d’un vol rondelet dans la maison d’autrui.
La richesse pour tous dans le sens large et honnête de l’expression ne peut pas être le résultat de dispositions dictatoriales, de centralisations bureaucratiques, de rationnements monastiques – qui dans la pratique varient entre les novices et… les frères véritables – mais bien le résultat de la liberté pour tous.
Et elle ne pourra pas se maintenir, même atteinte par différents moyens, si tous n’ont pas la liberté d’y contribuer et celle de ressentir d’éventuelles limitations nécessaires.
L’homme doit avoir la liberté de produire et de consommer.
***
La question de la liberté est unique et indivisible. L’échec de tout régime démocratique est la conséquence de la division et de la subdivision qu’il accomplit du principe de liberté.
La liberté ne s’accorde pas en partie et jusqu’à un certain point. On ne peut pas l’admettre et la permettre dans un sens et la nier d’un autre. Les limitations la contredisent : le fractionnement la nie.
Pour éduquer à la liberté il n’y a rien de mieux que l’usage de la liberté elle-même.
La liberté intégrale doit être spirituelle, politique et économique. Si on la limite à un seul de ses caractères fondamentaux, si pour l’une de ses fonctions elle renonce aux autres qui la complètent, alors elle aboutit à une farce atroce, comme dans les nations sous régime démocratique, ou à une tyrannie pire que les autres, comme dans le régime communiste autoritaire dont la Russie nous offre aujourd’hui un exemple absolument pas admirable.
L’homme libre, pour se sentir tel, ne doit subir aucune dépendance économique et politique ; il ne doit pas être contraint dans sa manière de penser ; il doit jouir de la faculté de pouvoir communiquer sa pensée, sans restrictions ; il ne doit pas être contraint d’accomplir une chose qui répugne à sa conscience.
Il y en a qui disent : – La liberté pour tous, voilà un idéal noble et généreux ; mais comment concilier toutes les foi, harmoniser tous les besoins, empêcher l’assujettissement de certains groupes par d’autres groupes plus développés ou favorisés par des conditions environnementales particulières ?
La réponse à ces questions est dans leur présentation elle-même.
Effectivement, il faut concilier les différentes foi dans la tolérance réciproque, et ne pas nier à celle-ci ou celle-là le droit de vivre : il est nécessaire d’harmoniser les besoins et de ne pas les opposer en permanence ; il est urgent d’inciter à la solidarité les groupes favorisés avec ceux délaissés, les groupes développés avec ceux arriérés, par un calcul noblement égoïste et non pas exclusivement accablant et de spoliation.
On demandera : vous voulez alors établir un rapport de tolérance réciproque, par exemple entre l’hérétique et l’inquisiteur ; entre l’esclave et le maître, entre la tribu colonisable et les pionniers de la civilisation ? Ce serait une tentative absurde.
Nous répondons : Rien de tout cela. Vis-à-vis de la liberté il ne peut y avoir de rapport de réciprocité qu’entre des personnes libres, ou qui veulent atteindre leur liberté sans la transformer en oppression pour les autres.
L’usage de la liberté présuppose la conquête de la liberté.
Pas d’hérétiques ni d’inquisiteurs, donc, mais des individus libres de croire ou de ne pas croire dans telle ou telle divinité.
Pas d’esclaves ni de maîtres, donc, mais des individus et des groupes de producteurs placés dans la possibilité de bénéficié des moyens de productions – et voilà le socialisme dans sa partie fondamentale, essentielle, logique, honnête et humaine – comme d’un patrimoine mis à la disposition de toute personne voulant l’utiliser à bon escient.
Pas de colonisés ni de colonisateurs équipés de blindés, donc, mais un expansionnisme qui bénéficie, se bénéficiant, et qui ne sera jamais repoussé s’il donne la garantie de ne pas vouloir imposer de nouvelles lois, de nouvelles religions et des usages différents.
Il y en a aussi qui disent : pour aller faire la liberté véritable et intégrale… il faut renoncer à la civilisation : même à tout ce que la civilisation a construit d’honnête, d’utile et de beau. Il faut retourner à la vie simple ; reprendre la route des bois, retirer ses habits inutiles et se libérer des travaux superflus et inutiles.
D’autres, plus modestes, se limitent au contraire à soutenir les avantages… diurétiques et économiques de l’alimentation végétale.
D’autres encore voudraient carrément mettre un compteur aux organes reproductifs et élever un monument à Onan. Et il y en a même qui, dans le désespoir d’une rancœur impuissante contre l’humanité qui ne sait pas ou ne veut pas se libérer, invoquent Origène.
Mais dans ces recours à un mysticisme peu concluant, ou dans l’exagération de mesures prophylactiques, dans l’universalisation de systèmes de vie monacale qui peuvent aussi faire le bonheur de quelques défaitistes et pour une durée limitée, il n’y a pas une ascèse vers une plus grande jouissance de la liberté, mais l’illusion qu’un milliard d’humains peuvent se décider d’un trait à renoncer à ce que l’homme a peiné à construire pendant des millénaires… pour retourner aux luttes des troglodytes, aux luttes contre la nature toujours avare avec ceux qui ne savent pas la faire produire ; aux luttes pour le brasier allumé, pour la femelle désirée, pour un bout de terrain semé, pour le bétail réuni.
Des renoncements monstrueux pour retourner au début, pour recommencer du début, maculé par le même péché des origines ?
Non ! Non !… voilà le cri d’hommes qui veulent vivre dans le monde tel qu’il est aujourd’hui : aucun renoncement ; au contraire, emparons-nous de la « joie de vivre » à main armée. Imposons le règne de la liberté.
***
La question de la liberté ne peut pas être résolu grâce à la violence. Tous ceux qui parviennent à conquérir leur liberté pour l’établir sur des bases solides et en étendre l’influence, devront agir sur les autres par la force de l’exemple, avec la propagande par le fait, sans quoi il n’y aura pas d’entente, mais des impositions et, par conséquent, des rébellions.
L’anarchisme est la doctrine de la liberté ; elle trace dans les grandes lignes, mais avec sûreté, une disposition libertaire pour l’homme et pour la collectivité.
Néanmoins, elle ne peut pas être imposée comme une autre ; il est inconcevable que l’on puisse imposer l’anarchisme comme on impose un Communisme d’État, ou un fascisme d’oligarchies où règne un dictateur esclave de ces dernières.
Mais il est concevable que ceux qui se sentent opprimés cherchent à briser le joug qui les opprime. La violence est une nécessité qui ne se discute pas quand elle s’impose comme l’unique moyen qui reste pour faire valoir ou démontrer ses raisons.
Quiconque est enfermé dans une tombe, condamné à y mourir étouffé a non seulement le droit, mais aussi le devoir de forcer avec le dos la pierre de son tombeau et, avec, de renverser les gardiens du tombeau.
Le droit à la violence n’accompagne pas la liberté, mais commence là où elle finit. Et celle qui brise les chaînes, ou arrache le bâillon, c’est la violence de libération, que l’histoire célèbre et ne condamne pas.
La violence légitime est donc celle qui découle d’une nécessité de libération. Une telle légitimité a toujours été admise dans l’histoire. Et si les magistrats du moment l’ont condamné, l’histoire l’a toujours acquitté. Mais elle n’a jamais acquitté les violents qui ont servi la tyrannie.
Tous les violents ne sont donc pas des rebelles, et l’on peut se rebeller contre une oppression sans utiliser la violence.
La violence pour la violence ne résout rien même si elle est appliquée à une vision apocalyptique, nihiliste, de destruction. L’humanité et les individus veulent vivre, non pas se suicider. Dans le nihilisme destructeur, il n’y a qu’un grand désespoir face à un rêve de vie immense que l’on croit évanoui pour toujours.
***
Même ces disciples sont plus logiques que leurs maîtres, socialistes et communistes, pour tirer de l’apologue, placé stupidement à la place d’honneur, la morale de la fable, parce qu’ils ne déduisent sûrement de l’apologue que le concept des représailles réparatrices. Mais les maîtres, plus… profonds, savent que cette « morale » enseigne bien autre chose.
Mais si cette « morale de la fable » peut aussi rentrer, sur les épaules du gouvernement ouvrier, dans la morale socialiste et démocratique, au contraire, pour les anarchistes, elle ne devrait représenter que la conclusion intéressée d’un autre apologue trompeur issu de ce recueil classique dont Menenius Agrippa, habile charlatan romain, fut un des premiers collaborateurs.
Vous rappelez-vous aussi de celui-là ?
La plèbe romaine, fatiguée d’être brimée par les patriciens, s’était retirée sur l’Aventino disent certains, au-delà de l’Aniene disent d’autres, sur le Mont Sacré, et « là-bas – les rebelles – sans avoir aucun chef, s’étant fortifiés de fosses et de palissades, y restèrent quelques jours, ne prenant dans le village que les choses nécessaires pour se nourrir, sans offense, et n’étant offensé par personne ». Parce qu’il semble qu’à toutes les époques, le peuple en révolte se soit toujours comporté plus humainement que les armées… libératrices et que les milices disciplinées.
Cette désertion déplut aux sénateurs et aux patriciens qui conclurent qu’il était mieux de « se réconcilier avec la plèbe ». Ils envoyèrent alors aux rebelles un plébéien renié, Menenius Agrippa. Et « Ménénius – raconte Tite-Live -, introduit dans le camp, dans le langage inculte de cette époque, ne fit, dit-on, que raconter cet apologue : Dans le temps où l’harmonie ne régnait pas encore comme aujourd’hui dans le corps humain, mais où chaque membre avait son instinct et son langage à part, toutes les parties du corps s’indignèrent de ce que l’estomac obtenait tout par leurs soins, leurs travaux, leur ministère, tandis que, tranquille au milieu d’elles, il ne faisait que jouir des plaisirs qu’elles lui procuraient. Elles formèrent donc une conspiration : les mains refusèrent de porter la nourriture à la bouche, la bouche de la recevoir, les dents de la broyer.
Tandis que, dans leur ressentiment, ils voulaient dompter le corps par la faim, les membres eux-mêmes et le corps tout entier tombèrent dans une extrême langueur. Ils virent alors que l’estomac ne restait point oisif, et que si on le nourrissait, il nourrissait à son tour, en renvoyant dans toutes les parties du corps ce sang qui fait notre vie et notre force, et en le distribuant également dans toutes les veines, après l’avoir élaboré par la digestion des aliments. La comparaison de cette sédition intestine du corps avec la colère du peuple contre le sénat, apaisa, dit-on, les esprits » et les incite, les persuade de retourner à la guerre et aux sacrifices, non plus en faveur de l’estomac qui assimile, distingue et distribue à l’avantage de l’économie commune, mais à l’avantage des parasites du corps… social, qui prennent pour eux la partie la plus grosse et meilleure.
Et voilà comment un apologue qui aurait dû être honnêtement interprété par les sénateurs et les patriciens, plutôt que par la plèbe, démontrant les avantages pour l’utilité générale de la solidarité de tous les membres du corps… social, aussi bien dans le travail que dans la consommation ; un apologue interprété à l’envers, qui aurait dû enseigner comment, en étant un agrégat, tous les éléments de celui-ci doivent, dans leur mutuel avantage, concourir au bien-être commun ; servit au contraire à faire la fortune des ventres oisifs qui reçoivent et ne distribuent pas, ou distribuent tout juste ce qui suffit à maintenir l’activité productive des hommes destinés en plus à la guerre et aux sacrifices.
Mais un apologue… corrige l’autre. L’Échelle renversée est la vengeance des membres exploités. Ce philosophe…
Ce philosophe accomplit peut-être un acte de justice apparente, transitoire, mais en renversant l’échelle il ne fit, en vérité, que commencer une nouvelle injustice. Il remplaça le privilège par le privilège.
Sans parler de ce qu’un sociologue bourgeois aurait pu lui faire remarquer : Mon cher collègue ; ainsi renversée, l’échelle a perdu sa stabilité. La partie étroite en bas, c’est-à-dire les barreaux les moins longs, en haut la partie large, c’est-à-dire les barreaux plus longs et très longs…
Le centre de gravité pourra facilement être déplacé : l’équilibre social rompu. Il suffira d’un coup de vent. Et l’échelle tombera par terre, dans la boue. Et se brisera.
– Très bien, qu’elle se brise… commenterait, s’il était là, un nihiliste.
Oui ; le rien, le chaos, la destruction pure et simple, on verra ensuite. Puis… pour rester dans le monde des échelles et des barreaux, on… reconstruirait l’échelle avec les barreaux qui sont en haut et ceux qui sont en bas ; ceux dans le soleil et ceux dans la boue.
Et les membres laborieux retourneraient s’exténuer à remplir les ventres parasitaires : les ventres qui absorbent et qui ne distribuent que ce qu’il faut pour que les membres laborieux n’abandonnent pas, épuisés.
Et alors ?
***
Alors il faut laisser de côté les barreaux et considérer les hommes ; trouver la « morale » dans la vie et non pas dans les apologues.
Les marches d’une échelle seront toujours les marches d’une échelle. Et il y aura toujours les barreaux qui seront en haut, et ceux qui seront en bas, même si les philosophes de la philosophie des gestes stériles renversaient l’échelle tous les quinze jours.
Mais les hommes peuvent tous rester au même niveau de justice.
Il suffit qu’ils le veuillent.
Il suffit que chacun donne tout ce qu’il peut et qu’il sait donner.
Il suffit que chacun prenne ce qui lui est nécessaire.
Chez les hommes, l’échelle de l’injustice commence quand l’un d’eux prend pour accumuler, quand l’un d’eux abuse de sa force ou de son savoir pour s’élever sur les autres afin de les dominer, les opprimer et les exploiter.
Mais si personne n’exploite, si personne n’opprime… c’est l’égalité.
Non pas l’égalité de la même soupe ou de la même raison de jouissance spirituelle ; mais celle de chaque JE satisfait dans ses besoins singuliers.
Satisfait même par le sacrifice, si nécessaire, librement accepté.
***
On dira : tout ce que tu as dit jusqu’ici est juste et désirable.
Mais pour que le règne de la justice idyllique arrive, et pour que les hommes apprennent l’usage de la liberté, et, dans la tolérance réciproque, ne transforme pas cet usage en un abus rétablissant l’oppression, et par conséquent la rébellion… quelle immense révolution devra d’abord se développer et s’enraciner dans les cerveaux et les cœurs ?
Et alors – demanderais-je en retour – nous devrions continuer la course aveugle dans un cercle de fil barbelé, dans un cercle de peine et de mort ?
Certainement pas… Mais on ne peut pas changer la face du monde d’un jour à l’autre.
Et cela est aussi vraisemblable.
Mais si nous ne sortions jamais de ce cercle, si nous n’obtenions jamais ou ne conquérions jamais, hors de lui, la liberté de nous acheminer dans une nouvelle voie, avec une foi nouvelle, vers de nouveaux espoirs, ce monde nous présentera toujours les mêmes faces, quelle que soit la couleur du fard qui cherche à le rendre plus affreusement séduisant et différent.
De là la nécessité de vouer un culte – et un culte de passion – aux idéaux de libération ; de les soutenir, de les défendre contre tous les pièges et contre toutes les oppressions.
La solution à la question de la justice sociale est dépendante de la solution à la question de la liberté. C’est une question de liberté.
Jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas de question de droit et de justice que l’on n’ait pas tenté de résoudre avec l’autoritarisme.
Même là où une expérience socialiste était possible on a voulu la guider et la régir avec une autorité plus impitoyable encore.
Et bien que l’on ait parlé d’un État qui découle d’une somme d’individus ou de groupes autonomes, dans les faits, on a seulement eu l’État qui – supprimant toute liberté d’expérimenter, imposant une loi commune mesurée sur le même mètre pour différents groupes – a gouverné et piétiné la somme des individus.
Donc… un échec de plus.
Voilà donc la vérité : toutes les tentatives accomplies jusqu’à aujourd’hui afin de rétablir la paix entre les hommes, dans la nation et hors d’elle, ont échoué, y compris les plus généreuses. Toutes. Et toutes ont été accomplies, en mettant la liberté de côté : la laissant pour plus tard. Toutes. De même pour celles que l’on voudrait accomplir… et qui pour cette raison sont vouées à l’échec.
Alors pourquoi ne pas tenter une nouvelle voie ? Pourquoi ne pas chercher à sauver l’homme et l’humanité… avec la liberté ?
À la révolution « pour libérer » le peuple, ou le prolétariat, ou un prolétariat, pourquoi ne pas privilégier la révolution des individus, des peuples, des prolétariats qui « se libèrent » ?
Pourquoi vouloir, dès aujourd’hui – et c’est un effort insensé commencé dès hier – emprisonner l’avenir dans un programme de limitations ?
Pourquoi dire : voilà les tables de la loi. Elles ont été faites par certains, jugeant des nécessités et des aspirations de tel ou tel peuple ; mais devront-elles être identiques pour tous, même si tous ne veulent pas les accepter, ou ne « peuvent » pas les accepter ?
Pourquoi dire à l’opprimé d’aujourd’hui, je te libérerais de l’oppression actuelle afin que demain tu puisses vivre dans « ma » liberté, et non dans « ta » liberté ?
Mais ce lendemain de liberté – demandent les hommes qui veulent hypothéquer le futur – ce lendemain aura-t-il aussi un nom, et peut-être aussi tout un système établi et dogmatique ?
Oui il l’a ; et je, et nous l’appellerons fédéralisme anarchiste.
C’est-à-dire, les individus qui se fédèrent dans un groupe – pour leur volonté ou leur utilité – et les groupes qui se fédèrent dans la région, et les régions qui font les agrégats nationaux, et les nations qui font l’humanité.
C’est-à-dire, les libres contractants qui vivent « leur vie », qui s’efforcent de démontrer la supériorité de leur vie, qui cependant ne l’imposent pas au voisin ou au non-associé, mais qui établissent avec lui un pacte d’utilité réciproque.
<span style="font-size: med
